-
Compteur de contenus
6 039 -
Inscription
-
Dernière visite
Informations Personnelles
-
Titre
If you don't want, you Kant...
Visiteurs récents du profil
24 531 visualisations du profil
deja-utilise's Achievements
-
Bonjour @ashaku, je vois, on ne s'en sort pas effectivement, ce que tu dis est intelligible mais renvoie directement à ce que je t'ai dit dès le début, et que tu n'avais pas là non plus compris, quand j'ai fait l'analogie de la réflexion avec cuisiner, que le résultat dépendait à la fois de la qualité des ingrédients, de leur nombre et des modes opératoire pour le faire, ou je-ne-sais-plus comme de résoudre une équation algébrique, si celle-ci n'a que 2 ou 3 coefficients ou si elle en a 8 ou 10, on se doute bien que l'on ne trouvera pas la même chose au final, il est peu probable qu'elles se recoupent et ce sur une grande étendue. Et bien c'est exactement ce qui se passe, y compris comme au-dessus avec ta contre-argumentation, tu ne prends que les éléments qui t'arrangent et tu arrives - ô miracle - aux conclusions auxquelles tu voulais aboutir, ainsi tout te semble valide et bien ficelé ou même " logique " dans ton vocable, or, de mon côté mon choix écologique est bien moins restreint ou moins simplifié, ce qui me conduit à d'autres conclusions que les tiennent, parce que je tiens compte de la complexité multifactorielle des situations. Tu es quelqu'un manifestement de raisonnable, disons alors que c'est un problème de " mémoire de travail " ou pour l'expliquer naïvement, c'est comme si tu n'utilisais que 2 ou 3 briques différentes de Lego, là où je m'en sers d'un grand nombre de distinctes, forcément ce à quoi on aboutit est différent par la force des choses, et j'en reviens une énième fois au fait d'être capable de sortir de ce que l'on s'est donné et pas seulement de s'en servir, de prendre de la distance, de se découpler des(de ses) choix initiaux ou " prémisses " ou matériaux de départ pour construire son raisonnement. Effectivement, dans le cadre que tu t'es donné, tu y trouves une cohérence et même une certaine correspondance avec la réalité, au travers de ce formalisme, tu expliques les choses ou les évènement à travers celui-ci, et comme tu aboutis à une " solution ", tu en déduis qu'elle est valable, te confirmant dans ta démarche. Néanmoins, quand on inclut beaucoup d'autres facteurs interagissant, comme les émotions, la motivation, l'Ego, l'Éducation, la culture, les connaissances préalables, ses préférences, ses Croyances idéelles/idéales/idéologiques et spirituelles, ses affinités sociales et intimes avec ses proches ou avec son endo-groupe tout comme le biais dualiste " eux versus nous ", les facultés cognitives et mnésiques, le style cognitif de tout un chacun, les soubresauts métaphysiques et autres héritages historiques individuels et collectifs, le Système de Valeurs, le conatus ou la recherche du plaisir et l'aversion/évitement de la souffrance, le mode automatique ou intuitif de l'esprit humain, l'inconscient collectif sur ce qui est " sacré " par exemple, les habitudes, les problèmes identitaires et d'image de soi, nos pulsions biologiques de grand-singes, les ravages et déformations que le pouvoir provoque, le jeu des hormones, nos conditions de vie ou notre place socio-économique, le besoin de reconnaissance ou d'accomplissement de soi, notre propension au mimétisme, au conformisme et à l'obéissance, notre panoplie de scripts intériorisés, etc, etc..., la " solution " résultante est très dissemblable de la première. Tout cela pèse dans la balance, et donc module les réponses qu'une personne ou un groupe de personnes peuvent produire ! En somme, nous ne résolvons pas la même équation, comme je te l'ai dit dès le départ de notre discussion ! Et comme tu simplifies à outrance - désolé - ton appréhension de la Réalité, toutes ces subtilités et leurs influences peu ou prou majeures passent sous ton radar, ce qui conséquemment te donne l'impression que je divague ou m'égare, voire que je ne suis pas " logique ", mais uniquement dans ou à partir de ton système de représentations ! Imagine une seconde, que si tu regardais ce qui se passe sur un tapis de billard avec seulement 2 boules, ou au contraire avec une vingtaine de boules en train de s'entrechoquer, tu te doutes bien que la modélisation et ce que l'on arrive à rendre compte sera assez différent dans les deux cas, croire que 2 ou 3 paramètres suffisent à " expliquer " le Monde, comment dire... on est très loin du compte, pour ne pas faire de propos connoté. Ce ne sera pas très agréable à entendre j'en ai bien peur, mais c'est comme la différence entre un adulte lambda et un enfant de 5 ans, la compréhension que l'un a du Monde est certainement - globalement - plus précise car plus riche que l'autre, chacun peut s'en rendre compte, sans recourir à une quelconque théorie de la connaissance, chaque adulte peut simplement l'expérimenter, ça lui tombe sous le sens, l'adulte serait bien sûr assez dubitatif de s'entendre dire par cet enfant qu'il ne comprend pas bien. En effet, pour le jeune enfant, il y a tellement de choses qui lui échappent ou qui sont inintelligibles, ou inconnues, que l'adulte lui paraitrait un peu comme un extra-terrestre selon ce que lui peut entendre ou soumettre à son entendement. Et bien, je suis au regret de te dire, qu'il en va sensiblement pareillement entre nous deux, mais que je te rassure, tu n'es pas un cas isolé, l'écrasante majorité des gens atteignent/montrent rapidement leur plafond de verre intellectif avec moi. Tu es confronté à la zone distale de développement vis-à-vis de ma position et mes explications, il n'y a pas malheureusement de solution évidente, si ce n'est que d'accéder à une somme chronophage de connaissances semblable à la mienne - qui pour l'heure te fait défaut, dans le cas contraire, on ne pourra pas " se comprendre " à l'instar du bambin et de l'adulte, dit autrement, nous ne faisons pas les mêmes recettes de cuisine. Remarque bien que l'on a similairement la même chose avec les témoins de Jéhovah qui ne comprennent les choses uniquement qu'au travers du crible des Évangiles ou je-ne-sais-quoi-exactement, ils ne se réfèrent et (ré-)interprètent le Monde que via le Système de leurs Saintes-Écritures... En procédant ainsi, cela leur donne malgré tout du sens - un besoin inné et fondamental de la nature humaine ! Comprends bien que je ne t'en veux pas, que je ne te juge pas non plus, je ne fais que constater les choses comme elles sont, aussi désagréables puissent-elles être à entendre à tes oreilles, bien évidemment tu peux toujours te rasséréner en pensant que je suis à côté de la plaque si tel est ton désir ou ton besoin ou même que j'élude tes objections, c'est une réaction on ne peut plus naturelle, c'est malgré tout déjà assez remarquable que tu ne te sois pas mis en colère ou d'avoir commencé - hormis le déni, bien que je dénie - à m'énumérer des défauts - présumés/inférés/supposés - personnels, c'est donc un bon point pour toi: ta patience. Ne désirant pas te contrarier davantage, ce n'est peut-être pas un adieu qui-sait, mais ça pourrait s'y apparenter étant donné la raison de ta présence en ce lieu - qui ne match pas avec mes prérogatives, je te souhaite malgré tout que tu puisses trouver un ou des compagnons/partenaires de jeu, qui correspondraient à tes attentes très spécifiques. Bonne continuation à toi, D-U. P.S.: Ton allusion verbale à la " grammaire " me fait songer à la grammaire générative de Noam Chomsky, très spéculative. Les neurosciences et tout particulièrement la neuro-imagerie nous sont très utiles dans ce genre de scénarios, selon moi. Twain/Maslow: " To a man with a hammer, everything looks like a nail ": Pour un Homme ne possédant qu'un marteau, tout lui apparait sous forme de clou ! P.S. bis: " Ma mère m'a bien appris à distinguer "je n'aime pas" et "c'est pas bon". ", du point de vue du protagoniste qui émet le jugement c'est tout-à-fait interchangeable, d'un point de vue extérieur et contraire, ces deux assertions ne sont pas acceptables car il y a dissonance avec ses propres goûts, ce serait " moi j'aime ça " et " je trouve que c'est bon ", bien qu'il n'y a pas à proprement parler d'aporie, en réalité il y a simplement redondance dans les formulations respectives, le " c'est pas bon " est implicitement par rapport à soi, on ne voit pas comment il pourrait en être autrement, sauf à considérer " c'est pas Bon " dans le sens " ce n'est pas comestible pour les humains " ou " c'est pas bien de manger ça dans notre culture/société ", en ce cas, ça n'a plus trait aux préférences individuelles, car ce serait soit universellement vrai, soit localement consensuel, donc il vient, que " je n'aime pas " et " c'est pas bon " sont interchangeables car synonymes, ce serait une erreur que de prendre une des expressions et l'opposer à son inverse de l'expression équivalente, c'est-à-dire de vouloir confronter le " c'est bon " pour unetelle et " je n'aime pas ça " d'untel, ce serait là illogique, puisqu'au final, tout cela ne repose que sur des préférences ou des goûts différents, il ne peut y avoir de contradiction dans ces conditions. ( Il en irait de même et plus logiquement encore, entre " 1+1 et 2 " d'un côté et " 1+2 et 3 " de l'autre, si 1+1 est différent de 1+2, ça l'est aussi obligatoirement de 1+1 et 3 par exemple, ce n'en est qu'une conséquence inévitable, il n'y a pas de discrimination à faire là-dedans, il suffit de remplacer " je n'aime pas " par " 1+1 " et " c'est pas bon " par " 2 ", etc... ).
-
Bonjour, je vais tout de même répondre à quelques une de tes remarques, quand bien même, cela ne fait toujours pas écho directement à ce que tu attends de moi, je préciserai un peu plus bas, malgré tout, pourquoi je ne peux m'y résoudre. Prima facie, tu auras sans doute remarqué que j'ai pointé à maintes reprises des " imprécisions ", voire même procéder à des corrections sur tes productions/propositions, l'inverse n'ayant pas eu lieu, du point de vue de la justesse ou de la véracité, a contrario, cela ne t'empêche aucunement de me donner tes avis, tout comme de me faire part de tes croyances diverses, ce sont là deux domaines ontologiques à ne pas confondre, à savoir l'épistémé et l'opinion, il me semble au vu des innombrables réponses et affirmations que tu as écrites que tu passes facilement de l'un à l'autre sans discernement/discrimination. Il est donc fort probable que ce je m'apprête à t'écrire te soit fortement incommodant ou pire vexatoire, j'avais pourtant opté jusqu'à présent pour des incitations à l'autocorrection en te faisant part de nombre de connaissances qui s'appliquent à tout un chacun, mais pour je-ne-sais quelle raison tu l'as compris comme des conseils à améliorer ton Système plutôt qu'à le critiquer en lui-même, c'est-à-dire en ne le prenant pas comme une simple hypothèse de travail, mais comme un acquis ou une donnée qu'il faudrait étoffer ou selon toi " peaufiner ". Je ne me prends aucunement à la personne que tu aies, ni ne suis particulièrement intéressé par ton ou tes parcours initiatiques, pas plus que ce que tu aurais jusqu'à présent accompli, de manière académique ou professionnelle, ni même une éventuelle célébrité quelque part. De tout cela je n'en ai cure, cela m'importe peu, ce qui compte à mes yeux, c'est uniquement la pertinence, vis-à-vis des meilleures connaissances disponibles, de ce que tu couches sur pages numériques ici. Je ne sous-entends pas tant que ton Système sera faux, mais qu'à mon sens il est inutile au même titre que Laplace disait que Dieu était aussi une hypothèse inutile dans son modèle, c'est je dirais une distraction de l'esprit en somme. Je t'invite à méditer la différence fondamentale qui existe entre le Monde des Idées et la Réalité empirique, tu le confessais à demi-mots précédemment, ton Système est une abstraction, il prend donc bien place dans le premier, avec toutes les dérives et fourvoiements que l'on peut attendre d'une telle entreprise, on peut difficilement dire que c'est " faux " si il n'y a aucune prédiction empirique falsifiable, mais plutôt que c'est impertinent. En fait, et toujours sans rentrer dans le " vif du sujet ", c'est comme si tu avais conçu un jeu de société et que tu attendais de moi que je discute de celui-ci avec toi, ce que je m'échine à te signaler pour ma part, c'est que quel que soit le niveau de complexité de ce jeu, il n'est pas connecté au monde réel, par exemple, ce qui se trame dans le jeu du Monopoly n'est pas transférable dans la réalité financière/économique de notre réalité sociale, les sommes et biens gagnés dedans n'ont aucune valeur marchande Irl, il en va de même des règles arbitraires dedans même si elles s'inspirent d'un pan de la réalité ou plutôt les miment très imparfaitement ! Je suis le premier à m'infliger toutes mes connaissances scientifiques sur ma propre personne, que ce soit l'effet Dunning-Kruger, le biais de confirmation et le biais de congruence, les différents biais liés aux probabilités, le biais d'auto-complaisance, le biais d'optimisme, la cognition motivée ou l'ignorance motivée, l'effet de halo, la recherche/rétention sélective d'informations, l'intuitionnisme non contrôlé, les biais de disponibilité et d'accessibilité mnésiques, le biais rétrospectif, l'influence de l'humeur ou des émotions, des préférences, des croyances et des valeurs que l'on possède, etc, etc... D'ailleurs quelques uns ont été découverts par mes propres observations sur moi ou ses d'autres, comme le biais de possession et le biais de confirmation par exemples, ce qui fait qu'ils sont hautement présents à mon esprit quasiment en permanence. Je ne connais effectivement pas du tout la trionique, hormis ce que tu en as dis et ce que tu m'a donné à lire, même si je l'ai fait très succinctement. Je ne pense pas avoir littéralement écrit ou laisser entendre qu' " on ne peut pas évaluer correctement ce que l'on ne connait pas ", je pense plutôt avoir insister sur les mille et uns chausse-trappes auxquels notre cognition est soumise, que ce soit au niveau individuel ou collectif, que ce soit par le premier badaud venu ou un scientifique reconnu, que cela vienne d'une personne sachante ou intelligente ou tout à l'inverse, cela s'applique à tout un chacun, du moins qualitativement, puisque quantitativement les " esprits-critiques " s'en sortent mieux que les autres pratiquement à tous points de vue, que ce soit sur les biais, les raccourcis cognitifs, les fake-news, le bullshit, la mésinformation, le conspirationnisme et les croyances religieuses, spirituels ou paranormales, tout comme face au dogmatisme et à l'endoctrinement, pour ne donner qu'un aperçu. Ce que je peux essayer de te montrer quand même, en espérant que tu te saisisses de l'analogie correctement cette fois-ci, c'est que je n'ai pas besoin de connaitre une religion particulière pour rejeter la Religion ( a-croyant ), je n'ai pas besoin de savoir sur tel parti politique pour ne pas faire du tout de Politique ( apolitique ), je n'ai pas non plus besoin de connaitre tel sport singulier pour ne pas apprécier le Sport en général, je n'ai donc pas besoin de connaitre un Système métaphysique comme le tien ou un autre, pour n'adhérer à aucune Métaphysique, i.e. la rejeter purement et simplement, ce n'est pas une méthode valide pour investiguer le Monde, c'est pourquoi par exemple on a retenu les travaux de Newton sur ses Principes de Philosophie Naturelle, mais rien sur son Alchimie et sa Métaphysique. Pour le dire de manière métaphorique cette fois-ci, tu te proposes selon mon appréhension de ce que tu fais, de construire une ville fortifiée à notre époque, c'était sans doute en tant soit peu pertinent au Moyen-Age, mais ça ne l'est plus du tout de nos jours, tu ne peux décemment pas attendre de moi que je te donne des conseils sur comment fortifier ta place, c'est de mon côté incongru et d'autre part, cela risque fort de tourner comme avec les créationnistes, qui en lieu-et-place de remettre en cause leur idéation, se servent des contre-arguments sceptiques pour rendre leur idéologie infalsifiable ou imperméable à la critique de leur Système bien à eux ! De plus, étant donné, les nombreuses errances et autres écueils dont tu as fait preuve jusqu'à présent dans nos échanges, sur différents plans, tu peux certainement envisager que je puisse sérieusement douter - en amont - du contenu de ton modèle, en l'occurrence de sa pertinence, sans vouloir t'offenser. Un type qui-n'est-pas-n'importe-qui comme le neurophysiologiste Eccles, prix Nobel, a quand même pondu une théorie farfelue qui se basait sur les psychons ! https://www.babelio.com/livres/Charpier-Le-Cauchemar-de-Descartes-Ce-que-les-neuroscience/1855105 . Pareillement, j'ai rencontré un monsieur fort sympathique il y a quelque temps déjà, qui jeune avait obtenu un DEA de Philosophie, puis une fois en activité professionnel pour gagner sa vie, avait aussi repris parallèlement des études de Psychologie, Licence puis Master, tout semblait aller pour le mieux-dans-le-meilleur-des-mondes, jusqu'au moment de se dire au revoir, il m'a avoué qu'il était aussi " magnétiseur ", j'ai été tellement abasourdi que je n'ai pas su quoi dire ou comment réagir. Qu'en conclure ? Que l'on peut être à la fois très intelligent, érudit et aussi stupide ! Enfin, ce qui est aussi problématique en soi, c'est que malgré ma grande érudition sur la Connaissance, pas un seul chercheur ou scientifique n'a jamais fait mention ou allusion à ce genre de travaux, c'est donc une entreprise unique et isolée, ou disons à la marge des autres savoirs, comment être tenté ne serait-ce que d'en prendre plus avant connaissance(?), en effet, il y a des tas de gens qui prétendent ceci ou cela, fort heureusement, il s'opère un tri, disons darwinien, qui ne retient que ce qui semble le plus pertinent, et sera donc plus probablement relayé et communiqué à la communauté scientifique. Pour l'heure ce n'est manifestement pas le cas, et on ne peut pas exclure que cela ne le sera sans doute jamais, et puis, même si cela devait se produire malgré mon pronostic défavorable, qu'est-ce qu'on gagnerait au juste à en user concrètement - sachant que les humains fonctionnent très majoritairement intellectuellement sur un mode automatique ? Tu me demandais quel " contre-exemple " on pourrait formuler, je ne pense pas que ce soit à proprement parler de ce cette trempe, mais qu'aurait ton modèle à répondre ou à interpréter sur l'usage de l'Analogie, sur la Créativité et sur la " banalité du mal " ou encore sur l'auto-tromperie ( self-deception ) dans les affaires humaines ? Tu refais la même erreur qu'antérieurement, le biais de rétrospectivité ou bien " tout parait évident quand on connait la réponse ", il est évident qu'historiquement tel n'était pas le cas, et même si cela l'avait été, à ne pas douter, l'intelligence interprétative humaine aurait trouvé un moyen, en gardant le modèle, d'en rendre compte. Ce n'est pas à toi que je l'ai dit, mais je vais me répéter, dans une expérience menée par Johnson-Laird auprès de candidats, sur un scénario de meurtre rendant le coupable présumé innocent vis-à-vis des preuves tangibles à disposition, rendant impossible sa condamnation en l'état, était demandé: comment s'y prendre pour qu'il soit quand même reconnu coupable, et bien à cet exercice, seulement 2% des interrogés n'ont pas été en mesure de renverser le verdict initial ! L'esprit humain est très fertile quand il s'agit d'expliquer quelque chose - et même impossible; également comme l'a excellemment démontré Gazzaniga avec les personnes ayant subi une callosotomie, c'est-à-dire quand les deux hémisphères cérébraux ne communiquent plus dorénavant, il suffisait de donner des consignes à un des hémisphères puis de demander à l'autre d'expliquer la situation présente, les gens étaient toujours capables d'expliquer les choses en cours i.e. de donner une explication vraisemblable ou plausible, même si ils n'avaient aucune idée - causale réelle - de pourquoi ils se retrouvaient ainsi au moment du questionnement, l'hémisphère interrogé étant celui capable de verbalisation alors que c'était l'autre hémisphère qui avait été amené à faire telle ou telle chose, le chercheur a appelé cette fonction " le module interprète ", qui agit de manière automatique et irrépressible en chacun de nous ! Cela ne t'aidera pas à " avancer ", mais seulement à te rendre immunisé contre des " attaques " envers ton Système, comme dit il y a quelques posts déjà, ce qui te manque c'est d'être capable de penser en-dehors du cadre que tu t'es bâti, et non pas seulement de le prendre pour argent-comptant et le perfectionner ou peaufiner pour que cela semble " marcher " sans heurt. Un esprit-critique est justement quelqu'un qui n'a pas une pensée monolithique et qui est capable d'embrasser plusieurs points de vue en même temps, de multiplier les angles d'attaque ou de perspective, tout comme les niveaux d'analyse, de se référer à des connaissances légitimes et crédibles antérieurs, d'inhiber des réactions intuitives et autres processus perturbateurs, etc..., i.e. d'envisager des explications alternatives en usant d'autres modèles explicatifs, puis de comparer les avantages et inconvénients. Bon je suis à peu près certain que tu ne le liras pas, mais ce livre est un excellent résumé des découvertes et résultats sur notre Cognition, certes c'est très dense et il vaut mieux savoir de quoi il retourne un minimum au préalable, c'est-à-dire d'avoir une assez solide connaissance préalable en cognition pour se l'approprier de manière constructive et méliorative, dans le cas contraire, cela risque de faire chou-blanc, comme je l'ai fait jusqu'à présent, aussi bien avec toi qu'avec Sirielle manifestement, comme dirait maitre Yoda " je reconnais mon échec "...: https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781315460178/new-reflectionism-cognitive-psychology-gordon-pennycook J'espère qu'à présent tu te rends mieux compte de mon refus dès le départ et pourquoi il en est ainsi et pas autrement, et bien évidemment il ne faut pas rechercher là-dedans d'attaque ad hominem, ce n'est pas ce que j'ai fait, mais des tentatives d'électro-chocs pédagogiques, malencontreusement infructueuses jusqu'à présent !
-
Bonjour, je n'ai effectivement pas pris le temps de décortiquer le contenu du " billet ", toutefois et sans présager de sa teneur épistémique, j'aimerais te faire part d'autre chose, disons d'un sentiment à ce sujet, ce que j'ai pu en voir très rapidement me fait malgré tout assez penser à ce que les alchimistes et les astrologues de tout bois sont capables de produire, c'est-à-dire une système de symboles censé rendre compte de la réalité, tout ou partie. Pourquoi on ne trouve pas de " contre-exemple " dans un formalisme systémique(?), pour la même raison que l'on n'en trouvait pas non plus dans la " théorie des 4 éléments " pour le monde physique, tout comme pour la " théorie des 4 humeurs " concernant la santé, en effet, on " explique " à peu près tout à partir de ce cadre de réflexion ou interprétatif, il ne peut apparaitre de contradiction, puisqu'on projette ce Système sur le Monde ! Ce qui distingue une Science de ce genre d'opérations, c'est qu'il y a un dialogue réciproque entre " théorie " et les résultats empiriques, c'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir mettre en expérimentation des prédictions théoriques, dans le cas contraire, on n'a fait que construire une abstraction, comme il y en a eu pléthore en se reposant uniquement sur la Raison, par le passé, ou pour le dire différemment en empruntant la terminologie de L. Wittgenstein, on a créé un jeu de langage ! Il est même assez probable, que l'on ne construise pas ainsi une Connaissance Générale, mais bien plutôt nous produisons qu'une manifestation de comment fonctionne notre propre esprit d'humain ! Pour ne prendre qu'un exemple, si on peut opposer pour nous froid et chaud, ce qui semble évident et couler de source, puis donc de construire ainsi des catégories opposées, en réalité, ce n'est qu'une interprétation toute relative, en effet, nous utilisons sous nos latitudes une échelle en °C pour faire nos mesures, mais l'échelle appropriée - absolue - est celle des °K, où il ne figure aucune température négative, autrement dit, le " froid " n'existe pas, soit il n'y a " pas de température ", i.e. le 0°K, soit il y a de la chaleur au-delà de zéro donc ! C'est donc bien l'empirisme qui dicte ce que nous devons comprendre, et non pas l'inverse, de vouloir que la réalité rentre - au forceps - dans le moule que l'on a bien voulu construire à son sujet, en faisant comme cette dernière façon, on se retrouve à faire comme Procuste sans nous en rendre compte...
-
Bonjour, j'ai bien peur que cette approche succincte ne rende pas justice - ni service - à la complexité plus étoffée du Monde et de ce que l'on peut en dire. En effet, il y a plusieurs dimensions ou facettes à prendre en considération, d'une part la Réalité qui elle ne dépend d'aucune subjectivité, c'est l'ensemble de ce qui est et qui interagit à chaque instant et partout, qu'importe qu'il y ait une conscience ou non pour l'observer. Ensuite, il y a non pas une réalité subjective, mais des interprétations subjectives sur le monde réel, et qui touchent tout individu, ces appréhendions peuvent être très diverses et variées, sujettes effectivement à une part non négligeable d'imagination, bien que la plupart du temps, elles ne sont pas non plus totalement arbitraires. Ensuite, à un échelon ou niveau disons supérieur, il y a des interprétations intersubjectives, c'est-à-dire, qui sont le fruit de plusieurs cerveaux, de quelques unités à une collection en grand nombre, là aussi elles sont diverses mais bien plus qu'à l'échelle de l'individu, elles peuvent mêmes l'infiltrer, d'ailleurs c'est même celles-ci qui prédominent dans la cervelle de n'importe quelle personne. Enfin, il y a également, et tout particulièrement pour le genre humain, une réalité sociale construite, en particulier des conditions artificielles de vie propres aux sociétés humaines, là aussi, ces environnements ont une influence gigantesque et prépondérante sur nos représentations individuelles ou collectives, néanmoins, cette réalité restreinte s'inscrit, pratiquement comme les Lois naturelles, dans celle plus globale qu'est la Réalité, elle ne représente qu'un pouième ou une portion infinitésimale de cette dernière. On voit donc qu'au niveau individuel ou collectif, nous n'accédons pas à la Réalité elle-même, mais à des schémas, des représentations, des interprétations, des modèles, des théories, etc... c'est-à-dire à travers un médiateur construit par nos ciboulots, autrement dit via des idées que nous nous faisons sur cette Réalité. La réalité sociale quant à elle est d'une autre nature, proche des contraintes physiques du monde réel, auxquelles on peut difficilement échappées, quel que soit notre pouvoir d'imagination, cela n'a trop rien à voir avec une appréhension subjective et idéel, mais bien plutôt cela a un caractère objectif et concret, même si la Réalité est incommensurablement plus vaste que cette construction de vie/d'une réalité sociale. Pour nos " pensées " ou états mentaux, elles ne sont que la résultante ou le fruit de notre activité cérébrale, et donc des neurones qui interagissent, elles sont donc on ne peut plus réelles, en revanche rien ne garantit que ces idées soient en adéquation avec la Réalité elle-même en tant que représentation, il y a là autant de différences qu'il en existe en linguistique entre le signifié et le signifiant ( représentation du signifié ), prendre l'un pour l'autre, c'est sombrer corps-et-âmes dans ce que l'on appelle le nominalisme...
-
Bonjour @ashaku tu ne m'en voudras pas, mais je ne vais pas poursuivre plus avant notre échange, nous ne parlons pas le même langage et nous n'abordons pas le Monde avec les mêmes outils conceptuels ni les mêmes méthodes d'investigation. De plus, cela me réclamerait un temps et des efforts pour comprendre ce que tu as mis dans le " billet " que je préfère investir dans mes propres réflexions et recherches de compréhension, qui les accaparent et les drainent déjà presque complètement. Je ne peux donc guère abonder dans ton sens... Je te donne malgré tout une piste d'auto-interrogation sur ton positionnement actuel ou approche actuelle, à savoir Ludwig Wittgenstein, qui lui aussi avait tenté dans sa " première philosophie " d'interpréter le monde dans un formalisme relativement logique/systémique, puis s'est ravisé dans sa " deuxième philosophie " sur le tard. Ou d'une manière plus épistémique, le livre classique de Gaston Bachelard: " La formation de l'esprit scientifique ". Ou bien encore, le travail assez récent de Keith Stanovich où il distingue " algorithm mind " de " reflective mind ", pour appréhender " les choses ", le premier produisant des règles, et le second de réfléchir à la pertinence de tout élément de la chaine de production et des process en jeu comme des croyances/postulats en amont. La Réalité dépasse incommensurablement plus, tout ce que l'on peut bien penser d'elle ou sur elle. Avec mes excuses, crdlt, D-U
-
Bonjour @ashaku, tout d'abord je suis disons agréablement surpris, en ce sens que le " système " que tu as élaboré ne repose pas sur des idées New Age, des poncifs et autres élucubrations peu ou prou cul-cul, neuneu et consort, c'est donc un " bon point " qui méritait d'être évoqué, en revanche, j'ai bien peur que mes compliments doivent s'arrêter à ce point précis, en effet, tu me dis être ouvert à la critique - raisonnée - et je ne doute pas de ta sincérité, ce qui me préoccupe en revanche c'est sur l'apport constructif mélioratif que cela peut produire en toi, selon tes différentes réponses - jusque là - à ce que je te dis, je constate de ta part, une réinterprétation récurrente de ce que je te signifie, et je le suppute, cela se fait en partie à cause du modèle " triangulaire " que tu as justement construit. Ce cadre de pensée, qui n'est pas à mon sens totalement inutile ceci dit, est aussi parallèlement une enclave à la/ta réflexion, ce que je veux dire, c'est qu'il t'est manifestement extrêmement difficile de penser en-dehors de ce cadre ! Et c'est un problème en soi, en l'occurrence faire preuve d'esprit-critique consiste pour bonne part à être capable de décontextualiser ou de se distancier de ses propres conceptions ou pré-conceptions, de mettre de côté, ses préférences, ses intérêts, ses croyances fétiches, etc... Par rapport à la PP défendue ici par Sirielle, et à ce que tu comprends du Monde selon ton Système, j'y vois des similitudes cognitives même si les sujets sont quant à eux différents, vos approches sont semblables sur plusieurs points: • Il y a un biais d'optimisme dans les deux cas, une vision " positive " de l'Homme • Il y a une erreur logique dans vos raisonnements, si le ou les hypothèses H ( modèle, système ou doctrine ) supposément, impliquent des effets E dans la vie réelle: H -> E, l'erreur consiste à croire que puisque E alors H, soit E -> H est vraie. Par exemples connexes d'autres croyances, si les pratiques vaudous produisent du malheur chez la personne visée, et puisque la personne maudite vit un épisode de troubles alors le sortilège a marché, ou encore, si on voit la Lune en hiver alors il gèlera, et puisqu'il a gelé c'est à cause de la présence de la Lune. • Il y a un manque sur le plan méta-cognitif, c'est-à-dire une réflexion sur les/ses réflexions. Dit autrement, d'être en mesure de se découpler en quelque sorte, en étant à la fois acteur des pensées et en même temps observateur neutre/détaché de ces pensées en étant impartial, comme on pourrait l'être avec quelqu'un d'autre, car en général nous sommes plus avisés quand il s'agit d'autrui que soi-même. • Une approche quelque peu trop focalisée par et pour les Hommes, c'est-à-dire sous le couperet de l'anthropocentrisme et même de l'egocentrisme. Préambule: " My proposition is that either type of causal thinking leads to beliefs that are resistant to change, defying both logical and empirical challenges. This resistance is due, in large part to the judgmental strategy people use when assessing the veracity of a proposition. Specifically, the availability of supporting (relative to contradictory) instances, events, reasons, and explanations is used to assess one's beliefs. Furthermore, the biased perspectives induced by such causal thinking may lead to systematically distorted cognitive processes, and subsequently to a variety of behavioral confirmation and self-fulfilling prophecy processes. In the remainder of my time today I will focus on the preliminary stages, namely evidence that causal thinking is important in producing a biased perspective and beliefs that are resistant to logical or empirical challenges. " " Causal reasoning and belief perseverance " Craig A. Anderson, 1989. Cela étant dit, et je ne pourrais pas coucher ici tout ce que je pourrais avoir à dire ou redire sur tes productions, il me faudrait écrire sans doute un petit livre pour le faire, ce qui serait incongru et trop demandeur pour moi. Je vais donc fournir plutôt des pistes, peut-être pas de manière logique ou linéaire ou même un peu décousu par endroits, mais comme elles me reviennent à l'esprit au fur et à mesure, et même brusquement par moments: Je disais au-dessus que tu partageais une vision positiviste de l'Homme, même si je retiens le fait que cela peut contenir l'humanité depuis son avènement selon ton souhait, en effet, tu te positionnes sensiblement de la même manière que les économistes, en voyant l'humain comme naturellement rationnel, or tel n'est pas toujours/vraiment le cas, il y a des tas d'occasions pour que cela ne soit pas ainsi, ni individuellement, ni collectivement, et même à travers le temps qui passe ( Au même titre que la Terre a été détrônée du centre de l'Univers, que l'humain est une espèce comme les autres et non le sommet d'on-ne-sait-quoi, l'Homme n'est pas non plus maitre de sa raison ou en la demeure de sa propre psyché dans sa boite crânienne, toutes ses croyances ont été à tour de rôle battues en brèche ). Comme des auteurs le mentionnent, l'humain est mi-ange, mi-démon pour reprendre le vocabulaire de Frans de Waal dans par exemple " Le singe en nous ", et dans la même veine: " Le bug humain " et " Human Psycho "de S. Bohler, " L'Homme, cet animal raté " de P. Jouventin, " Pourquoi détruit-on la planète " de T. Ripol, " L'empire de l'erreur " et " L'empire des croyances " de G. Bronner, ou encore " Why smart people can be so stupid " par R.J. Sternberg, par exemples. Autrement dit, l'Homme est certes capable de brillantes choses, mais il est tout aussi capable des plus stupides ! Pour ma part, les vices corrompent les vertus, à l'image d'un poison qui rend impropre toute nourriture qu'elle soit joliment présentée, équilibrée, variée, en phase avec les standards nutritionnels, etc... n'y change rien, donc quelles que soient les qualités des êtres humains, un seul vice dénature et réduit à néant toutes ces soit-disant " belles " qualités, qu'une personne soit gentille, aimable, sociable, prévenante, altruiste, aidante, si par ailleurs elle est fourbe, malhonnête ou menteuse, les premières qualités perdent grandement de leur substance, on en revient à ce que j'essayais de faire comprendre à Sirielle, la différence fondamentale et essentielle entre " paraitre " et " être ". De plus et de manière concomitante, on ne peut pas non plus faire l'impasse sur la notion de normalité, car quand on juge autrui seul ou en nombre, on le fait nécessairement sur une base de référence, et bien souvent c'est par le comportement moyen vis-à-vis d'un groupe plus ou moins grand qu'on le fait, ce qui peut en soi engendrer la problématique non négligeable de l'endo-groupe mais je ne m'y arrête pas faute de temps et de place, prenons un exemple illustratif, si la personne qui procède à une évaluation se situe pour sa part dans cette même moyenne, en l'occurrence pour l'Intelligence telle que mesurée par le QI, de son point de vue spécial, elle va trouver que les humains sont en nombre " intéressants ", d'une part parce que 80% lui ressemblent ( à 2 écart-types près ) et que d'autre part, se situant au milieu, elle " verra " ou sentira qu'approximativement la moitié est " intelligente ", en revanche, si on se trouve, par la force des choses et non par choix, disons dans les 2% des personnes les plus intelligentes, aujourd'hui on parle volontiers de HPI, et bien, pour cette personne, les choses se présentent drastiquement différemment, en effet, pour elle 98% de la population est " bête " ou moins intelligente, de plus, elle se retrouve à la marge, elle peut difficilement se sentir " normale ", puisque par définition en-dehors de l'intervalle de normalité +/- 2 écart-types. Tout ceci pour dire, que ton appréciation optimiste sur l'Homme n'est pas étrangère à ta propre constitution d'une part, ni de tes connaissances globales d'autre part c'est-à-dire tant sur le versant positif ( brillant/progrès ) que celui négatif ( bêtise/stupidité ). J'en profite pour aussi rebondir sur ta perception entre toi et moi, puisque tu nous vois sur deux pôles, de mon point de vue, il n'en va pas ainsi, j'ai réfléchi à l'image qui serait la plus propice à te le faire comprendre, je pense que les différents plans d'organisation d'un être humain/vivant pourrait convenir, je pense que tu réduis ton approche tripartite ( " ton système " est un process, ce qui n'est pas sans conséquences, mais j'y reviendrai si je n'oublie pas en cours de route ) à celui d'une fonction comme la digestion par métaphore interposée, en faisant cela, tu oublies toutes les autres échelles d'organisation du corps humain, mais il n'est pas non plus à exclure, que sur la digestion elle-même, tu n'ailles pas suffisamment dans le détail, cela reste à un niveau fonctionnaliste ou utilitariste voire phénoménologique. Je trouve donc - et je m'en excuse à ton endroit - que ton approche est limitée/réduite intensivement et extensivement, en effet, de mon côté, je cherche sans cesse à aller toujours plus loin dans les détails, ou " les causes des causes " et toujours plus avant dans la synthèse globale ou l'interconnexion rationnelle de tous les effets, dit autrement et plus abruptement, je m'efforce d'avoir une vision la plus universaliste possible, et non pas comme toi systémique, qui plus est avec un seul et unique système en poche de ton côté, en somme, ce que tu proposes ici, est de mon point de vue, un sous-ensemble ou quelque chose d'inclus dans ce que je fais de mon côté, pour l'illustrer encore différemment, c'est comme si tu avais un dictionnaire pour le Secondaire en main, là où j'aurais Wikipédia avec moi, tu te rends compte que le premier est non seulement inclus dans le second, mais n'en est qu'une fraction, et qu'il n'y a donc pas de pôles entre nous, ce sentiment qui est né en toi, peut provenir du fait que je ne peux pas exhaustivement exposer tout ce que j'ai à l'esprit, ni comment je fonctionne entièrement, seulement des bribes en fonction des besoins/occasions dialogiques. ( Il fût un temps où j'ai aussi pensé que je pourrais émettre un Système, mais j'ai dû y renoncer quand j'ai contemplé la complexité du comportement humain, il ne peut être facilement réduit, il y a une kyrielle de facteurs tous plus prépondérants les uns que les autres, suivant les circonstances, le contexte ou la situation, ou encore ce que l'on cherche à faire en tant qu'acteur, ou selon ce que l'on cherche à expliquer en tant qu'observateur/témoin, etc... ) Ton modèle, même si je n'ai lu que rapidement les " 5 paragraphes " presque proposés de force, ne tient pas compte aussi, ni des motivations ou volitions ou encore pulsions humaines, ni même des sentiments ou des émotions, alors que depuis A. Damasio on sait l'importance qu'elles ont pour nos actions/décisions, et il n'y figure pas non plus, puisque le modèle proposé n'est que descriptif, vers quoi on doit ou devrait tendre, ce que nous devrions faire ou ce à quoi nous aspirons à devenir !? De plus et parallèlement, ce modèle si il peut rendre compte d'une certaine pragmaticité, ne rend pas compte des différentes conventions humaines, par exemples ce qui est Bienséant, ce qui est Moral, la Culture ou bien même la Justice, et ce, à travers les époques et les lieux... Ce que tu écris se retrouve dès lors extrêmement limité à expliquer par exemple l'invention ou la découverte, et encore unqiuement en terme de process, sans toutefois non plus prendre en considération d'autres perspectives que celle anthropocentrique à l'échelle de l'humanité et même egocentrique à l'échelle de l'individu, ni les conséquences du " génie " humain globalement par tous ces acteurs qui ne se concertent pas sur les implications de leur façon d'être et de réagir isolément/indivuellement. Prenons un exemple qui concentre une bonne partie de ce que j'ai distillé dans le pavé au-dessus, le comportement routier des conducteurs, si certes, la plupart du temps les gens arrivent à bon port, c'est la dimension fonctionnaliste ou utilitariste de ton projet, il y a d'autres aspects importants qui sont passés sous silence et même grandement délaissés par les usagers de la route, cela peut être la Courtoisie ou la Politesse/respect d'autrui, le Respect scrupuleux du Code de la route, tout comme pour des raisons de sécurité évidente - pour les initiées - du respect des Lois physiques et psycho-physiologiques, comme l'inertie et le temps de réaction. Il ne suffit donc pas de réussir, car en ce cas routier, il y a aussi des présuppositions dangereuses, comme de faire confiance à autrui ( prudent, attentionné, respecteueux, concerné, etc... ), présupposé qu'il n'y aura pas d'incident impromptu, que les choses du passé se reproduiront à l'identique présentement, que le régime stationnaire en roulant est similaire au repos, etc... Bref, les gens ne savent pas conduire même si ils pensent le contraire, en effet, tant qu'il n'y a aucun imprévu en cours de chemin, ils arrivent à destination, mais si une avarie se faisait jour, puisqu'ils n'ont prévu aucune marge de sécurité, ni les conséquences d'une éventuelle collision, ni la différence entre le statique et le dynamique, le moindre écart dans les conditions de roulage " habituelles " et l'accident plus ou moins fâcheux a toutes les chances de s'ensuivre, parce qu'ils ne comprennent que très sommairement ce qui se passe, ils sont mauvais sur bien des points par négligence comme par incompétence. Un dernier point et non des moindres, concerne le feedback, et qui constitue une faille importante dans ton Système, il y a pléthore de situations où il n'y a ou bien pas possibilité de retour d'expérience, ou bien le retour ne se fait pas au moment où notre cerveau peut en tirer parti ! Autrement dit, sans ce crucial feedback, il n'y a pas amélioration ou apprentissage possible. Par exemple, il a été montré, que si les informations suite à notre action étaient trop distantes chronologiquement, trop diffuses, non liées à nos expectatives, difficilement compréhensibles ou encore noyées avec d'autres, le feedback était inopérant, tout à l'inverse, si un évènement en suit un autre de près, qu'il y a concomitante ou cooccurrence, notre esprit avait la propension de les lier causalement, même si il y avait aucun lien de cause-à-effet entre eux. Il en va ainsi par exemple, du médecin ou du psychologue qui prescrit quelque chose à des patients qu'il ne revoit pas par la suite, il n'a alors aucun moyen de savoir si c'était de bons ou mauvais conseils. Ou encore, celle ou celui qui mettrait la main sur un élément conducteur sous-tension, il se peut que ce soit la seule et dernière fois qu'iel le fasse, comme cette vidéo où un type était monté sur le toit d'un wagon pour descendre des bagages, et d'un seul coup, il y a eu un arc électrique entre lui et la ligne électrique desservie au train, il a été foudroyé et calciné sur place. De même, le dérèglement climatique procède à cet aveuglement d'actions individuelles qui ont des effets massifs collectivement, sans concertation chacun fait comme " ça l'arrange " mais ce faisant, nous sombrons dans " la tragédie des biens communs ", parce que justement le feedback de nos actions individuelles égoïstes n'existe pas, où à un niveau d'abstraction préventif dont tout un chacun n'a cure car contrevenant à ses propres intérêts immédiats, focalisé que chacun est à optimiser ses actions, ses schémas mentaux en vu d'objectifs personnels. On peut aussi se questionner quand l'esclavage était présent, le patriarcat niant les droits des femmes, l'exploitation des enfants et aujourd'hui encore les travailleurs étrangers dans des fermes chinoises ou dans le bâtiment ou bien les travailleurs " du sexe " , ce qu'un " retour d'expérience " peut bien infléchir concrètement, en ces cas, nous n'apprenons rien, car tant qu'on n'y trouve rien à y redire, les choses resteront comme elles sont, tant qu'il y a des parties prenantes le statu quo sera recherché activement. Conjointement, il a été montré que si notre cerveau peut parfois détecter qu'il y a un shmilblic quelque part, une sensation intuitive disons, par exemple en cherchant une solution a un problème, notamment à travers le cortex cingulaire antérieur, les participants ont malgré tout fourni la réponse qui leur venait à l'esprit, bien que la sachant très certainement erronée, parce qu'il n'avait aucune autre aletrenative à proposer et ils ne voyaient pas comment trouver la solution. Comme je le dis de temps à autres: " L'humain préfera toujours une explication ad hoc comparativement à aucune explication du tout ", l'inconnu/incertain étant des plus inconfortable pour le plus-grand-nombre. On peut donc effectivement avoir une certaine conscience qu'il y a " un loup " mais agir ou faire comme si de rien en était, car incapable d'élucider la problématique correctement et la solutionner, toutefois, selon moi, le cas le plus fréquent étant à cause de l'ignorance, de mécompréhension et de surconfiance en soi, de faire preuve principalement de cécité cognitive ! Ce que tu proposes en filigrane est une autre façon de nommer/aborder l'adptation, et qui est commune aux autres animaux finalement. Tu penses/crois que la Science n'est que quantitative, mais ce n'est pas exacte, elle est aussi qualitative, par la force des choses un concept est par essence une entité qualitative, mais qui plus est, en Pyschologie par exemple de la Personalité, avec le fameux Big Five, on est typiquement dans le qualitatif, il en va de même pour l'étude des attitudes, des croyances ou du raisonnement ou de la cognition, ainsi que de la prise de décision, on peut certes en passer par des chiffres, mais l'investigation est orientée sur des qualités en premier lieu ! L'esprit scientifique est quelque chose que nous possédons tous à la naissance, mais qui est perdu pour la majorité des humains, à cause des différents éducateurs, à commencer par les parents, qui préférent un comportement conventionnel ou standardisé plutôt qu'un électron-libre prêt à tout remettre en cause à chaque instant, il y a donc un fort formatage, réduisant drastiquement les possibilités futures, de même qu'il existe une fénêtre temporelle pour acquérir ou conserver des facultés, nous condamnant à une réduction du champ des possibles, comme on peut s'en rendre compte avec " l'oreille musicale " ou bien pour l'apprentissage d'une langue étrangère, si elle se fait aisément étant tout petit dans un environnement adéquate, elle devient extrêmement laborieuse une fois adulte, et encore, pour les plus motivés d'entre nous quand elle n'est pas " obligatoire "... Comme tu pourras je l'espère le contater, à travers cette exposition succincte ou sommaire, que les choses sont autrement plus complexes que tu ne l'imagines, comme je me plais à l'écrire aussi ponctuellement: " La réalité dépassera toujours ce que quelqu'un aura pu imaginer à son sujet ". Pour finir, car je crois qu'il y a une certaine confusion dans ton esprit, que la Vérité et la Réalité sont deux concepts différents, pour agir nous n'avons certes pas besoin du vrai ou du faux, ce que nous faisons peut être sous-optimal ou optimal, approprié ou non, juste ou injuste, moral ou immoral, en revanche il est rare de n'avoir aucun schéma ou script a minima en tête, et la vérité aura trait au fait de savoir si ce que l'on rapporte de la Réalité est fondé ou non, c'est-à-dire en adéquation avec la Réalité, si oui, alors on dira que c'est vrai, dans le cas contraire, on dira que c'est faux, si on émet aucun rapport, alors la notion de vérité s'évanouit, quoiqu'il resterait le cas où on se parle à soi-même en son for intérieur, là on retombe dans le premier cas. J'ai des doutes sur l'effet constructif ou mélioratif de ce que j'aurais dit, car lorsqu'on ne possède pas, ne maitrise pas, ou on a une mécompréhension ou misconception, ou encore une connaissance épidermique des concepts évoquées ci-et-là dans mes exposés, alors le risque est très élevé de ne pas être entendu et compris comme il se doit, et donc que je fasse une énième fois comme qui dirait chou blanc... P.S.: je n'ai pas abordé frontalement " le cœur de ton système ", si je devais le faire, je posterais sur ton Topic je pense, toutefois l'approche générique/préalable opérée ici s'y applique complètement malgré tout.
-
Bonjour, je suis assez surpris de ces réponses, enfin disons que je ne m'y attendais pas, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Je préfère rester sur le partie publique pour le moment, même si on se retrouve plus en périphérie du sujet du Topic, sans pour autant s'en absoudre complètement. Disons que je peux entendre l'idée que dans le feu de l'action ou dans la vie de tous les jours, on soit cahin-caha amené à se contenter de l'approximatif et qui fonctionne a priori et a posteriori assez ou suffisamment bien. Nos capacités cognitives et autres ressources étant très limitées, il nous faut au quotidien trouver une solution palliative, j'en conviens, seulement voilà, nous sommes dans la rubrique Philosophie, et j'ai à cœur d'aller au-delà de la première idée qui vient à l'esprit ou celle à laquelle on adhère soit par habitude, soit par peur de se rendre compte que l'on s'est fourvoyé pendant des années et donc la crainte d'une blessure egotique, soit à cause de ce que l'on appelle " les coûts irrécupérables " en " psychologie économique " mais qui s'applique pour autre choses que des questions monétaires, en l'occurrence, d'y avoir consacré du temps et des efforts par exemple. Il est vrai que toute simplification du Monde n'est pas à exclure, je veux bien le reconnaitre, c'est possible sous diverses conditions qui sont rarement remplies de la part de madame-et-monsieur-tout-le-monde ! Voilà plus, là où se situerait essentiellement ma critique première. Néanmoins, il y a des cas où la perte ou la réduction d'information est préjudiciable à ce que l'on entreprend, il faut donc une bonne connaissance du sujet ou du domaine, ou disons une certaine expertise, pour savoir quand on peut se permettre de le faire et quand c'est problématique. Je t'ai parlé de l'effet Dunning-Kruger à un moment, et bien, il faut savoir que si pour la personne novice ou profane ou encore débutante, il lui manque des compétences, elle ne sera pas en mesure de juger qu'elles lui font défaut, parce qu'elle aurait besoin d'elle pour s'en rendre compte, ça c'est ce que j'ai déjà peu ou prou exprimé, mais cela va encore plus loin, c'est qu'elle est aussi incapable de reconnaitre ceux et celles qui les auraient ! Dans notre cas, si un individu se contente d'une ou deux idées préceptes et qu'il se trompe, il ne s'en rendra pas compte, si il ne maitrise pas son affaire, et il ne verra pas non l'autre individu qui lui sait plus et mieux que lui ainsi, il y a une sorte de plafond de verre intellectif qui le limite et où tout se projette sur la voute du plafond, n'y percevant aucune profondeur entre ses propres idées et celles meilleures d'une tierce personne, tout est pour lui au même niveau, ce qui constitue une grave erreur d'appréciation. Dit différemment un non-expert a toutes les chances de ne pas apprécier l'expertise qui se présente à lui, à cause de ses propres limitations ! Il n'est alors pas en capacité de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie... Le pressentiment ou plus exactement l'intuition, ne fonctionne que si elle repose sur justement une certaine maitrise préalable du domaine où on veut l'exercer, c'est vrai aux Échecs ou en Médecine tout comme parfois chez les pompiers professionnels qui ont de " la bouteille ", par exemple Anders Ericsonn dans un article " Expert Performance, its structure and acquisition " explique que grosso-modo pour avoir une certaine expertise de quelque chose, qu'il faut y consacrer environ 10 000h, à partir de là, on peut se fier à son intuition, dans le sens où elle fera - bien - mieux que le hasard. Ce peut être le cas dans nos vies sociales in fine, puisque nous pratiquons la socialisation depuis l'enfance et ce, du matin au soir, nous pouvons alors développer une certaine intuitivité de ce qui se trame, toutefois, elle peut être pervertie de plusieurs façons, entre autres, par un environnement pauvre, l'adhésion à une théorie naïve ou au réalisme naïf, une non-culture du scepticisme ou du doute, d'avoir un esprit que l'on qualifie de " Need for closure ", d'avoir un penchant pour l'autoritarisme, par exemples non exhaustifs. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'était un piège volontaire, mais on se retrouve là typiquement dans ce que l'on appelle le biais de rétrospectivité ou encore biais rétrospectif ( hindsight bias ), on peut effectivement connaissant la fin de l'histoire croire qu'en ayant le début que l'on serait capable de reproduire/trouver cette fin ! Je t'invite à lire l'excellent livre suivant, pour t'en rendre compte par toi-même: https://www.babelio.com/livres/Watts-Everything-Is-Obvious-Once-You-Know-the-Answer/1582386 Ou faire des recherches sur ce biais dans la langue de Shakespeare, dans la langue de Molière c'est en général bien plus limité, tant en nombre d'entrées qu'en qualité descriptive. Mais même sans aller en ce sens, tu l'écris toi-même, les nombres négatifs ne sont pas des nombres positifs, la soustraction n'est pas l'addiction sinon il n'y aurait qu'un seul mot pour les décrire, les nombres fractionnaires ne sont pas des nombres entiers, la multiplication est effectivement une réitération de l'addition, mais cette récursivité change tout, c'est plus qu'une simple addition, il en va de même avec la notion de " puissance ". Quand on s'intéresse un peu à l'Histoire des Mathématiques, ce qui est mon cas, on ne peut pas ne pas être étonné par la difficulté justement d'avoir découvert les nombres négatifs, ou encore le zéro, ou bien, l'écriture positionnelle des nombres, je souhaite bien du plaisir à quiconque voudrait faire une multiplication de deux nombres à 5 chiffres avec les chiffres romains ! On a du mal à s'imaginer le temps qu'il a fallu aux mathématiciens pour dégager toutes ces idées, qui nous semblent couler de sources, voire toute bête, on peut encore le voir, là aussi, si on s'intéresse à la psychologie du développement, et en l'occurrence l'acquisition des concepts mathématiques chez les enfants, à défaut, l'enseignement des notions évoquées à ses propres enfants, c'est loin d'être une sinécure ou une évidence ou couler de source ! Je ne pense pas en être capable, si j'y arrive, c'est que justement j'ai suivi une formation adéquate, en effet, quand on regarde les siècles ou décennies qu'il a fallu pour mettre en lumière certaines idées, on voit bien qu'il n'y a rien d'automatique ou mécanique dans ces processus, c'est même à la fois chaotique et cela demande des " révolutions " quand on avait choisir le mauvais paradigme au départ pour rectifier le tir, si j'ose dire. Il est évidemment plus facile de résoudre un problème quand on nous a inculqué leur résolution typique, que si on devait redécouvrir la méthode ou l'algorithme par nos propres moyens, nous ne nous en sortirions pas mieux que nos prédécesseurs, on ne peut bien sûr pas se permettre de passer sa vie à trouver par soi-même comment résoudre tel problème ou tel autre. Personnellement il m'a fallu presque trois ans, ne serait-ce que pour trouver un moyen de construire un pentagone régulier, à la règle et au compas, puis de démontrer que c'était valide en partant de rien ( aucune notion de géométrie en poche ). Encore une fois, le progrès est une affaire hautement collective, et ce, à travers les millénaires, même si il n'est alimenté concrètement que par un pouième de l'humanité à chaque fois, plus de 99,9% des humains ne font que se servir ou qu'utiliser ce que d'autres ont inventé, découvert ou fabriqué/construit ! Je me range volontiers dans cette majorité, ma propre contribution pour la société est nulle, et elle se situe à l'échelle d'un grain sable tout au plus, dans/pour ma propre existence ou tranche de vie. Nous avons là quelques raccourcis ou imprécisions, en rapport avec la métaphore que j'avais faite auparavant. Si Champollion a réussi avec la Pierre de Rosette à déchiffrer une langue inconnue, c'était justement parce que deux textes identiques dans deux langues différentes étaient côte-à-côté, à chaque mot en correspondait grosso-modo un autre, nous sommes alors très loin du cas de figure où on infère ou spécule à partir de 2 ou 3 mots une page entière ! Pour Enigma, c'est sensiblement pareille, à la différence qu'il a fallu d'abord comprendre le fonctionnement de la machine, ce que Alan Turin a entrepris en partie seul, mais avec le soutient d'autres mathématiciens, de plus ce n'est que lorsque un texte assez long non-crypté intercepté par les alliés et le même crypté réunis, que le " code " ( tournant ) a pu être " cassé ". Là encore, il a fallu que le nombre de mots soit assez important pour y parvenir, avec deux ou trois, cela n'aurait jamais abouti. D'une manière générale, en cryptographie, on estime que la clef de cryptage si elle est aussi longue que le texte à encoder, alors il sera parfaitement inviolable ou indécodable, il en va autrement si la clef est plus petite ou si tout ou partie de celle-ci a fuité, ou encore pire, si on réutilise la clef plus d'une fois, etc... Je ne suis pas manichéen, je suis ultra-rationaliste et hyper-sceptique, le tout accompagné d'une culture sur la Connaissance assez poussée, ce qui inclut l'Histoire des Sciences, tout comme l'Épistémologie, ou encore tout ce qui a trait à la Cognition en l'occurrence et principalement humaine, et donc par voie de conséquences, tout ce qui limite la Rationalité ou la Vérité, et là, c'est pléthorique ! Mais il est vrai que d'un point vue purement logique, si ce qui est dit n'est pas rigoureusement vrai, alors c'est faux, je peux malgré tout essayer ensuite de montrer où se situe l'erreur si la personne est assez ouverte d'esprit et réceptive à ce que je lui distille, ce qui est très loin d'être obvie ceci dit ! Toutefois je partage quelque peu les vues d'Aristote: " Nul ne peut complètement raté la vérité ", bien qu'à l'ère de la Post-Vérité ou du bullshit ( pipi-d'chat ), en particulier sur le Net, on puisse en douter sérieusement. Bien évidemment, ce que tu dis, est en réalité la façon dont fonctionne le progrès scientifique, par essais-erreurs et rectification continue, quoique de moins en moins de nos jours, car les grandes théories - surtout en Physique ou en sciences dites dures - sont suffisamment fiables pour pouvoir s'appuyer directement dessus, tant théoriquement qu'expérimentalement, ou encore sur leur applicabilité concrète. Toutefois, notre souci n'est pas tant de savoir comment fonctionne la Science aujourd'hui, mais de croire ou penser que nos congénères fonctionnent/fonctionneraient sur le même principe, en réalité, ceux-ci sont plus proches cognitivement ( processus cognitifs ) de ce qui se faisait au Moyen-Âge que ce qui s'est fait ne serait-ce que l'époque des Lumières juste après, et bien sûr, encore moins avec ce qui se fait de nos jours. Et bien si tu comprends justement que sur quelque chose de déjà plutôt bien défini, tout le monde ne peut pas y parvenir d'emblée, sans préparation préalable adéquate, il n'est pas difficile d'imaginer que c'est bien pire sur quelque chose de beaucoup moins bien palpable ou tangible et donc encore plus difficile d'accès et même - désolé pour la vulgarité - " casse-gueule ", on aura tôt fait de se prendre les pieds dans le tapis. D'autant que les croyances que les gens possèdent ne sont pas indépendantes les unes des autres, ils possèdent certaines entraves qui les détournent " du droit chemin " réflexif, de plus, la sur-confiance en ses capacités est également un gros problème, mais pas uniquement, en effet, quand une personne pratique un mode de pensée particulier depuis 10, 20 ou 30 ans, l'habitude sera difficile à briser ou enrayer, on voit bien avec quelle complication entre autres aux USA on essaie d'enseigner la Théorie de l'Évolution, en effet il y a conflit entre les croyances - religieuses monothéistes - qu'est le Créationnisme et ce que la Science à dire, ça bloque complètement, on voit qu'il y a d'autres enjeux dans la tête des individus que la Connaissance pure. Par exemple, la personne qui aura passé 10, 20 ou 30 ans à penser d'une façon, aura pris un certain pli cognitif difficilement dégauchissable, et d'autre part, il y aurait un enjeu énorme pour cette personne si elle devait en venir à se dire qu'elle a gaspillé autant de temps pour rien de concret ou fiable, il y a dissonance cognitive, et un risque important d'engager l'image-de-soi et donc corrélativement sa valeur à s'être fourvoyé aussi longtemps, la blessure egotique en devenir est/serait quasiment insupportable. Malheureusement, toutes les connaissances n'ont pas l'aspect normalisé de la mécanique automobile, loin de là. Comme dit aussi avant, les expériences intériorisées sur le monde perçu viennent en contradiction avec les idées contre-intuitives de la Physique, certes certains élèves peuvent réussir à résoudre le problème mathématiquement, mais sans en comprendre la teneur fondamentale ou les fondements physiques premiers, néanmoins cela n'ira pas en s'arrangeant avec le temps qui passe, on sait que les étudiants oublient rapidement leurs connaissances formelles très rapidement après la scolarité, ils en reviendront donc fatalement à leurs conceptions naïves comme le commun-des-mortels, leur pseudo-savoir-faire superficiel aura duré qu'une infime fraction de leur durée de vie, autrement dit, c'est négligeable. C'est en revanche la coopération ou l'interdépendance qui permet à tous ces humains, et ce sont les-plus-nombreux, de s'en sortir malgré leurs multiples incompréhensions ou mécompréhensions sur le Monde. Comme expliqué succinctement précédemment, les gens sont en prise aussi avec des croyances sur l'acquisition des connaissances ( epistemic beliefs ), e.g. comment on apprend en somme ou ce qui se passe/produit quand on le fait, je peux donner un exemple réel arrivé il y a peu pour illustrer la problématique, un collègue en formation avance avec certitude que pour tel savoir ( pas besoin de préciser ce que c'est ) que tous les collaborateurs le savent ou le sauraient facilement si on leur explique, pourtant lui-même en séance non seulement ne comprenait pas cette même chose, mais même malgré des heures d'explications, cela semblait encore lui échapper, il était donc en contradiction flagrante entre " sa théorie de l'apprentissage " et son application concrète en l'état l'invalidant, de par son propre exemple en temps réel ! ( et ça ne vient pas de moi uniquement, le formateur en était lui aussi dubitatif ) On est d'accord que c'est par l'action que les choses peuvent advenir si tant est que c'est possible, il faut donc essayer, et la plupart du temps, on a bon espoir de réussir, que cet espoir soit fondé ou non en raison est une autre question, des légions de mathématiciens par la passé se sont lancés dans la résolution de la Quadrature du Cercle ou de la Duplication du Cube ou encore de la Trisection de l'Angle ou bien même l'extraction de racines dans les Équations Polynomiales de n'importe quel degré, avant qu'un jour enfin plusieurs différents, on démontre que c'était parfaitement vain respectivement, il en va identiquement avec les bataillons entiers d'antiques chercheurs et de badauds plus modernes à tenter de produire le Mouvement Perpétuel, ou plus récemment dans notre Histoire, l'hypothétique " Moteur à eau " c'est-à-dire en circuit fermé sans apport d'énergie extérieure. Je passe mon tour pour le moment, si un tel Sujet a été ouvert et que l'envie me prend, peut-être y participerais-je, je-ne-sais-pas encore. En suspend donc... La biais d'illusion de connaissance ne concerne pas une chose inconnue que l'on chercherait à connaitre, mais des choses censément connues ou que l'on croit connaitre de notre quotidien, avec un haut niveau de confiance et pourtant il s'avère que l'on était loin du compte, que c'était bien une illusion et que notre confiance était mal placée. Il passe le même type de phénomène avec l'accès à Internet, si les gens ont par exemple un smartphone en poche avec une connexion vers le Web, ils se croient mieux sachants qu'ils ne le seraient sans cet appendice technologique à portée de main, quand bien même dans les deux cas, ils ne s'en servent pas pendant l'expérience ! D'un autre côté, il y a 2 sortes d'inconnus, selon la terminologie de N. Taleb, il y a un inconnu sage, c'est-à-dire le connu-inconnu - assez maniable - et un inconnu sauvage, qui est l'inconnu-inconnu, qui lui surprend tout le monde et prend de court, telle une crise qu'aucun économiste n'avait prévu, ou une future technologie qui n'existe pas encore, ou le carton national ou planétaire de telle chanson, etc... Mais je ne conteste pas qu'il faut bien tenter quelque chose si on veut faire bouger quelque chose, comme disait sieur A. Einstein, très approximativement: " Il n'y a qu'un sot pour croire qu'en refaisant toujours la mêmes chose, que le résultat sera différent ! " Malencontreusement, si dans le principe c'est très bien, concrètement ça ne marche pas toujours, ni pour tout le monde, y compris pour les chercheurs eux-mêmes, parce qu'il y toute une ribambelle d'autres facteurs et considérations qui peuvent faire capoter l'entreprise, par exemple le biais de confirmation se produit même pour nos plus hautes têtes pensantes, les chercheurs par exemple. En effet, le point le plus critique, n'est pas de faire coïncider ce que l'on croit déjà avec des expériences plus ou moins bien ficelées ou conçues, mais tout-à-l'inverse de chercher à falsifier ce que l'on pense ! " Subjects seem to be biased towards attempting to verify a conclusion, whether it is their own initial answer, or one given to them by the experimenter to evaluate. They seek to determine whether the premises could be combined in such a way as to render the conclusion true. Of course,this merely shows that conclusion and premises are consistent, not that the conclusion follows from the premises. The crucial test in combining premises involves falsification. " https://psycnet.apa.org/record/1973-08484-000 Ce qui est vrai pour le raisonnement, l'est tout autant pour l'expérimentation, se référer en ce cas à Karl Popper et son falsificationisme. C'est même ce qui permet de distinguer une pseudo-science d'une science selon Popper. Mais je reconnais que c'est toujours bien mieux que de s'en remettre à ses petites expériences personnelles de vie pour tirer toutes sortes de conclusions, disons hâtives. Je ne sais pas ce que cela " cache ", j'espère seulement que ce n'est pas sur une base psychanalytique, quelle que soit l'obédience, qui est du même acabit que la PP, il n'y a que ceux et celles qui s'y adonnent et y adhèrent sans réserve, le praticien et le pratiquant qui jurent que ça marche, on retrouve ce même état-d'esprit chez les membres des sectes, où les proches sont démunis pour leur faire reprendre raison. Ces gens-là ne doutent pas, c'est sans doute le plus problématique, comme je me plais à le dire de temps à autres: " Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ". Et pirement encore ou en amont, c'est qu'ils ne veulent pas savoir non plus, ce qui pourrait les faire quelque peu douter ou sourciller par ricochet, ils font preuve de ce que l'on appelle motivated blindness ( traduction libre: l'ignorance motivée ), c'est pourquoi, ils ne cherchent pas à prendre connaissance ni de près, ni de loin, de ce qui pourrait être un savoir conflictuel, comme j'en ai donné à plusieurs reprises l'occasion, dans le cas contraire, j'aurais sinon au moins eu des questions ou des demandes d'explications à ces sujets, ou simplement les liens de téléchargements ou des copies pour ceux introuvables ( là c'était volontaire de ma part, pour jauger à quel point le biais est présent ) , nada...
-
Bonjour @sirielle, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit car je ne ferais que me répéter, ni ne réponds à ta dernière intervention, malgré tout je pense avoir sans doute poussé le bouchon un peu trop loin, ce n'est pas la première fois que cela m'arrive par emballement ici ou Irl, pourtant je m'efforce à la base de m'adapter à mon interlocut·eur·rice, néanmoins on me rappelle régulièrement que " toute vérité n'est pas bonne à dire " - ce que je ne comprends pas vraiment, bien que je tente d'en tenir compte pour la tranquillité de mon correspondant, sauf " dérapage " comme précédemment, il faut croire que d'appeler un chat un chat quand on est une souris pose problème, je ne développerai pas ce point et qui plus est, ce serait hors-sujet. En revanche, je vais chercher quelque peu à aller un chouïa dans ton sens, même si il s'y glisse quelques bémols qui ne sont pas de " mon cru " ( documents entiers accessibles en téléchargement, tous deux lus ) : https://www.academia.edu/14127866/Some_key_differences_between_a_happy_life_and_a_meaningful_life https://www.researchgate.net/publication/11178883_The_positive_psychology_of_negative_thinking Serais-tu alors, aussi une " pessimiste-défensive " qui s'ignore - doublée d'une optimiste stratégique ?! ( question dite rhétorique ). Je te laisse juge si tu prends le temps de lire/de t'informer du dernier article supra. Le premier renvoyant quant à lui au dilemme que je t'avais déjà soulevé et que j'ai rappelé sur ce fil de discussions: objectivité versus heureuseté . Bonnes lectures éventuelles, D-U
-
Bonjour Sirielle, merci pour ta réponse. Je sens bien que ton approche est assez concrète/pragmatique, ce que je ne conteste pas en soi, elle est orientée disons côté applicabilité et utilité, plutôt que pour ma part j'en suis davantage vers une compréhension plus fondamentale et même causale, des règles que tu cherches à établir. Ce qui m'apparait encore une fois, c'est que nous ne posons pas le regard pareillement, si donc le Monde est telle/comme une immense pièce de Théâtre, tu en restes à la scène, là où je prends également en compte également le backstage, c'est-à-dire tout ce que l'on ne voit pas et qui pourtant explique ce que zyeutent les spectateurs - y compris les textes pré-écrits donc, ou même, vu que les gens de notre réalité sociale sont des comédiens, ce que les gens font, autrement dit, comment et pourquoi ils agissent comme ils le font, et pas seulement d'établir les règles apparentes/manifestes sans autre formalité. Ton appréhension est fonctionnelle, là où la mienne prend la dimension causale sous-jacente en plus, ce que tu te refuses certainement de faire jusqu'au bout, étant donné que pour toi, et nous en avons discuter longuement auparavant, l'humain possède un libre-arbitre, alors que pour moi ce n'est essentiellement qu'une sorte d'horlogerie particulièrement complexe, plus précisément un réseau avec des nœuds et des branches conduisant à des pensées, des attitudes, des prises de décisions ou des actions ou encore des comportements ! Je vais le présenter différemment peut-être, tu as un filtre spécial pour comprendre le monde qui t'est propre, mais malgré tout je te vois ou considère comme une normo-typique, à bien des égards tes écrits sont dans la même veine que mon ex-épouse et sa façon d'interpréter le Monde, tout comme les autres humains, cela reste prototypique. La résilience serait sans doute un concept plus à propos, tu pourrais si tu le souhaites le voir comme un ingrédient de la pensée/psychologie positive si tu veux, mais il n'y est pas propre ou réservé, et c'est pourtant lui qui permet de se sortir ou non d'une situation délicate, c'est-à-dire que le reste du florilège de PP est inutile pour faire face à l'adversité. Boris Cyrulnik en l'occurrence a beaucoup écrit là-dessus. Le lien que je t'ai donné et que j'ai rappelé à Ashaku un peu avant, qui fait mention d'une étude scientifique, est que finalement ce qui prime ce n'est pas la pensée positive en elle-même, mais que la stratégie employée corresponde ou est congruente avec l'inclination naturelle de l'individu, qu'est-ce que ça veut dire(?), tout bonnement que pour un pessimiste défensif il faut qu'il puisse appliquer la pré-factualité, son mode de fonctionnement privilégié, et en ce cas, des sentiments positifs adviendront, alors que si on le force à " positiver " il fera non seulement moins bien mais développera des sentiments négatifs, et réciproquement, l'optimiste qui peut user de sa stratégie préférentielle de contre-factualité se sentira bien, qu'il réussisse ou non d'ailleurs, mais que si on l'oblige à penser par anticipation à des alternatives comme le ferait le pessimiste défensif, il fera moins bien et développera corrélativement des sentiments négatifs, ce qu'il ne faisait pas en usant de sa méthode fétiche - qu'il ait réussi ou échoué ! L'espoir dans ce que j'ai écrit, est une " négation de la négativité " vécue, elle ne tend pas nécessairement ou forcément vers un but défini, mais ne reste pas bloquée/effondrée par la situation contraignante présente. Un désir ou une envie quant à elles auraient un objectif ou un objet défini, qui plus est positivement, il faut avoir à l'esprit que le contraire d'une négation n'est pas une/la positivité inverse, si je cherche à arrêter de courir vers le Nord, cela ne signifie pas que je vais courir vers le Sud. Espérer ne plus souffrir, ne nous dit rien sur une éventuelle direction à prendre ensuite, comme le serait effectivement une envie ou un désir à proprement parler. Celles et ceux qui ont résisté à la torture, tout en sachant que ce serait la mort qui les attendait, n'avaient pas de pensée positive en tête, seulement de ne pas trahir leur compères ou alliés, cette motivation a pu les empêcher de parler, quand bien même la souffrance devait être à son paroxysme, la motivation était entièrement tournée vers " ne pas faire de mal d'une quelconque façon à mes semblables/pairs/amis " en parlant. Pourquoi on échange avec autrui, il y a une foultitude de raisons en lice, des plus nobles aux plus perverses, en passant par celles socialement admises, dans telle culture. Étant des être éminemment sociaux, toutes volitions peut y conduire ou être le prétexte à cela, c'est virtuellement de l'ordre du besoin, au point même, qu'il a été mis en évidence que des enfants qui seraient privés de " câlins " en tant que nourrissons pouvaient en mourir, et que dans une étude ancienne avec des singes ou macaques, que le tout petit préférait se blottir dans une imitation en fourrure d'un congénère que de s'alimenter ! L'affection ou le lien social semblent donc extrêmement important pour tout un chacun. Cela peut servir ensuite à d'autre fins, une fois le " contact " établi si j'ose dire, tout comme le fait de pouvoir respirer nous permet de vaquer à autre chose, alors que ces autres choses seraient mis en suspend si l'oxygène venait à manquer pour une raison ou une autre. Je suis en partie d'accord avec toi, je te rejoins entièrement sur la primauté de " l'amour ", c'est ce que j'enseigne à ma fille depuis qu'elle est toute petite, c'est ce qui est de loin le plus important - à mes yeux également - une fois notre survie assurée. Pour l'honnêteté, nous ne nous rejoignons pas, comme dit antérieurement, ce n'est pas quelque chose que l'on maitrise parfaitement, que la personne se présente à autrui ou à elle-même avec cette aspiration, cela ne garantit aucunement qu'elle en fera preuve en tant voulu ou le cas échéant, il y a bien souvent un décalage, peu ou prou important entre son " moi idéal " et son " moi réel ", même moi qui suis pourtant un puriste extrémiste et exigeant, je faillis de temps à autres, je n'arrive pas à l'être parfaitement, quand bien même je le serais largement plus que quiconque pris au hasard, si je prends un autre trait, bien des gens se considèrent ou se voient comme faisant partie du côté de l'humanisme ou apparenté de la philanthropie, pourtant je ne peux que constater qu'un type comme moi qui se voit plutôt à l'interface avec la misanthropie, que je me comporte bien plus " humainement " que mes congénères qui eux se voient pourtant du " bon " côté du spectre, encore une fois, entre ce que l'on croit ou pense de soi-même et ce que l'on fait effectivement, ce sont deux choses très différentes, et comme dit auparavant, quand on est mis en situation de tentation, les choses ne se passent pas vraiment comme on l'avait avantageusement envisagé, ce que l'on pense à froid ou hors situation est bien différent de ce que l'on fera à chaud ou en situation, le cas de la coach adultère en était un exemple, bien que tu aies cherché à le justifier, son comportement au mieux est hypocrite au pire malhonnête, on ne peut pas prétendre une chose et faire le contraire, bien sûr si on a des œillères sur les yeux on peut tout réinterpréter favorablement, via la rationalisation morale notamment, ou encore via la compensation morale, c'est-à-dire je fais une bonne action ici et je me permets d'en faire une mauvaise là, dans la tête du protagoniste il y a une sorte d'équilibre des comptes, certainement moins pour les victimes ! C'est pourquoi il est essentiel de se sortir d'une perception et interprétation égocentrique, qui nous aveugle sur bien des points, dont l'un et non des moindres est celui du " bias blind spot " ( dit biais de la tâche aveugle ), où nous sommes enclins à penser que ce sont les autres qui sont biaisés et que soi-même on en est épargné, et ce, que l'on soit éduqué, intelligent ou même capable de prendre des décisions, ne change pas grand chose à y être sujet, plus spécifiquement, ceux ayant des habiletés rationnelles ( c.f.: QR ou quotient de rationalité ), ceux ayant des connaissances épistémiques fiables peuvent réduire quelque peu ou sont - modérément - moins sensibles à ce biais omniprésent, à l'inverse les personnes fonctionnant sur un mode plus intuitifs y sont elles plus promptes à être encore plus sujettes que la moyenne, moyenne qui est déjà fortement présente. Je ne dis pas qu'il est impossible d'être particulièrement attaché à certaines valeurs, c'est même l'inverse, les gens ont la manie de s'attacher ou s'engager drastiquement à certains paramètres hautement axiologiques, ce que j'appelle un Système de Valeurs, mais ils sont aussi tout-à-fait en mesure d'y sursoir si dans l'instant présent, il est plus profitable d'en faire fi, puis ensuite de se justifier au besoin, bien que en première instance sera tenté de cacher le méfait ou le fait d'avoir contrevenu à la valeur. Les gens sont particulièrement doués pour se justifier et même argumenter, c'est d'ailleurs pour certains auteurs la raison d'être du langage, de mettre de l'huile dans les interactions humains et conserver la coopération. Pour ma part, je mets la Vérité au-dessus de tous les autres principes et ce en toute circonstance ou cas de figure, ce n'est pas le cas de tout un chacun, même dans des classes scientifiques, quand on interroge les motivations des étudiants, la vérité ne représente au mieux que 10% des réponses, et encore parce qu'elle était sur une liste à choix multiple, et de même, elle n'est jamais mise en tête de sélection mais bien plutôt l'une des dernières citées/envisagées ! Et d'un point de vue plus psychologique, les problèmes identitaires prendront facilement le pas sur cette même vérité ( " accuracy " ), à cela se rajoute, des considérations egotiques, comme l'intelligence, l'image de soi et sa moralité, si la soit-disant vérité vient compromettre l'une de ces trois instances egotiques, alors, la personne cherchera à s'en défendre, à nier, à se justifier, à détruire l'émetteur de vérité, etc... tout sauf à reconnaitre que c'est vrai et même si ça l'est effectivement, il y a pléthore d'études qui le montrent différemment. Tant que l'on n'est pas en mesure ou prêt à reconnaitre cet état de fait, alors on participera soi-même au phénomène ! Comme je le dis à ma fille, ce que les gens semblent être ou ce qu'ils souhaitent montrer ne reflète pas leur vraie nature, ils préfèrent largement donner l'impression de, plutôt qu'être - réellement/effectivement, ainsi ils en ont les avantages/bénéfices - sociaux - sans en fournir les efforts ou en payer le coût... Nous vivons dans un monde emplit de miroirs aux alouettes ! Qui plus est, on confond aisément gentillesse ou sociabilité, par effet de halo, avec les vertus comme l'honnêteté et l'alètheia ! Pour finir, puisque le Topic traite de la quête du bonheur ou bienêtre à travers la PP, c'est que les facteurs réels qui favorisent effectivement un accroissement de bonheur ou y contribuent, sont non seulement peu nombreux, mais qui plus est, avec un effet modeste voire très modeste, les quelques uns n'ont pas de lien de parenté avec la PP. Je dirais qu'être naturellement, c'est-à-dire sans se forcer ou jouer la comédie, altruiste est un bon moyen d'être plus heureux, en particulier en venant en aide aux autres, un autre serait de cultiver l'humour et les parties de rigolades et donc de sourire bien que la durabilité de l'effet n'a pas été démontré. Selon une méta-analyse rigoureuse rapidement présentée ici ( article ou revue payante, lu pour ma part ) : https://stm.cairn.info/magazine-cerveau-et-psycho-2025-5-page-60?lang=fr
-
Bonjour @ashaku les faits - sur les " points de détails " - évoqués précédemment ne sont pas faux en l'état, en revanche les explications fournies ou les sous-entendus sont plus problématiques, parce qu'ils reflètent une façon d'appréhender le Monde qui est avant tout plus une projection psychologique, qu'une simplification adéquate de celui-ci. Je vais tenter de remettre un peu d'ordre dans ce qui a été écrit, mais ce ne sera pas une mince affaire, puisque reflétant aussi un style cognitif dont on ne peut pas se débarrasser par décret de la raison, ou même par la seule volonté. ( Mes analogies antérieures ayant été quelque peu dévoyées pour retomber sur ses pattes nonobstant: à nouveau le raisonnement motivé qui fait son œuvre ). Commençons par le dicton populaire: " Celui qui peut le plus, peut le moins " On peut le retraduire aussi comme ceci: Les personnes très intelligentes peuvent résoudre des problèmes très difficiles, comme des plus faciles, réciproquement les personnes peu intelligentes peuvent sans doute résoudre des problèmes faciles, mais peu vraisemblablement des problèmes difficiles, et encore moins des très difficiles. Ou encore dit différemment: Un esprit complexe verra le Monde de manière compliquée, là où un esprit simple (ne) le verra (que) simplement ! Réduire le Monde le plus simplement, on utilisant le moins de concepts explicatifs possibles, se trouve à l'extrême chez les croyants religieux, on effet pour eux, le principe unique source de toute chose est Dieu. Mais même en étant un peu moins extrême dans la simplification, en abordant par exemple les choses par domaine de connaissances, on peut avancer aussi qu'une ou deux idées claires peuvent faire l'affaire, pourtant n'importe qui qui s'arrête un instant sur n'importe quelle connaissance scientifique reconnaitra aisément qu'un spécialiste de son domaine connait d'innombrables concepts différents et qu'il faudra un temps considérable pour les acquérir puis de s'en servir correctement pour progresser, dans le cas contraire on ne comprendrait pas pourquoi il faut autant d'années d'études supérieures et que la Connaissance s'accroit constamment en découvrant ou inventant de nouvelles idées/lois, à ne pas confondre avec " l'insight " ou Eurêka qui donne à voir ou entre-apercevoir l'éventuelle solution, mais pour laquelle il y aura un énorme travail de réflexion derrière pour s'assurer que ce n'est pas une illusion ou erreur, cette dernière étape pouvant être très énergivore et chronophage, y compris pour plusieurs individus, il est courant en Mathématique d'avoir des conjectures, d'expression pourtant simple et, qui résistent pendant des dizaines d'années ou des siècles ! E.g. La conjecture de Syracuse. Prenons un cas illustratif, j'aurais beau me donner une certaine quantité de nombres entiers et la Loi d'addition, tout en les connaissant bien, je ne pourrais pas faire grand chose qui aurait à voir avec la Mathématique dans son ensemble, et même non plus, avec la seule sous-branche de l'Arithmétique, même dans ce dernier cas, on serait encore très loin du compte ! Toujours en lien avec les mathématiques, mais disons appliquées, si je n'ai que deux paramètres sur lesquels " jouer ", je peux construire au mieux une courbe polynomiale qui ne sera autre qu'une droite, mais si le problème que j'essaie d'aborder quant à lui se présente comme une quadratique, mon appréhension linéaire de cette courbe " en cloche " sera pratiquement toujours inadaptée, sauf au point tangent considéré, dans tous les autres cas, il y aura forte divergence entre la réalité et mon modèle simplifié explicatif. Je peux faire une autre métaphore qui ne repose pas sur les maths, et qui illustrera mieux l'aspect projectif de la pensée, prenons un livre écrit en langage naturel - pars forcément notre langue maternelle, si je l'aborde seulement avec comme seule grille de lecture, deux ou trois mots présélectionnés avant sa lecture, et que j'essaie de le lire uniquement avec ces 2/3 mots, je n'accèderais à aucune compréhension du livre, seulement à des inférences puisque 99% du contenu ne me serait pas accessible, et même en se limitant à une seule page, la problématique resterait entière, je devrais deviner le sens en repérant que les 2 ou 3 mots sur la page éparpillés ci et là, là également j'en serais réduit à faire des spéculations pour reconstruire le contenu qui m'échappe, ce n'est donc pas tant le contenu du bouquin auquel j'accéderais mais le sens que je donne à partir des éléments qui venaient de moi et non du livre lui-même, je projette mon filtre sélectif - les 2/3 mots en poche - sur la réalité pour la sonder, rien ne garantit que les mots choisis étaient les plus pertinents, et bien évidemment, ils n'étaient pas assez nombreux pour décoder convenablement le contenu, il en irait de même si ce livre était écrit dans une langue parfaitement étrangère pour laquelle je ne possède en tout et pour tout que 2 ou 3 mots de vocabulaire, si tant est que ceux-ci soient bien de cette langue-là ou correctement orthographiés, rien n'est moins sûr ! On voit bien dès lors, que lorsque nous interrogeons la Réalité, nous ne le faisons pas n'importe comment, et à cause de cette manière de faire, ce qui est en nous est utilisé pour questionner le Monde, qui lui-même peut être composé différemment et avec une richesse, ou plutôt une complexité, que nous n'avons pas. Prenons une autre explicitation métaphorique de ce qui se trame dans nos cervelles, et que l'on peut comprendre en le rendant encore plus saillant, supposons que je veuille réparer ou entretenir mon véhicule, et pour ce faire, que j'y aille avec 2 outils, un tournis d'électricien et un marteau de tapissier, on sent bien que les interventions que je vais pouvoir faire seront très limitées, en particulier aux choses les plus accessibles et de surcroit, les plus simples, en aucun cas, je ne pourrais aller au cœur du moteur, accéder aux éléments essentiels, je resterais en périphérie, ne pouvant bricoler que les parties périphériques et qui ne sont pas fondamentales au fonctionnement du moteur. Tout-à-l'inverse, une personne largement plus préparée et compétente, vient avec une grosse caisse à outils, voire même une servante, elle va de son côté pouvoir faire bien plus de choses, et ce, de manière bien plus approfondie, néanmoins, si elle s'absente et que la première fait soudainement son apparition avant même d'avoir entamé une quelconque intervention, quand bien même cette fois-ci, elle serait bien équipée, si elle ne possède aucune connaissance mécanique, elle ne sera pas beaucoup plus avancée, il lui manque les compétences " savantes " - ici techniques - et le savoir-faire qui va avec, elle pourra essayer si elle est motivée de se servir des outils, mais on sent poindre un risque non nul, qu'après démontage, elle ne sache pas remonter ou si elle y parvient en n'ayant sans doute rien résolu en chemin, retour à la case départ. Toutefois, aux yeux du mécanicien aguerri, l'autre personne ferait peine à voir, malhabile qu'elle est et qui ne se rend pas compte de son état d'incompétence. J'espère qu'avec ces quelques illustrations, que l'on puisse mieux se rendre compte qu'une poignée d'idées ou concepts en poche, est très insuffisants pour appréhender la complexité du monde et même de notre quotidien, et ce qui est vrai pour des objets ou abstractions, l'est encore plus pour se saisir d'un être humain, encore plus complexe. Nous avons chacun de nous un besoin cognitif de résorber l'inconnu ou l'incertain, dans le cas contraire, il s'installe un malaise qui se doit d'être résorbé, cela prend racine dans une peur primale et qui a pour corolaire de nous pousser à contrôler ou au moins avoir l'impression de contrôler notre environnement, d'où ce besoin de clarification intellectuel, de donner du sens, de rendre intelligible ou plus certain ce qui ne semble pas l'être de prime abord. Mais comme le Monde lui-même est extrêmement complexe, bien au-delà de nos facultés individuelles et même collectives, nous sommes amenés par la force des choses à le simplifier, en effet, si on voulait embrasser cette complexité qui nous dépasse le Monde nous semblerait inintelligible ou incompréhensible, ce qui provoquerait un trouble en nous, du coup, nous le simplifions pour que nous ayons le sentiment qu'il soit intelligible, ou bien plutôt, qu'il fasse sens avec notre rationalité limitée. N'étant pas tous égaux sur l'appréhension de la complexité de la Réalité, certains vont donc l'over-simplifier pour qu'il soit entendable, dans le cas contraire il ne le serait pas et provoquerait un malaise, c'est donc une astuce de notre cerveau que de procéder ainsi, elle permet de restaurer une certaine stabilité affective mais au prix ou au détriment de la compréhension effective ou plus exhaustive a minima. Celles et ceux capables de résister à cet inconfort et qui plus est, seraient mieux armés pour faire face à la complexité de par leurs connaissances fiables acquises et leur faculté intellectuelle affutée, seraient plus à même, de ne pas céder trop rapidement et facilement à la simplification excessive - on appelle cela faire preuve d'esprit-critique. En effet, il a été montré, que nous sommes pour la majorité d'entre-nous victimes ou sous le joug de l'illusion de connaissance ou de compréhension plus exactement, et un des moyens pour la mettre en évidence, expérimental, a été de demander à des participants de décrire un certain nombre d'objets du quotidien, aussi bien très familiers comme moins courants, à la première étape, la plupart ont fait preuve d'une sur-confiance dans leurs capacités - à travers un premier questionnaire auto-évaluatif, en expliquant simplement les choses et ce, très superficiellement, incomplètement et imparfaitement ou encore erronément, par exemple, le fonctionnement d'un vélo ou d'un " WC ", puis un expérimentateur les a ensuite interrogé sur ce qu'ils avaient noté antérieurement, c'est-à-dire d'expliquer le fonctionnement et si cela était suffisant pour en rendre compte, à chaque fois qu'une faiblesse apparaissait dans l'explication, le participant devaient ( i.e. étaient fortement incités, et donc non-spontanément comme ils ne le feraient pas Irl ) se creuser les méninges pour essayer de combler la lacune ou la faille explicative questionnée, une fois cette deuxième étape faite, ils ont à nouveau estimé leur niveau de compréhension, qui a été revu à la baisse, finalement, une explication fût donnée par un expert qui est venu leur parler avec des dessins en vue éclatée des composants des objets et comment tout était articulé les uns avec les autres, les participants ont pour la troisième fois noté leur - propre - niveau de connaissances, qui cette fois-ci est retombé au niveau qu'il aurait donné eux-mêmes à un novice - c'est-à-dire qui n'est pas eux-même ! Si donc, pour de " vulgaires " objets nous avons déjà autant de difficultés à estimer notre " niveau d'expertise " réel, que dire, sur quelque chose d'encore plus insaisissable ou immatériel que notre fonctionnement intellectif ou nos processus cognitifs !? Les gens ont aussi des " croyances épistémiques ", autrement dit, comment fonctionne notre esprit pour acquérir des connaissances et sur la compréhension des Connaissances elles-mêmes. Bref, on le voit assez nettement, la sur-confiance des novices/profanes, dans l'effet Dunning-Kruger par exemple. Pour le dire plus crûment, si un dépressif projette son humeur noir sur la Monde, lui donnant l'impression tenace que ce même monde est sombre, il en va strictement de même avec un " esprit-simple " qui projette son appréhension over-simplicatrice tout en croyant que ce même monde fonctionne simplement, avec de surcroit une forte tendance à la sur-confiance en soi et en sa compréhension - simplifiée, bien que très mal fondée. Par exemple, il a été montré aussi, que si des idées nous venaient facilement, rapidement et sans effort à l'esprit, alors on avait la fâcheuse et forte propension à considérer ces idées comme vraies, en l'occurrence, il suffit qu'elles soient habituelles, familières ou qu'elles aient été répétées ou " primées " pour que cet effet se fasse jour, or la fluence - ou sensation de fluidité - n'est pas du tout gage ou un moyen sûr/fiable de véracité ! ( C.f.: sensation méta-cognitive ) Si aujourd'hui la Science s'oriente vers l'interdisciplinarité, c'est justement parce que l'on a pris conscience de ce fait, l'hypocognition ( savoir presque rien sur presque tout ) et l'hypercognition ( savoir presque tout sur presque rien ) sont des écueils à contrer, pour mieux se saisir de la complexité inhérente du Monde, y compris celui très réduit du monde social dans lequel on baigne du matin au soir...
-
Bonjour @ashaku, il y a, je le reconnais, des interrogations et des remarques pertinentes dans ce qui a été répondu, il faut aussi que je prévienne qu'il s'y immisce d'autres considérations, et qui ont/auront un poids prépondérant dans la réflexion, comme l'état d'esprit avec lequel on aborde nos problématiques, à savoir un esprit scientifique ou non, ainsi que des présuppositions ou des préconceptions gardées silencieuses, des connaissances savantes insuffisantes ou pirement des méconnaissances/mécompréhensions, entre autres choses. Commençons par l'analogie avec le médicament, bien évidemment et encore, ce n'était pas tant le fonctionnement intime qui était mis en avant, mais notre faculté de juger l'éventuelle efficacité d'un " traitement " quel qu'il soit, néanmoins, à moins d'être un fervent défenseur du dualisme cartésien, le corps et l'esprit ne font qu'un, le dernier étant une des manifestations du premier, en l'occurrence via l'activité des neurones, il n'y a donc pas à proprement parler, d'un côté les phénomènes physiques/biologiques et les phénomènes psychiques de l'autre, c'est complètement entremêlé, à tel point que le corps influe sur l'esprit/cognition ( e.g. la psychologie incarnée ), et réciproquement ( c.f. l'humeur ou via l'amorçage i.e. " priming " ). En préambule, et synthétiquement pour illustrer schématiquement de quoi il en retourne, je dirais que: La psychologie positive serait à l'humeur, ce que l'effet Larsen est à la musique, à partir de virtuellement rien du tout, il se produit effectivement un effet ! Je vais d'abord commencer par un cas miroir de la PP, qui en lieu et place de produire du bienêtre, produit du malêtre, à partir là aussi d'une croyance, ce qui permettra de se distancier un temps du cœur du problème et qui conduit à une forme de réactance par ricochet. Il s'agit des personnes dites " électro-sensibles ", si on les écoute attentivement, elles sont totalement persuadées et convaincues elles aussi, que en l'espèce les OEM sont la cause de leurs symptômes, pourtant, cela est contradiction avec les résultats scientifiques qui n'ont jamais rien démontré de tel, mais également avec les phénomènes électro-physiques, en particulier, un seul conducteur traversé par un courant produit un champ magnétique certes, sauf que dans le cas des installations électriques, le conducteur de Phase est mis dans le même conduit que le conducteur de Neutre, qui quant à lui, est traversé par un courant de même intensité mais de " signe contraire ", dit autrement, il y a deux champs qui sont produits simultanément mais avec des caractéristiques parfaitement opposées, ce qui a pour résultante conjointe qu'il n'y a finalement aucun champ produit quand ces deux conducteurs sont mis en parallèle l'un de l'autre, ce qui est toujours le cas pragmatiquement, c'est pourquoi un électricien qui veut mesurer le courant électrique dans un circuit doit absolument mettre sa pince ampèremétrique sur un seul des conducteurs actifs, si il prend les deux en même temps, il trouvera zéro comme valeur ! De même, des expériences en double-aveugle ont été conduites sur des électrosensibles, soit en leur faisant croire qu'ils étaient dans une pièce " sous-tension ", soit à l'inverse la mettre sous-tension mais en leur donnant l'impression explicite qu'elle était hors service, et bien, comme avec nos sourciers précédents, les personnes qui se croient ou considèrent électrosensibles, ne sont pas en mesure de faire mieux que le hasard pour savoir si une pièce est électriquement active ou non, en effet, certains ressentaient les symptômes alors que l'installation était inerte, et inversement, d'autres ne ressentaient rien avec une installation électriquement active ! D'où l'on voit que la subjectivité a ses limites quand il s'agit de démêler le vrai du faux, ce que la personne croit n'est pas forcément la Réalité, mais seulement une interprétation personnelle et donc subjective de cette réalité, et qui peut avoir ou être accompagné malgré tout d'effets bien réels quant à eux ( auto-sabotage, impuissance apprise, effet de halo, etc... ), mais sans connexion causale réelle/effective avec ce qui est envisagé dans les explications par les personnes/protagonistes engagés dans la croyance. Il est vrai également, que tout un chacun possède de nombreux filtres, tant perceptifs que cognitifs, ce qui effectivement conduit à interpréter différemment la même chose, si cela n'est pas trop contestable quand il s'agit d'un roman ou d'un film, il en va autrement quand il s'agit des phénomènes naturels, y compris psychiques donc. En effet, il n'y a pas de différence de nature entre expliquer/comprendre la gravitation, une horloge, un ordinateur connecté à Internet ou la cognition humaine, tout cela repose sur le même fondement scientifique sous-jacent: le positivisme ! Qui n'a lui trop rien à voir directement avec la pensée positive, puisque ayant pour objectif le bonheur ou le bienêtre, et non pas que seule l'appréhension scientifique est digne de confiance pour rendre compte du Monde et des phénomènes s'y déroulant. La réflexion est un peu comme faire de la cuisine, si on prend le temps d'y songer ou de le méditer assez longtemps, en effet, le résultat final dépendra là-aussi, de la quantité et du nombre d'ingrédients, de leur qualité, ainsi que des modes opératoire. Si la personne qui pense ne met qu'un ou deux éléments, disons importants pour elle, et qu'en plus, ils sont de qualité douteuse, tout en procédant sans méthode rigoureuse ou seulement intuitivement, alors le résultat sera très décevant, au moins au regard, d'un autre individu, qui lui, aura pris soin de mettre plus d'ingrédients au départ et de bonne ou de grande qualité individuelle, le tout en procédant avec prudence, par exemple en respectant l'esprit-scientifique, il obtiendra quelque chose de bien meilleure facture à la fin. Notre souci, c'est que les gens ne sont pas capables ou en mesure de faire de telles comparaisons quand il s'agit de leur propre réflexion, puisque c'est justement avec elle qu'ils réfléchissent, si ils l'utilisent aussi pour l'évaluation de la réflexion qu'ils ont effectuée, ils n'y trouveront trop rien à y redire, puisque manquant des outils adéquats pour le faire, comme on peut le voir par exemple sur une Dictée, on aura beau demandé à l'individu de se relire ou tout ce que l'on voudra, il ne verra pas où est-ce qu'il faute ! Il faut donc au préalable acquérir certaines connaissances, en particulier épistémiques, dans le cas contraire, on ne sera pas compétent ou on sera inhabile à percevoir ou prendre conscience de ses nombreuses failles ou faiblesses. Ceci ne constitue malheureusement qu'un préalable, une condition nécessaire, mais elle n'est pas en elle-même suffisante malgré tout ! Par exemple, il a été montré, que le tout-venant ou même des premières années du Supérieur en Science Physique, commettaient sensiblement les mêmes erreurs naïves de compréhension, même si par ailleurs, les derniers étaient parfois capables de résoudre par le calcul le problème, quand ils donnaient les explications physiques, ils s'en remettaient autant à des théories naïves - issues de leurs expériences quotidiennes - mais erronées/fausses, ils n'arrivaient pas à surseoir à leur inclination naturelle intuitive, celle la plus ancrée en eux, alors que bien souvent les concepts scientifiques sont contre-intuitifs, ce qui complique drastiquement la tâche de compréhension, si tant est qu'elle est possible, si par exemple, on se heurte à des croyances antérieures " chéries " ! Les gens voient donc le Monde à travers un, ou un autre selon la situation rencontrée, caléidoscope, la question est alors de savoir, non pas si tel est le cas, puisque nous avons suffisamment de preuves pour savoir que c'est ainsi pour tout un chacun, mais si on peut quand même émettre des connaissances qui ne souffrent pas trop de ces biais, qui sont plus proches de correspondre à la réalité, au moins sur les relations de causes à effets, à défaut d'en saisir les causes premières, et bien, jusqu'à preuve du contraire, c'est uniquement la démarche/pratique scientifique qui répond au mieux à cette attente, toute autre approche a de fortes chances d'être des élucubrations, des narrations explicatives rassérénantes ad hoc, des théories naïves, des croyances qui taisent leur nom, etc... On le voit déjà très grossièrement avec la fable de " l'éléphant et des 7 moines aveugles ", il y a bien une Réalité, l'éléphant, et le problème concomitant de la justesse ou de la pertinence des rapports que l'on fait sur elle en tant qu'individu. Beaucoup oublis trop rapidement, que notre Intelligence est avant tout collective, sans elle nous ne serions/saurions absolument rien du tout, c'est pourquoi ce qu'un seul individu isolé ou une collection de tels individus peuvent bien dire ou interpréter, n'a pas grande valeur ou pertinence objectivement... ( par exemple, non encore lu: https://www.amazon.com/Knowledge-Illusion-Never-Think-Alone/dp/039918435X )
-
Bonjour, sur l'instant je n'ai pas su trop quoi répondre, il m'a fallu un certain temps avant de voir ce que je pouvais en dire, et ce, en passant d'abord par une réponse plus élaborée pour Sirielle. En effet, même si à première vue cela semblait correspondre à du bon sens, je vais monter qu'il n'en est rien in fine. Je m'excuse d'avance pour les sentiments et émotions qui risquent de s'ensuivre. je ne crois pas avoir dit exactement cela, j'ai plutôt dit que cela avait un côté auto-réalisateur ou auto-prophétique, problématique et que les soit-disant effets observés pourraient très bien s'expliquer autrement qu'en ayant recours à la pensée positive, d'autant que cette psychologie positive ne fonctionne qu'une fois au moins la tête sortie de l'eau, autrement dit, il faut aller suffisamment bien pour aller encore mieux, où l'on voit le cercle qui s'enclenche: " je " crois en l'efficacité de la pensée positive, " je " constate des évènements positifs, cela me donne une humeur positive, ce qui finalement renforce ma croyance en cette efficacité et ainsi de suite, simplement en chemin, on risque fort d'avoir manqué un certain nombre d'éléments de la réalité, qui effectivement, si ils étaient pris en compte, réduiraient ou même anéantiraient le cercle " vertueux ", d'où la tentation de se recentrer systématiquement sur le positif, au détriment de la justesse et de l'objectivité. Comme je l'avais déjà suggéré/énoncé @sirielle sur un autre Topic, à cause du biais d'optimisme, on arrive au constat suivant, quelque peu frustrant/déroutant/embarrassant: Soit on se complait avec le biais d'optimisme et dans ce cas, on bénéficie effectivement de retombées positives, comme une meilleure santé, une plus grande satisfaction dans la vie, un moral bien meilleur qu'un dépressif, etc..., mais au prix d'un manque d'objectivité patent. Soit on est du côté des dépressifs ou encore des pessimistes ( défensifs ), et donc avec un moral " dans les baskets ", une plus grande insatisfaction, une moins bonne santé probablement, mais en contre partie, avec une objectivité très supérieure à l'optimiste, en ce sens, que l'on essuie une réussite ou un échec, on reste lucide et équi-jugeant, contrairement à l'optimiste, certainement plus prompt au " self-serving bias " tout comme au " myside bias ", sans compté, une tendance marquée à l'égocentrisme - à ne pas confondre avec l'égoïsme, ce qui n'est pas le cas, des deux premiers. En bref, soit on est biaisé mais " heureux ", soit on est ( plus ) " malheureux " mais lucide/objectif ! " However, defensive pessimists exhibited positive affect only in the upward prefactual condition as compared to all other prefactual conditions for defensive pessimists. In other words, defensive pessimists felt goodonly when they were able to use their preferred strategy and when they performed well. Optimists felt good regardless of performance outcomes. For both defensive pessimists, performancwe as significantly related to affect. However, when the difference between upward and downward counterfactual thoughts was entered into the analyses as a covariate, the relationship between performance and affect dropped to nonsignificance for optimists but remained significant for defensive pessimists. These analyses tentatively suggest that optimists may be better able than defensive pessimists to use counterfactual thinking to alleviate negative affect in the event of a poor performance. [...] Those using an optimistic strategy tended to deny having control over their performance when given failure feedback whereas they accepted control for their performance when given success feedback. In a similar manner, optimists may engage in downward counterfactual thinking when they fail, as an attempt to alleviate the negative affect that normally results from failure. In contrast, defensive pessimists should not deny control for performance more after failure than they would after success. " https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8939045/ Supposons un instant que la " psychologie positive " ( ou PP ) soit comme un médicament, à quoi faudrait-il s'attendre ? D'une part, il faut un point de comparaison/référence, en général, en médecine on compare avec un groupe contrôle qui serait quant à lui au moins soumis à un éventuel effet placebo ou de désirabilité sociale, ou autre, ce qui permettrait de mesurer le cas échéant une " plus-value " de la part du traitement. Dans notre cas, on pourrait même aller un tantinet plus loin, et se demander, si cette " psychologie " ferait mieux que le hasard, c'est-à-dire une méthode d'essais-erreurs quelque peu à l'aveugle, autrement dit, je joue jusqu'à ce que je gagne, tout en mettant l'accent ou le poids sur les réussites ( grâce a posteriori à la PP ), et en mettant en sourdine, en feignant l'ignorance ou en faisant peu ou prou l'impasse sur les échecs ( de la méthode de la PP ), d'une manière ou d'une autre importe peu, ce traitement assymétrique saupoudré d'une terminologie encourageante, autrement dit " positiviste " donnera l'impression que le schmilblic fonctionne, pourtant, tout repose sur des essais erreurs conduits de manière hasardeuse, et cela ressemble à deux gouttes d'eau à la " psychologie positive " moyennant le vocable qui-va-bien, si donc, on croit que " ça marche " uniquement par l'entremisse de biais perceptifs et évluatifs et même émotionnels et leurs effets, nous sommes donc bien là en présence d'une Croyance - la Positivité, puisque cela ne repose sur rien de tangible en fin de compte. Il y aurait une analogie ici avec une bulle de savon, qui de par sa surface irridescente nous impressionne, mais l'intérieur de cette bulle est entièrement vide, il en irait de même avec la psychologie positive, on s'impressionne de ce que l'on croit voir, percevoir ou détecter comme effet, mais son noyau épistémique serait évidé de substance scientifique, il n'y aurait pas de " cause " réelle, seulement un effet d'emballement, d'auto-complaisance ou d'auto-conviction, qui n'aurait pas d'autre fonction que de entretenir/maintenir/faire perdurer une humeur positive ! ( Un peu comme notre Système Éducatif scolaire qui produit au mieux des personnes performantes dans les tâches académiques/scolaires, sans trop de liens avec la vie réelle hors de l'École, il tourne à vide sur lui-même en quelque sorte. C.f.: Bryan Caplan par exemple ) Il faut bien évidemment comprendre ce qu'est la causalité ! Ce n'est pas parce qu'il y a un effet observé, et une cause avancée/soutenue, qu'il y a nécessairement une connexion réelle entre les deux, elle peut malgré tout être entrenue dans la tête de l'invidu qui fait de mauvaises inférences et déductions, tout en oblitérant un certain nombre de cas dérangeants, il en va ainsi avec le Paranormal, en général les tenants de ces pseudo-sciences à force d'être enjoints à démontrer ce qu'ils avancent, finissent par se réfugier derrière un " ça ne marche pas cette fois-ci, parce que vous - les zététiciens - m'observez ", mais grosso-modo, " quand vous n'êtes pas là, ' ça marche ' plutôt bien ", comme c'est bien commode, n'est-il pas !? En effet, quand on ne retient que les cas favorables ou qu'ils nous impressionnent au point d'être gardés en mémoire, et qu'on ne retient pas, ne prête pas attention, ou efface de sa mémoire les cas défavorables, peu " remarquables " car non expectés et donc non-impressionnants, on en arrive forcément à croire à à-peu-près-tout-et-n'importe-quoi ! Tel est le cas des sourciers, pourtant intimement eux-aussi convaincus de détenir un " pouvoir " - ou des magnétiseurs - quand bien-même il a été démontré que ce n'était que du pur hasard, le traitement assymétrique permettant de maintenir la croyance dans la tête des gens, aussi bien ceux s'en croyants dotés/affublés que ceux qui y font appel. Ah, c'est bien pratique ce raisonnement motivé ou ce biais de confirmation, on arrive ainsi toujours à ses fins, fondées ou non...
-
Bonjour Sirielle, je voudrais que tu gardes à l'esprit, un point essentiel, c'est qu'il n'est pas impossible que ton niveau de réflexion ou d'analyse, ou même ton approche de la vie, ne reflètent pas trop ce que madame-et-monsieur-tout-le-monde font de leur côté, d'habitude ou en général. Ce que tu dis ou comprends n'est pas forcément transposable à tout un chacun, non pas que tu aurais tort, mais que cela ne s'applique pas tout ou partie aux autres, que l'on ne peut pas en faire une généralité, seulement une spécificité relative à ta personne, bien que certainement juste, elle n'est pas en l'état transposable au-plus-grand-nombre, qui eux fonctionnement disons différemment, et sont l'objet plus spécifiquement de mes propos, d'où peut-être, une difficulté à nous rejoindre sur les conclusions, ce serait comme si l'un de nous regardait du haut vers le bas, quand l'autre regardait du bas vers le haut, ce que l'on a à dire diverge mais cela ne signifie pas pour autant que l'un serait nécessairement dans l'erreur et pas l'autre, nous ne parlons pas tout-à-fait de la même chose. C'est un point que je voulais effectivement aussi aborder, puisque le but ultime de la psychologie positive est le bien-être/Bonheur, on peut remarquer que ce n'est pas nouveau dans l'Histoire, les premières Philosophies antiques grecques, étaient toutes conjuguées avec une philosophie-de-vie, qui recherchaient le " souverain bien ", autrement dit le Bonheur. Et comme tu l'écris un peu plus loin, c'est une tendance naturelle, notre " corps " recherche le plaisir ou la jouissance et fuit ou combat la souffrance et les maux ou encore les entraves aux premiers - hédonistes. Toutefois, j'apporterais une nuance à ce que tu dis, ce n'est pas tant les " pensées positives " qui boostent la motivation à agir, supposément dans le bon sens, mais l'espoir, qui lui sera médié par les affects positifs, alors que la pleine-conscience qui est un élément essentiel de la psychologie positive, couplée ou non avec ces mêmes affects positifs ne produit aucun bénéfice mélioratif: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39212548/ ( article lu intégralement ) On trouvera un exemple historique au travers la biographie de Louis Zamperini: https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Zamperini " Après avoir été miraculeusement recueilli par un navire ennemi, Louis fut capturé et passa de longues périodes en captivité. La brutalité de ses geôliers et les conditions inhumaines de détention mirent à l’épreuve sa volonté de vivre. Pourtant, malgré les souffrances et l’humiliation, il ne perdit jamais espoir. Sa force intérieure et sa capacité à se relever après chaque épreuve devinrent légendaires parmi ses compagnons de captivité. " https://vexub.fr/video/67de3eb69c951 " Dans sa tête, l’espoir est la seule option possible. " https://www.out-the-box.fr/histoire-inspirante-louis-zamperini-lhistoire-dun-heros-invincible/ D'un autre côté, et tu t'en doutes certainement, cette fameuse psychologie positive a semble-t-il évolué, elle en serait à sa troisième mutation: Depuis sa création, la psychologie positive a connu plusieurs phases de développement : Première vague : Centrée sur l’étude des émotions positives et des traits de caractère positifs. Deuxième vague : Élargissement du champ d’étude pour inclure les aspects négatifs de l’expérience et leur rôle dans le bien-être. Troisième vague : Intégration de perspectives systémiques et contextuelles, reconnaissant l’importance des facteurs sociaux et environnementaux. https://www.ecoute-psy.com/blog/psychologie-positive-une-approche-scientifique-du-bien-etre-et-de-lepanouissement/ Peut alors se poser la question de savoir, ce qui distingue encore la psychologie positive de la Psychologie tout court à présent ? Si ce n'est que la seconde, cherche plus à résoudre des troubles, alors que la première cherche à aller au-delà: Figure 1 Représentation du continuum de -5 à +5 https://shs.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2017-4-page-22?lang=fr&tab=texte-integral Pendant que j'y suis, même si je ne connais pas particulièrement les travaux de Martin Seligman, mais un peu plus le travail de son compère Mihály Csíkszentmihályi ou plutôt d'un confrère comme Abraham Maslow, ce dernier ayant postulé la hiérarchisation des besoins, où l'épanouissement personnel se trouve dans le pyramidion d'une représentation non-historique/originale géométrique de pyramide, où les autres niveaux à franchir se font dans la " lutte " et donc principalement avec des affects négatifs à franchir ou à s'affranchir, la positivité serait dès lors l'achèvement de cette élévation, non ce qui le permet, il faudrait alors en passer d'abord par l'adversité et donc les ressources nécessaires pour atteindre les pensées positives elles-mêmes tout au sommet en tant que résultat, ce que l'on peut aussi voir dans le diagramme quelque part, au-dessus, en partant de la gauche vers la droite. Cela ne constitue pas nécessairement une contradiction avec ce que j'ai soulevé antérieurement, puisque en effet, tu le fais depuis si longtemps, régulièrement et de manière intrinsèquement motivée, il n'est pas étonnant que cela finisse par avoir un impact réel et durable sur ta vie de tous les jours, il y a certainement un effet de sélection entre tes pensées et tes actes, ainsi qu'une motivation à rester cohérente, il en irait de même dans n'importe quel autre domaine que la personne aurait envie d'accomplir, par exemple une passion quelconque, ou encore une conviction idéologique lambda, les actions et les pensées se renforçant mutuellement au fil du temps, tout en évinçant ou évacuant tout ce qui pourrait être/apparaitre dissonant. Par exemple, dans la psychologie positive, ce qui est recherché ce sont les affects positifs, tout ce qui pourrait y contrevenir est cognitivement travaillé pour ne pas remettre en cause leur raison d'être, afin qu'ils perdurent, quitte à en passer par la rationalisation, en fait, c'est le phénomène inverse de l'auto-sabotage, que ce soit l'un ou l'autre, on cherche à confirmer son état d'esprit, et donc à interpréter les évènements de manière compatible avec cette façon de voir les choses ou cette vision du monde, l'optimiste quand les choses tournent bien se dit que son mode de fonctionnement était " le bon ", mais quand ça tourne mal, il se dit que les choses auraient pu être pire si il n'avait rien fait, renforçant sa croyance dans son appréhension particulière du Monde, l'auto-saboteur quant à lui, se dit que quand les chosent ont bien tournées, que c'est un coup de chance, et quand elles ont effectivement mal tournées, que ça prouve ce qu'il pensait. Dans les deux cas, les théories tenues sont infalsifiables, parce qu'il y ait échec ou réussite, la même explication rend compte de ce qui s'est passé aux yeux du protagoniste. On trouvera matière à cogiter cela ici: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/026999398379484 ( article non lu en lui-même, un résumé ailleurs ) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8939045/ ( idem ) Paragraphe stategic optimism en milieu de page Où par exemple, on apprend que le pessimiste-défensif va utiliser un processus d'alter-factualité, là où l'optimiste va recourir à une contre-factualité et donc plus prompts à la rationalisation, au risque de perdre en objectivité, quand bien même il obtiendrait un résultat ou un effet bénéfique/positif comme son alter-ego pessimiste-défensif. Je veux bien croire que tu possèdes la force de caractère ou même la lucidité te permettant d'échapper aux écueils que rencontre le commun des mortels, qui eux sont assujettis aux contradictions suivantes: entre le pensé et le dire, et, entre le dire et le faire et donc également entre la pensée et l'acte, la majorité des gens que j'ai pu rencontrés, quel que soit leur niveau d'éducation ou d'intelligence sont incohérents ou inconsistants, ils ne disent pas ce qu'ils pensent ou réciproquement, ne font pas ce qu'ils disent ou inversement, tout comme il peuvent ne pas faire ce qu'ils pensent ou encore ne pas penser ce qu'ils font ! Je vais aller beaucoup plus loin que ce que j'ai fait jusqu'à présent sur ce sujet, je dirais même que ce qui nous gouverne essentiellement ou principalement ce sont nos peurs ! Bien sûr, celles-ci dans notre société globalement paisible et aseptisée se retrouvent à agir à l'abri de notre conscience ou de notre attention, même focalisée, je dirais en miroir de la psychologie positive, que 80% de nos comportements ou attitudes le sont à cause de nos peurs subconscientes et que les 20% qui restent sont des considérations conscientisées, dont les affects positifs et ceux négatifs mis dans l'espace de travail qu'est notre réflexion ou notre cogitation sur nous et le Monde. En effet, un moyen de s'en rendre compte, est par le biais des " rêves ", non pas du tout en un sens psychanalytique, mais par observation nocturne des rêveurs filmés, en particulier ceux qui n'ont pas l'inhibition motrice - pendant l'état de veille - fonctionnelle, que voit-on(?), et bien dans plus des deux tiers des cas, les gens luttent, se battent, insultent, se défendent, etc... pendant leur sommeil, autrement dit, quand on est éveillé au jour le jour, on ne se rend pas du tout compte, que notre " moi profond " est motivationnellement sans cesse en train de se préparer à toute éventualité de menace, qu'elle soit physique, sociale, identitaire, émotionnelle, etc... Voilà à quoi nous passons le plus clair de notre temps, sans même en avoir la moindre conscience, ni de près ni de loin, dans notre quotidien ! Si à cela, on rajoute ce que j'ai dit du sommet de " la pyramide de Maslow ", alors la positivité ne représente qu'un pouième de nos existences concrètement, pour ma part, je préfère donc être au courant de tout ça, la partie souterraine, plutôt que de m'affairer avec l'écume à la surface des vagues en lieu et place des vagues elles-mêmes ! Ci-dessous, le pessimisme défensif sous-jacent à ma réflexion présente : “Hope for the best but prepare for the worst.” https://7about.fr/le-pessimisme-defensif-ou-le-pouvoir-positif-de-la-pensee-negative/ https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/comment-un-pessimisme-mesure-peut-booster-sa-carriere https://nospensees.fr/le-pessimiste-defensif-anticiper-le-pire-est-il-toujours-un-inconvenient/ https://www.amazon.fr/Positive-Power-Negative-Thinking/dp/0465051391 ( livre non lu ) Si donc, l'inclination naturelle te semble la plus légitime, j'espère que tu sauras ouvrir ton esprit à ce que j'ai écrit juste avant, à la fois sur nos volitions existentielles les plus profondes tendues vers la résorption de nos peurs, ainsi que la hiérarchisation des besoins qui limitent drastiquement l'avènement à proprement parler d'une psychologie positive, qui n'est finalement que la cerise sur le gâteau dans notre processus fonctionnel, à moins de s'enfermer dans l'auto-prophétie/auto-réalisation via le biais de confirmation et le côté pervers de l'infalsification par la Raison de " l'optimisme-dur " aussi bien que pour l'auto-sabotage. Ce qui ne remet pas en cause ce que j'ai énoncé au début concernant la primauté de l'espoir, comme force motrice, et où les affects positifs ne représentent que la courroie de transmission ! Un pessimiste-défensif fait lui aussi preuve d'espoir, ce n'est donc pas réservé ou le monopole de la psychologie positive ! Si donc, pour une raison ou une autre la psychologie dite positive permet d'atteindre le bien-être/bonheur à un moment, on ne peut pas conclure deux choses, la première, que ce soit univoque, c'est-à-dire que seule la psychologie/philosophie positive conduirait au bonheur, en effet si de A je peux me rendre à B, je peux aussi partir de C pour arriver également à B, secondement, rien ne garantit non plus que partant de A j'arrive à coup sûr en B, je peux atterrir en D, dans notre cas, la psychologie positive ne garantit pas d'atteindre le bien-être ou le bonheur. Il y a donc d'autres moyens, comme l'insouciance de la jeunesse dans un cadre favorable pourrait aussi y conduire, tout comme, on ne peut être certain que ce soit systématiquement valable, tout le temps et pour tout un chacun, dans toutes les situations, je dirais que c'est plus l'exception que la règle dans la réalité quotidienne, bien que notre société soit particulièrement favorablement matériellement, organisationnellement et culturellement/idéologiquement vers l'obtention du bonheur, ou tout du moins, le plaisir sous bien des formes, puisque ce n'est pas si évident que ça de définir ce qu'est ou doit être le Bonheur, une des acceptations antiques étant l'ataraxie, loin de l'hédonisme ou la jouissance à tout va actuelle... Un changement est plus facile à imaginer qu'à produire, il suffit de voir à quel point chacun est réfractaire ou étanche à tout changement d'idée, ne serait-ce que lors d'une rencontre familiale ou amicale dès lors que l'on nous oppose une vision différente de la nôtre, n'importe quel chercheur en psychologie du " changement " en est bien trop conscient, au point de (re)chercher ce qui peut bien fonctionner pour que les gens changent, et il existe peu de méthodes un tant soit peu efficaces, et aucune ne fonctionne sans une bonne dose de motivation de la part de celui ou celle concerné·e par le changement, autrement dit, si la personne a " décidé " ou est convaincue ou encore engagée/militante d'une conception, elle n'en changera pas, quand bien même on lui présenterait des éléments forts contraires et des preuves affaiblissant son idée première, et ce jusqu'à complètement discréditer les " preuves " sur lesquelles elle s'appuyait pour élaborer ses pensées, en effet, une fois qu'une explication a été élaboré, elle devient autonome ou indépendante de ce qui lui a donné vie, ce qui signifie qu'une explication ou une théorie ne peut pas être facilement renversée, tant que la personne n'admet pas qu'elle puisse se tromper, puis qu'elle manifeste un désir personnel à se rectifier, ensuite qu'elle arrive à intégrer les nouvelles informations, enfin, qu'elle mette cela en application, sans effet de régression vers l'ancienne théorie ou appréciation, autant d'écueils en cours de chemin qui ne se résolvent pas du tout facilement, même si on peut le croire ou que l'on se plait à le penser, c'est autrement plus difficile que l'on peut l'imaginer. Pour preuve, la plupart des choses que j'ai pu t'expliquer depuis 1 ou 2 ans, n'ont pas eu tant d'effets que ça sur ta pensée, même si je reconnais qu'elle a évolué et qu'elle est très détaillée, cohérente, incomplète mais juste et même synthétique et multi-facette/riche, sincère/honnête.
-
Bonjour, c'est exactement ce que je disais précédemment, on est ici dans un raisonnement motivé, on n'arrive dès lors pas à faire la part de ce qui est très faiblement justifié de ce qui est fortement contre-argumentatif. Je vais le dire autrement pour que ce soit plus limpide, il est évident que la force de conviction que l'on a dans ceci ou cela, n'a strictement rien à voir avec son degré de véracité ou de pertinence, en effet on voit régulièrement des individus complètement persuadés d'idées mal assurées et même fausses, j'ai donné l'exemple de l'homéopathie, mais on peut songer aux platistes, aux anti-vacc, à la cartomancie ou plus prosaïquement aux sourciers et aux magnétiseurs, etc.... Il est vrai que nous sommes aussi rentrés dans l'ère de la Post-Vérité, où chaque individu se croit le porteur de Sa vérité ou de vérité alternative, tout aussi acceptable, légitime ou crédible que celle d'un autre, renvoyant à la doctrine philosophique du Relativisme, et à ce point on pourrait dire radical, comme son opposé le Cynisme qui stipule que l'on ne peut rien connaitre quant à lui. Ces 2 approches étant à éviter puisque conduisant à des impasses intellectuelles insurmontables, et de plus, en contradiction flagrante avec la Science moderne ou actuelle. Il est certes confortable et rassurant pour sa petite personne ( voire flatteur pour l'Ego ) de croire que chacun peut croire/adhérer à ce qu'il veut et que ça vaut aussi bien qu'une autre croyance/conviction, c'est simplement une démarche intellectuelle anti-scientifique par nature, ce que je ne peux certes absolument pas empêcher, mais seulement le dénoncer. Fût un temps, où certains hommes avant l'avènement de l'aviation ont crû qu'ils pouvaient voler en se collant des ailes artificielles sur les bras, dans leur cas pour les plus téméraires, c'est la mort qui les a attendus, fort heureusement la " psychologie positive " n'a pas intrinsèquement cette conséquence néfaste, c'est une croyance comme une autre qui est peu ou prou à la mode en ce moment, comme il y a un temps où les comètes étaient les annonciatrices de mauvais présages pour le-plus-grand-nombre, avec des conséquences sociales/sociétales non négligeables d'y croire. C'est ça qui est assez cocasse: que la croyance soit fondée ou non, elle a quand même des effets, quant à eux, bien réels, comme les anciennes chasses aux sorcières par exemple ! Ou encore dans le fameux phénomène de " l'effet placebo ", de croire en un effet escompté par anticipation produit réellement un effet en aval, quand bien même la substance ou l'activité elle-même est inactive ou neutre en amont, il en va similairement avec l'effet Pygmalion ou lors de l'impuissance apprise !
-
Bonjour @sirielle, n'y vois pas d'acharnement de ma part, je reviens ici pour donner quelques(2) exemples plus palpables de ce que j'ai soulevé au-dessus, c'est-à-dire de s'informer au niveau de la Recherche et pas seulement à-droite-à-gauche sur le Net ou dans la presse non-spécialisée ou pire encore selon son expérience personnelle, le premier lien ( article entier lu via un autre site ) est connexe au sujet traité, mais y est malgré tout parfaitement substituable pour un résultat/effet similaire, avec la présence d'un médiateur, le second ( non encore lu, en attente de sa disponibilité - gratuite sur un site ou un autre ) illustre quant à lui le côté pervers de la quête de bonheur inhérente à la psychologie dite positive: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20511389/ https://iaap-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aphw.70000


.thumb.jpg.6cece527af11f6c02a8e743f4bb6e330.jpg)






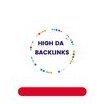



.thumb.png.4035479e7555c9218548656003194023.png)




