Histoire de la peinture chinoise

Les plus anciennes peintures chinoises retrouvées datent du IIIè siècle avant notre ère. L'existence, dès le XIIè siècle av JC sous les Zhou, d'une peinture représentant des souverains mythiques, des sages et des personnages exemplaires, n'est attestée que par les textes.
C'est sous les Han (206 av JC - 220 apr JC) que les témoignages deviennent plus significatifs ; la peinture murale et sur brique se développe. A la fin de l'époque Han, la calligraphie de style cursif apparaît comme art de l’écriture. Désormais, deux styles d'écriture sont appelés à coexister :
l'écriture "correcte", aux caractères clairs et réguliers

et l'écriture "herbiforme" au tracé spontané.

---
La peinture, à l'origine, s'identifie à un métier artisanal à visée décorative, historiographique, didactique ou religieuse. Elle acquiert un statut nouveau à l'époque des Six Dynasties, qui voit l'apparition, à côté des peintres artisans, des peintre lettrés ; ceux-ci appliquent à la peinture les ressources de la calligraphie. Cette évolution va culminer sous les T'ang. Pratiquée par l'élite politique, sociale et intellectuelle des lettrés, la peinture est alors très estimée.
Le premier peintre dont le nom nous soit parvenu est Gu KaiZhi qui s'est illustré à l'époque Jin dans la représentation des personnages, thème de prédilection de nombreux artistes influencés par l'humanisme confucéen puis par la pensée bouddhiste qui se répand en Chine sous les Han orientaux.

Il fut l’un des théoriciens de la peinture chinoise, déclarait que « la forme existe pour exprimer l’esprit ». Si le trait du pinceau en est le squelette, l’encre et la couleur la chair, le qi est bien la force vitale, souffle et sang, de la peinture chinoise." Le qi est dans l’acte de peindre mais aussi dans le tableau et le ressenti du spectateur. « Tout comme on doit être capable de suivre les mouvements tai chi, de leur amorce à leur terminaison, d’en admirer le développement, d’en voir l’apogée et de sentir qu’ils reviennent à une position de repos avant de débuter un autre mouvement dans une autre direction, on doit être capable devant un tableau chinois de suivre la course du qi, même lorsque celle-ci entraîne hors du tableau et y ramène : il est à peine perceptible, mais il est là. Il doit être maîtrisé et non dispersé.
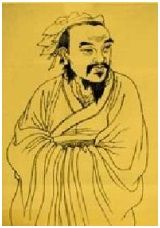
Gu Kaizhi (顾之恺, ca. 344-406) est un célèbre peintre de la Chine ancienne. Selon les documents historiques, il est né à Wuxi, province du Jiangsu à Nanjing. En 366, il devint officier (Da Sima Canjun,大司马参军). Plus tard, il a été promu à un officier royal (Sanji Changshi,散骑常侍). Gu Kaizhi a écrit trois livres sur la peinture théorie: la Peinture (画论), Introduction des peintures célèbres de Wei et Jin Dynasties (魏晋胜流画赞), et peinture Yuntai Mountain (画云台山记). Il écrit:
"Dans la peinture des figures les vêtements et les apparences ne sont pas très importants. Les yeux sont l'esprit et le facteur décisif."
A cette mouvance, se rattachent les sujets édifiants à valeur didactique, la peinture de personnages, les portraits des grands hommes et les récits moralisateurs qui sont privilégiés par des peintres tels que Zhang Seng You, sous les Liang, et Whu Dao Zi au VIIIè siècle, sous les T'ang. Zhang Seng You, qui a travaillé dans les sanctuaires bouddhistes de Nankin, est le premier à utiliser le modelé, empruntant l'ombre à l'Occident, en s'inspirant de l'iconographie bouddhique transmise par l'inde. Wu Dao Zi utilise la technique du Gong Bi pour représenter des personnages. C'est vers 500 que Xie He compose le plus ancien d'esthétique qui nous soit parvenu, le Gu Hua Pin Lu (Catalogue des peintres anciens classés par catégories) par le peintre chinois Xie He, où il développe les six règles de la peinture. Le premier principe, le K'i Yun ( dans l'harmonie du souffle) et Cheng T'ong (le mouvement de la vie) s'identifie au souffle de vie présente en toute chose, qui s'accorde au rythme de la vie universelle.
Il s’agit aussi de l’exigence première de Shi Tao, dans le chapitre XV des Propos sur la peinture, intitulé « loin de la poussière » :
« Quand l’homme se laisse aveugler par les choses, il se commet avec la poussière. Quand l’homme se laisse dominer par les choses, son cœur se trouble./ Un cœur troublé ne peut produire qu’une peinture laborieuse et raide, et conduit à sa propre destruction./ Quand ténèbres et poussière contaminent le pinceau et l’encre, c’est la paralysie ; dans pareille impasse, l’homme a tout à perdre et rein à gagner, et finalement rien n’y pourra plus réjouir son cœur./ Aussi, je laisse les choses suivre les ténèbres des choses, et la poussière se commettre avec la poussière ; ainsi, mon cœur est sans trouble, et quand le cœur est sans trouble, la peinture peut naitre./ N’importe qui peut faire de la peinture, mais nul ne possède l’unique trait de Pinceau, car l’essentiel de la peinture réside dans la pensée, il faut d’abord que la pensée étreigne l’Un pour que le cœur puisse créer et se trouver dans l’allégresse ; alors dans ces conditions, la peinture pourra pénétrer l’essence des choses jusqu’à l’impondérable. »
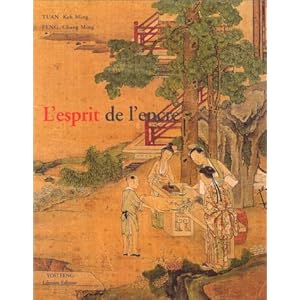
Extrait tiré du livre « L’esprit de l’encre » de Keh Ming TUAN et Chang Ming PENG
---
A l'époque des Six Dynasties, un genre pictural nouveau se développe : l'art du paysage, favorisé par la pensée taoïste et la recherche d'une perfection spirituelle au sein de la nature. C'est sous les T'ang qu'est élaborée la manière "bleue et verte" qui caractérise un type de paysage où s'illustre Li Si Xun, le père de l'école du Nord, il privilège le style linéaire et l'emploi de couleurs brillantes, le bleu, le vert, le blanc, l'or et le bleu jaspé. On lui oppose le paysagiste et poète Wang Wei, père de l'école du Sud, à qui l'on attribue la création de la peinture de lavis d'encre, synonyme de peinture lettrée, ainsi que deux innovations : l'encre rompue, dite p'o mo, et le tsuem, ou rides. L'art de cour se développe également sous les T'ang. Des artistes se spécialisent dans le portrait de cour, peignant les dames du palais. Ils utilisent des pigments très vifs dans des contours délicats et précis, technique du Gong Bi. Les œuvres de Zhang Xuan et Zhou Fang en sont d'illustres exemples. La peinture de chevaux est magistralement représentée par Han Gan.

Sous les Cinq Dynasties, Jing Hao Guang Tong, Dong Yuan et Juran donnent au paysage une expression grandiose, dans la recherche d'unité spatiale et d'harmonie entre l'homme et l'univers. C'est aussi à cette époque que la peinture de fleurs, d'oiseaux et d'animaux bénéficie d'une certaine faveur. Les compositions d'oiseaux de Huang Quan sont restées célèbres ; on y relève un sens aigu de l'observation qui renvoie à l'apparition contemporaine de la peinture d'après nature, nommée au XIè siècle "Xie Sheng".

Sous les Song (960-1279), la peinture de paysage et de personnages connait un remarquable épanouissement. Sous les Song du Nord, l'école du Nord se développe avec Fan Kuan, Guo Xi et Li Cheng, qui réalisent des paysages très travaillés, au lavis d'encre, qualifiés de 'sublimes". L'art du paysage est à son apogée.

Attribué à Hui Ch'ung, 965-1017 époque Song - Couple de canard mandarins sur un rivage automnal
Les paysagistes de l'école du Sud sont représentés par Liu Song Nien, Mi Fu, Ma Yuan et Xia Kouei. Mi Fu notamment est renommé pour ses paysages et ses jeux d'encre ; il utilise la technique des tien (points) et des rides, et le Xie Yi (spontané). L'art du paysage prend un nouvel élan sous les Song du Sud avec l'école dite de Ma Xia du nom de ses deux principaux représentants, Ma Yuan et Xia Kouei : ceux-ci affectionnent les compositions en diagonales et asymétriques, réservant une large place au vide. A cette époque, la peinture de personnages devient florissante, avec Su Han Zhen, peintre mémorable des enfants, des femmes et de scènes de genre, dans la technique Gong Bi. La représentation des animaux et des fleurs, moins considérée que celle de paysages et des personnages, car jugée plus prosaïque, est néanmoins exploitée avec talent : notamment par Li Di, le grand spécialiste des buffles d'eau. Au début du XIIIe siècle, les Mongols envahissent la Chine. Koubilai Khan fonde la dynastie des Yuan à Pékin. Durant cette période, les artistes s'inspirent de modèles antérieurs, tout en proposant des interprétations nouvelles. Tchao Mong Fou travaille dans le souvenir des peintres Song. Houang Kong Wang. Ni Tsan, Wang Mong, Wou Tchen recherchent une expression originale qui privilège leur individualité : Ni Tsan des œuvres très monochromes avec de grands espaces vides, tandis que Wang Mong préfère des compositions surabondantes et colorées.
Sous les Yan, calligraphie et peinture se trouvent étroitement associées ; les artistes ajoutent souvent à leur peinture d'importantes inscriptions calligraphiques, ce qui n'était pas le cas sous les Song, le peintre se contentant de signer discrètement son œuvre.
C'est aussi à cette époque que se développe la peinture des bambous, des fleurs de prunier, de chrysanthèmes et d'orchidées que l'on appelle les "Quatre Gentisshommes" ou les "Quatre Princes", symboles d'endurance et de résistance aux vicissitudes du temps. Rappelons que la peinture des bambous était particulièrement prisée des lettrés en raison de ses affinités avec la calligraphie, car esquisser des bambous nécessite précisément la maitrise des huit traits de la calligraphie.
L'apprentissage de la Peinture Chinoise passe par la réalisation des quatre Seigneurs
que sont le bambou, l'orchidée, le chrysanthème et la fleur de prunier.
Ils symbolisent aussi les quatre saisons respectivement, l'été, l'hiver, l'automne et le printemps.

En 1368, la dysnastie des Ming remet à l'honneur des valeurs traditionnelles, notamment l'art des Song. Tai Tsin, Tang Yin, Qiu Yin, Shen Zhou, Wen Tcheng Ming vont illustrer l'art du paysage, tandis que Pien Wen Tsin réalise de remarquables peintures d'oiseaux. La réflexion esthétique connait un nouvel essor. L'étude menée par le célèbre peintre Tong chi Tchan impose de nouveaux principes. Celui-ci établit une distinction fondamentale, moins géographique qu'esthétique, entre école du Nord et école du Sud, qui éclaire l'histoire de la peinture chinoise. Selon lui, l'école du Nord recherche la ressemblance formelle, le dessin précis, détaillé, et l'emploi de coloris brillants, tandis que l'école du Sud privilège l'intuition et les techniques du spontané, cherchant à atteindre d'emblée l'essence des choses.

Tai Tsin, 1388-1462, époque Ming - Retour en bateau dans le vent et la pluie.
Au milieu du XVIIe siècle, la chute des Ming et l'avènement d'une dynastie étrangère, celle des Ts'ing, d'origine étrangère, d'origine mandchoue, ont pour conséquence l'affirmation de deux tendances. D'une part, certains artistes se posent en héritiers spirituels de Tong chi Tchan et maintiennent l'héritage académique en se conformant à la tradition, pour se mettre au service du nouveau régime. A cette tendance on rattache les quatre Wang (Wang Che Min, Wang Kien, Wang Houei et Wang Yuan K'i) et Wou Li. D'autres artistes, au contraire, refusant le nouveau pouvoir, préfèrent se retirer dans des monastères bouddhistes ou taoïstes et développent alors un style d'une grande originalité. C'est à cette catégorie qu'appartiennent Tchou Ta et Shi Tao, tous deux moines bouddhistes, au style très personnel d'une rare éloquence expressive et qui exercera une grand influence sur la postérité.
Au XVIIIè siècle, le retour de la prospérité et de la paix permet l'éclosion de foyers artistiques autour de Yang-Tcheou. Des marchands de sel enrichis deviennent de grands mécènes, les collections privées se multiplient en même temps que le commerce des peinture. Mais les héritiers de maîtres "orthodoxes" adoptent une manière de plus en plus imitative. Face à cette sclérose, des artistes réagissent en recherchant une plus grande originalité et en cultivant la bizarrerie. "Les huit excentriques de Yang-Tcheaou" sont les représentants les plus significatifs de cette tendance.
Aux XIX et XXe sicèles, les artistes tentent d'apporter des solutions nouvelles : toujours en quête d'originalité, ils cherchent à renouveler à leur façon une tradition qui n'a cessé d'être sollicitée.
---
"Le saint porte en lui le tao et répond aux êtres et aux choses. Le sage clarifie son cœur et savoure les phénomène. Quant aux montagnes et aux eaux, tout en possédant une forme matérielle, elle tendent vers le spirituel."
Zong Bing (375-443), Hua shan shui xu, "introduction à l'art du paysage"
---
Source : Livre Peng Tuan Keh Ming Calligraphie et Peinture Chinoise



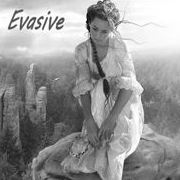










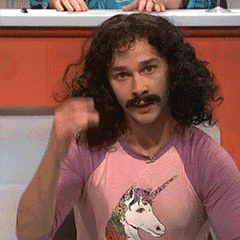
5 Commentaires
Commentaires recommandés