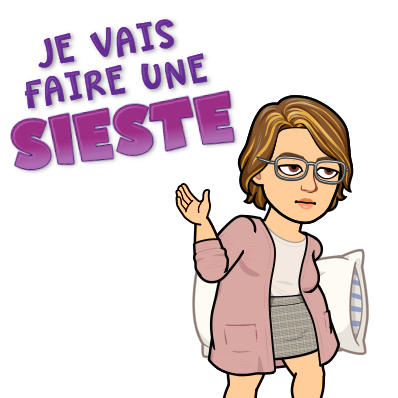Tout d’abord merci beaucoup à évasive de m’avoir remplacée le mois dernier car j’ai eu un souci de pc
Les fêtes sont dans quelques jours et le repas est une des préoccupations principales de cette semaine.
La tradition veut que les repas des fêtes soient souvent constitués de foie gras, saumon fumé, plateau de fruits de mer, escargots, ou encore bisque de homard, suivis d’une dinde ou d’un chapon ou encore de gibier, et terminé par une bûche ou encore des treize desserts en Provence.
Le pain d’épices est également traditionnel de Noël, les chocolats… plein de bonnes choses mais il est parfois difficile d’innover.
Quelques exemples de recettes de fêtes :
Noix de Saint-Jacques au pain d’épice, carottes fondantes au sirop d’érable
pour 4 personnes:
16 Saint-Jacques
1kg de carottes
3cl de sirop d’érable
20g de beurre
Sel, poivre, ciboulette
3cl d’huile d’olive
20cl de crème liquide
2 tranches de pain d’épice
Rincez les noix et séchez-les sur un linge
Épluchez les carottes
Préchauffez le four à 190 °C
Coupez les carottes en 2 ou 4 dans la longueur, puis effilez-les à l’aide d’un économe pour obtenir des lamelles régulières.
Mettez-les dans une casserole et ajoutez le sirop d’érable, le beurre et un verre d’eau. Assaisonnez avec du sel et laissez cuire jusqu’à évaporation complète de l’eau (les carottes doivent être fondantes et légèrement dorées)
Taillez 12 bâtonnets très fins de pain d’épices et enfournez-les 10/15 min au four afin de bien les sécher.
Dans une poêle avec un filet d’huile d’olive, colorez les noix sur une face et salez-les. Réservez-les et faire bouillir la crème et émietter dedans le reste de pain d’épice. Cuisez doucement pour obtenir une sauce légèrement liée. Réchauffez ensuite les noix dans cette sauce.
Dressage :
Rangez les bâtonnets de carottes au centre d’une assiette, dressez les noix dessus et nappez de sauce. Disposez les lamelles de pain d’épice séchées et quelque brins de ciboulette.
Terrine de fois gras au naturel
pour 6 personnes :
1 foie gras de canard
7 g de sel fin par lobe
1 g poivre par lobe
1g de mélange 5 épices par lobe
3cl de porto blanc
20 cl de lait
20cl d’eau
Sortez le foie gras du réfrigérateur 1h avant de le travailler et mettez-le à dégorger dans un mélange de lait et d’eau
Préchauffez le four à 160°C (th. 5)
Préparez l’assaisonnement en mélangeant le sel, le poivre et les 5 épices.
Séparez les 2 lobes. Ouvrez les gros lobe avec les doigts dans le sens de la longueur, tout en écartant le foie sur les bords. Enlevez la veine principale en forme de Y en partant de la base du foie et faire de même avec le 2ème lobe.
Assaisonnez les 2 lobes avec 16g d’assaisonnement au kilo. Laissez l’assaisonnement se dissoudre sur le foie en utilisant le porto blanc. Laissez mariner plus ou moins selon la force souhaitée.
Tassez les lobes dans la terrine et les cuire au bain-marie (50°C à cœur) pendant 15/20 min.
Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau qui doit être tiède au toucher. Laissez ensuite refroidir à température ambiante, enlevez la graisse et laissez refroidir complètement au réfrigérateur en mettant un poids sur le foie.
Conservez idéalement 5 jours pour maturation avec de consommer.
Chapon rôti forestière
Pour 4 personnes :
1 petit chapon (3kg)
12 petites brioches à tête
500g de champignons sauvages
Estragon
2 échalotes
1 gousse d’ail
25 cl de crème fraîche épaisse
70g de beurre
Sel, poivre
Préchauffez le four th. 6 (180°).
Salez et poivrez le chapon et posez-le dans un plat en le parsemant de 30g de morceaux de beurre. Enfournez 2h30 en l’arrosant souvent de son jus (ajoutez de l’eau si besoin)
Pelez et émincez les échalotes et l’ail et les faire revenir dans le beurre restant. Ajoutez les champignons et faites-leur rendre l’eau sur feu vif, salez et poivrez. Ajoutez l’estragon finement ciselé et la crème fraîche. Laissez réduire pour obtenir une sauce onctueuse.
Découpez les tête des brioches, creusez l’intérieur et garnissez-les de la préparation aux champignons. Récupérez le jus et les sucs de cuisson du chapon dans une casserole, ajoutez un peu d’eau et faites bouillir 5 min.
Servez le chapon entouré des brioches garnies, de petits légumes et servez le jus de cuisson à part.
Truffe chocolat champagne
150g de chocolat noir + 100g
6 cl de crème liquide entière
8 cl de champagne
Cacao en poudre non sucré
Préparation de la ganache :
Hachez les 150g de chocolat au couteau. Faites bouillir la crème et ajouter le champagne. Versez le tout sur le chocolat haché jusqu’à ce qu’il fonde.
Mélangez à la spatule et réservez 15 min au frais
Roulez des boules dans les mains pour leur donner une forme arrondie et mettre au frais 1/4 heure.
Faites fondre le reste du chocolat au bain-marie ou au micro-ondes.
Enrobez les boules de ganaches dans le chocolat fondu, puis enrobez-les de cacao en poudre.
Conservez au frais.
Truffes chocolat blanc, pistaches et citron vert
220g de chocolat blanc
10 cl de crème liquide entière
1 citron vert non traité
80g de pistaches concassées
50g de poudre d’amande
40g de beurre
Lavez le citron et râpez le zeste, concassez le chocolat blanc.
Faites tiédir la crème avec le zeste, puis versez sur le chocolat et mélangez. Incorporez la poudre d’amande et rajoutez le beurre pommade dans la ganache.
Réservez au frais 1h.
Réduisez les pistaches en poudre.
Faire des billes de ganache, roulez-les dans la pistache et mettez-les au frais.
Igloo
4/6 personnes
60g de noix de coco râpée
2 œufs
70g de sucre
50g de farine
25g d’amandes en poudre
4 biscuits amaretti moelleux
160g de litchis au sirop égouttés
15 cl de lait de coco
80g de sucre
4g d’agar-agar
15 cl de crème liquide
Biscuit :
Préchauffez le four à 180°C (th. 6)
Fouettez les œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange double de volume. Ajoutez la farine, la poudre d’amande et les amaretti émiettés en mélangeant délicatement à la spatule.
Dessinez le contour d’un saladier à fond arrondi (diamètre 16/18 cm) sur une feuille de papier sulfurisé et, à l’aide d’une poche à douille, étalez la pâte sur ce disque.
Enfournez 12 à 15 minutes, puis décollez le papier du biscuit.
Mousse :
Mixez les litchis pour obtenir un coulis. Dans une casserole, faites chauffer le lait de coco avec le coulis, le sucre et l’agar-agar. Laissez refroidir en remuant régulièrement.
Fouettez la crème liquide en chantilly bien ferme et incorporez délicatement le coulis refroidi en soulevant avec une spatule. Donnez un petit coup de fouet très rapide à la fin pour lisser la préparation.
Montage :
Versez la mousse dans le saladier. Déposez le disque de biscuit dessus en le recoupant, au besoin, à la taille du saladier. Placez le tout au réfrigérateur pour 12h.
Pour démouler l’igloo, passez rapidement le saladier sous l’eau chaude, puis déposez délicatement l’igloo sur un plat. Poudrez-le de noix de coco râpée avant de servir.
Bûche très chocolat
Pour 4/6 personnes :
3 œufs
110g de sucre
2 pincées de levure chimique
90g de farine
30g de cacao en poudre
140g de chocolat noir
140g de chocolat au lait
140g de chocolat blanc
6 feuilles de gélatine
30 cl de crème liquide
20cl de crème anglaise (faite maison ou tout prête)
Biscuit :
Préchauffez le four à 180°C.
Fouettez les œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange double de volume. Ajoutez la levure, la farine et le cacao.
Faites cuire le biscuit et laissez-le refroidir sans le rouler. Découpez 3 morceaux de la taille du moule à bûche.
Mousses :
Réalisez 3 mousses avec les 3 chocolats : faites fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Faites ramollir 2 feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide. Dans une casserole faites chauffer 1/3 de crème anglaise sans laisser bouillir. Ajoutez la gélatine hors du feu et mélangez, puis ajoutez le chocolat fondu. Fouettez ensuite 1/3 de crème liquide en chantilly ferme et incorporez la chantilly à la préparation au chocolat refroidie. Placez au frais pour qu’elle soit légèrement prise avant utilisation.
Montage :
Versez la mousse au chocolat blanc dans le fond d’un moule, déposez un morceau de biscuit dessus, puis la mousse au chocolat au lait, encore un biscuit, ensuite la mousse au chocolat noire et enfin le dernier biscuit. Placez au frais 12 heures.
Au moment de servir, passez le moule sous l’eau chaude rapidement. Démoulez délicatement et décorez avec des copeaux de chocolat.
bonnes fêtes à tous
- En savoir plus…
- 4 commentaires
- 1 614 vues