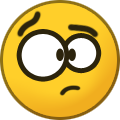-
Compteur de contenus
2 593 -
Inscription
-
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Blogs
Calendrier
Vidéos
Quiz
Movies
Tout ce qui a été posté par Loufiat
-
Bonjour, Je ne connais pas cet auteur et ses écrits. Zenalpha a l'air de dire que votre résumé est lapidaire et ne lui rend pas justice. Je suis incapable d'en juger ! Et vous reconnaissez sans difficulté ne pas vous être intéressé à son oeuvre en entier. Ceci étant dit, sur ce point précis que vous mettez en avant, indépendamment de l'auteur donc, l'idée me pose un gros problème, parce que tout choix, "éthique" ou non, au moment d'être réalisé, met généralement en jeu des conséquences imaginaires, qui donc n'existent pas, et en fonction desquels pourtant j'agis. En effet, qu'est-ce qui me pousse généralement à agir ? Qu'est-ce qui m'oblige à choisir ? En général quand je suis devant un choix, c'est que je fais face à des conséquences possibles prévisibles différentes, et en grande partie aussi inconnues ; je tente de me représenter ces consequence et je pèse mon action en fonction. Ainsi, le plus souvent quand j'agis, c'est en fonction de ces conséquences prévisibles, à moins que ce ne soit par principe ou par habitude ce qui est aussi possible. Alors donc le critère de mon choix et la direction de mon action, ce sont bien des choses qui n'existent pas, ou pas encore. Vraiment, très souvent j'agis pour des choses que j'imagine qui vont arriver et être d'une façon plutôt que d'une autre. Recevoir mon salaire le prochain mois par exemple, et tout ce qui pourra s'en suivre. Je vais plus loin. Toute action tendue vers un but (une oeuvre d'art, une réalisation artisanale, par exemples) n'existe pas avant que d'avoir ete réalisée mais nécessite une action pour venir au monde. Si je ne prends jamais mes pinceaux il n'y a aucun tableau bon ou mauvais. Si même j'agis pour moi, disons par exemple que je prenne une gourde d'eau bien fraîche avant d'entamer une longue marche ; mais ce moi qui a soif n'existe pas encore ! Pourquoi prendre la peine de préparer une gourde ? Bref cette idée me semble regressive. Elle veut la régression. Jouir plutôt que prévoir. Consumer plutôt que préparer. La logique men semble décadente en quelque sorte.
-
Pour le plaisir je ne sais pas, mais pour servir les IA oui sans aucun doute, il y a de l'avenir pour l'enseignement mathematique. Même n'est-ce pas déjà au présent ?
-

Pourquoi ne peut on plaire à tout le monde?
Loufiat a répondu à un(e) sujet de Popy dans Philosophie
Non. On peut plaire a bcp de monde et aimer bcp plus encore de monde Et en respecter encore plus. Mais s'agissant d'un ennemi objectif le respect ou bien tourne à la soumission pour ou bien devient permis de tuer -

Le " Parler pour ne rien dire " a t-il une utilité
Loufiat a répondu à un(e) sujet de MadameRosa dans Philosophie
Est il vraiment besoin de vous pointer linsanité de votre réponse, que vous vous en rendiez compte. Si vous estimez que 95% des conversations sont en moyenne "du bruit" au lieu d'information, revoyez votre thermomètre et appliquez un peu d'humilité. . Pour une proie quelconque dont les oreilles ramènent "rien ne se passe" cet espace de tranquillité est infiniment précieux. Pour rappel -
Pardon Ashaku, j'ai utilisé "je" mais ne confiais pas une expérience personnelle particuliere. En tout cas, ta réaction empathique et bienveillante t'honore. Pour en revenir au sujet, je suis étonné que l'IA affirme que ce n'est pas un terme scientifique. Il me semble que le terme de fait a toute sa place en histoire notamment ?
-
N'allons pas trop loin non plus dans l'eau de rose. Grand père m'a violé quand j'avais 7 ans : ceci correspond à des faits. Il s'est introduit dans la chambre un soir. A baissé ma culotte... on parle de ça aussi. De réalité glaciale. Que la justice ne parvienne pas à établir les faits, si seulement elle est mobilisée, ne change pas que les faits ont eu lieu. Ce qui change, c'est leur signification. S'il y a procès et jugement, par exemple, c'est parce qu'on veut qu'ils changent de signification. Un viol qu'on garde pour soi, et un viol jugé devant un tribunal, qualifié de viol et son auteur poursuivi, le fait même, à partir de là, tout en restant le même, change de signification pour les concernés. Tu vois ? Les deux aspects vraiment demeurent. Solide et liquide. Liquide pour quoi ? Parce que nous avons à en parler, quand c'est le cas. Autrement il demeure à l'état solide, inquestionnable, impératif, absolu.
-
C'est comme s'il y avait deux états, l'un solide, l'autre liquide. Le fait et sa portée ou disons, sa signification. Le fait s'impose, mais il est toujours enveloppé aussi dans des courants de signification (à minima parce que cest toujours quelqu'un qui constate qq chose). Nous avons un excellent exemple de système où le futur "retroagit" : la parole. C'est le cas notamment dans toutes les blagues où la chute vient transformer tout ce que l'on croyait avoir compris du récit. Mais c'est une qualité générale de la parole. Et de l'histoire. Le fait en lui-même n'a aucune signification mais sa participation à une histoire, etc. Et selon l'évolution des événements un même fait qui paraissait tel paraîtra autrement.
-
Pourquoi pas ?
-
C'est vrai, un fait est incontestable, c'est dans son principe. En même temps, c'est que la contestation s'est arrêtée. Dans le sens où établir des faits implique un accord s'imposant plus ou moins largement. Dans un procès par exemple. Untel ment sur ses allers et venues entre telle et telle dates. On le comprend parce quon parvient à établir qu'il n'était pas là où il prétend mais là où il se défend d'avoir été, selon toutes les règles du sens commun d'après les éléments de preuve soumis au jugement. Et ceci est le travail dune enquête, d'avocats et au total de toute l'institution judiciaire n'est ce pas, plus ou moins fonctionnelle Alors je réfléchis au concept moins dans son principe, quaux causes qui le rendent important et le font exister concrètement on cherche je crois a etablir les faits quand quelque-chose de grave est vraiment important à déterminer. Pour une décision de futur ou pour une décision de justice par exemple. Quels sont les faits ? C'est un soucis "trivial" et assez universel qui est à l'origine du concept. De vérifier les choses. Vérifier pour former une décision, adopter une réaction. Et donc c'est le sport de la science d'établir les faits, c'est devenu un peu son domaine propre dans lequel elle domine et excelle tout particulièrement La science, et avec elle tout l'appareil technique, economqiue et politique, nous abreuve de faits decisifs, determinants dans nos vies, reellement, quon le veuille ou non, qu'on le sache ou non, et d'informations secondaires également innombrables que nous en savons pas traiter. Un fait c'est quelque chose qui doit altérer mon comportement, ma réponse à un problèmedans une certaine situation. Il définit la situation dans laquelle j'ai un choix à faire. Mais faits resultent d un vaste complexe de contraintes réelles (techniques et naturelles) et dalienations mentales solidaires entre elles dans leur ensemble, et ils m'alienent au même degré où je dépends deux. Enfin un fait suppose une vision, un point de vue, une perspective..
-
Entre tout ce qui se dit et s'entend de par le monde, les travaux scientifiques ne sont pas les moins explicites sur les limites des définitions, catégories, expériences ou conclusions qu'ils tirent La science progresse dans des dispositifs invraisemblables (institutions, laboratoires, d'innombrables reseaux et espaces de litterature, etc etc.) en vue d'établir des faits. C'est à peu près sa vocation, on pourrait dire, non ? La science doit donc bien savoir qu'un fait est une construction en meme temps quune decouverte, et en tout cas une conquête de longue haleine. Est-ce que ca diminue la valeur du fait, et sa réalité par ailleurs ? L'ennui ne vient-il Pas plutôt d' un monde toujours plus à la fois chaotique mais aussi "millimétré", cerné et englué dans des dispositifs qui empruntent aux faits d'une science que nous navons les moyens ni d'etablir ni de connaître.
-
Je pense que vous allez trop vite. Il n'y a pas de relation organique entre le mot framboise et une framboise. Mais d'une part il y a des règles que la langue respecte, et il y a les framboises dans la réalité et dans le symbolisme (le concept la framboise, ses représentations, etc ). "Ceci s'appelle une framboise" n'est pas arbitraire, s'agissant d'une framboise en effet. Si c'était une banane, on pourrait qualifier l'énoncé darbitraire. C'est de l'ordre de la convention, comme les mesures (températures, dates, distances, etc. etc.). Mais ce sont précisément ces conventions qui permettent l'objectivité. Tout ceci relève de l'institution. Et l'institution est-elle necessairement à opposer à la nature ?
-
Ni fait ni à faire. Dans un procès pour meurtre par exemple n'est il pas important d'établir les faits ? On parle bien alors de les "établir". Curieux non ?
-
Je suis daccord mais alors qu'est ce qui fait de ce fait, un fait, sinon l'institution ? Or l'institution est de l'ordre du consensus et de la convention. Ainsi notre fait est tout autant de nature imaginaire que réelle, comme la monnaie, pour donner un autre exemple. L'interprétation se situant en amont, c'est elle qui donne au fait sa consistance, son objectivité.
-
Conscientiser est chose facile. Dialoguer est bien plus dur. Conscientiser ça arrive à tout le monde tous les matins. Ça vient tout seul. Je m'endors avec une énigme et le matin soudain quand j'ai bien tout remué la veille, la réponse me vient toute seule, claire, évidente. Conscientiser ça s'impose. Conscientiser est "inconscient", on pourrait dire. C'est quasiment de l'ordre d'un processus organique selon les informations à notre disposition- ça "arrive". Mais dialoguer est difficile. Impossible parfois. Pourtant ce sont les dialogues qui souvent transforment la conscientisation d'un processus automatique dans une opération plus complexe. Non ?
-
Allez, ça me démange, alors je vous demande - c'est quoi un fait ? Qu'est ce qui doit etre considéré comme un fait, et puis, ce veut dire quoi ? Ça implique quoi ? des exemples de faits qui vous viennent ? Différentes sortes de fait peut-être ? bref, que dit-on quand on dit "c'est un fait"
-

Si je peux me poser la question, alors est-ce que ce n'est pas que j'ai un libre arbitre pour me la poser ?
Loufiat a répondu à un(e) sujet de timot-33 dans Philosophie
Pas du tout. Vous re-confondez "l'hypothèse" du libre arbitre et le determinisne. Pour que l'arbitre soit dit libre il doit connaître les conséquences complètes de son choix. Que donc la séquence soit entièrement déterminée ou déterminable. Or, ce n'est jamais le cas en réalité. Dans la vie en général. La philosophie ne se résume pas, en fait, aussi étonnant que ce soit, en jouer avec des coquillages, même dorés, même super dorés. Qu'est-ce qu'un fait ? Le gros malin qui résoudra ce problème méritera une franche claque dans le dos. -

Frappes israéliennes en Iran : le chef des Gardiens de la révolution éliminé, le site de Natanz touché
Loufiat a répondu à un(e) sujet de Ma Poule dans International
Pas sur. C'est peut-être pourquoi il devait rester au pouvoir malgré toutes les compromissions. En tout cas, ceci est la fin pour lui, le "clou" du spectacle. -

Frappes israéliennes en Iran : le chef des Gardiens de la révolution éliminé, le site de Natanz touché
Loufiat a répondu à un(e) sujet de Ma Poule dans International
Ce régime est tentaculaire et serait plus dur à déraciner encore que le Hamas, sur une toute autre échelle où de toute façon l'intervention au sol semble exclue et serait catastrophique à tout point de vue. Je doute qu'Israel compte sur un renversement de l'intérieur, par hauts gradés ou par le peuple qui de toute façon ne peut pas du tout s'organiser actuellement. Israël suit apparemment un plan à plusieurs niveaux, en "oignons". Mais je ne vois pas du tout où ce plan peut aboutir, si chute du régime, hormis dans la mort et la dévastation à une échelle plus grande encore. J'espère qu'Israel à un plan, une vision (ce qui expliquerait les réactions americaines) mais j'ai peur que ceci ne soit réellement que la course en avant du gouvernement jouant toutes ses cartes parce qu'il n'en a plus d'autres. -

Violence dans les écoles et attaques au couteau
Loufiat a répondu à un(e) sujet de Ocean_noir dans Philosophie
L'interdiction de la vente de couteaux aux mineurs est une réponse rapide et visible, tout le monde trouve ca ridicule et personne ne croit que ca réglera le problème, mais on comprend la logique, d'une part l'effet d'annonce et d'autre part de freiner l'accès aux armes blanches. Mais personne ne peut empêcher un gosse de se servir discretement dans la cuisine ou dans la caisse à outils des parents. Quant aux solutions, encore faut-il comprendre les causes de cette violence. Je ne saurais dire s'il s'agit d'un fait de société réellement nouveau mais globalement il semble y avoir une facilité déconcertante du passage à l'acte et une absence quasi totale d'inhibition. C'est comme si le "surmoi" n'était pas formé, ou différemment. Il me semble que c'est lié au contexte dans lequel grandit cette jeunesse. Ce qui n'apporte pas le moindre début de solution, certes... -
Merci pour la réponse. Cette compréhension de la notion me laisse perplexe. Vous avez une vision plutot "positive" du destin, j'en avais pour ma part une compréhension plus fataliste. Ce qui relève du destin est ce qui échappe à la volonté. Par exemple j'ai prévu et préparé un avenir familial pendant des années quand subitement la guerre a éclaté, faisant voler en éclat toutes mes projections. Je meurs finalement au fond d'une tranchée nayant jamais connu la fille que ma femme attendait. Le destin se rapprochant du sort. Il regarde davantage l'individu dans l'histoire que dans la nature, sauf à considérer que la nature a fait de nous des êtres d'histoire. Il comporte une dimension essentielle d'aléas, d'arbitraire, d'incontrolable. C'est la part irréductible d'incertitude et de chaos face à la memoire et à la volonté, dans l'histoire, à cause de laquelle on se retourne sur une suite d'événements que l'on attribue alors au Destin, que celui-ci ait joué en notre faveur ou en notre défaveur, ayant coïncidé ou s'étant écarté de ce à quoi, individuellement, subjectivement, l'on se destinait soi-même. Finalement c'est la synthèse du sens de ce que nous faisons à travers les aléas des circonstances.
-
Bonjour, Par curiosité, si vous avez le temps de developper un peu, quelles différences/rapprochements proposeriez-vous entre Destin, Fatalité, Nécessité, Vocation ? Pensez-vous qu'il existe un droit naturel ?
-
Je suis convaincu que la Turquie joue un rôle essentiel. Elle est le pont entre les mondes et entre les temps. Elle concentre toutes les contradictions. Israël c'est l'occident. Son cœur. Le combat d'Israël est celui de la liberté contre la puissance. L'Inde est le foyer et le véritable centre des mondes asiatiques, avec le moyen-Orient et toute l'Afrique à ses bords. Elle a conservé une grande continuité culturelle, sans ruptures définitives. Son héritage et ses ressources sont inestimables. L'avenir de l'humanité se jouera entre ces trois centres et dans leurs communication, je crois. Chacun d'eux a une "mission" bien specifique, singuliere et essentielle. Sans prétendre que ce soit une analyse très objective... plutôt une intuition ou même un sentiment. La chute d'Israël est la catastrophe qui nous guette. Par chute, j'entends qu'elle perde sa mission.
-
La Thora raconte des epreuves, dont des guerres. Elle ne glorifie pas l'extermination. C'est l'Ancien testament, vous pouvez le lire. Et la Thora n'est qu'un élément.
-
Israël est seul, et gaza est son miroir. En français nous disons que briser un miroir, c'est sept années de malheurs. La France, pour des raisons de stratégie militaire, puis par électoralisme, à abandonné les peuples de Palestine A atisé les haines et la montée des extrêmes. A laissé, et à même activement participé à la montée en puissance d'une hydre à millions de têtes, qui a tout detruit autour d'elle, face à Israël. La France a laissé faire, quand elle n'a pas participé, la création d'un espace autour d'Israël complètement dédié à la haine du juif. Et maintenant, nous prétendons dire à Israël ce qu'il doit ou ne doit pas faire. Personne ne semble prendre la mesure de ce qu'il se passe du point de vue de l'histoire humaine. Mais ceci était clair dès le début de cette guerre et nos atermoiements ne témoignent que de notre inconsistance. SI Israël se perd dans cette guerre, elle détruira un héritage millénaire. Israël, la Turquie et l'Inde sont les trois ventres où se prepare l'avenir de toute l'humanité. Si les modérateurs pensent que c'est approprié, qu'ils déplacent ce sujet dans Asile
-

Le temps tel que nous le percevons n’est qu’un concept humain...
Loufiat a répondu à un(e) sujet de G6K972 dans Philosophie
Je pense que vous tentez de résoudre un problème avec la parole, car, sur ce sujet comme sur d'autres, il y a un enthousiasme pour ce qui equivaut à l'extinction de la parole ou a sa dégradation, implictement ou explicitement, et, réciproquement, une peine ou une douleur à se mêler de ce qui l'implique activement.