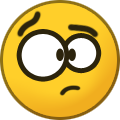-
Compteur de contenus
1 842 -
Inscription
-
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Blogs
Calendrier
Vidéos
Quiz
Movies
Tout ce qui a été posté par Dompteur de mots
-

Faites vous une différence entre valeurs et principes ?
Dompteur de mots a répondu à un sujet dans Philosophie
Je vois que vous avez une tête sur les épaules et que discuter avec vous commande une certaine dose de précision et j'en suis ravi. Au lieu de parler de "fait", je parlerai donc de "fonctif", au sens deleuzien du terme: c'est-à-dire que la valeur est ici prise en tant qu'elle s'inscrit dans un espace de référence défini par un ensemble de pratiques scientifiques ayant pour but de décrire fidèlement le réel, par opposition au concept, qui est le propre de la philosophie, lequel exprime plutôt l'événement de la pensée lui-même, en posant un problème et en tentant de le résoudre. La force gravitationnelle est par exemple un autre exemple de fonctif: nous sentons bien qu'elle n'a pas la même teneur que le conatus de Spinoza ou que la Volonté de Schopenhauer. Partant de ces définitions, je vais affirmer que la notion de "valeur" décrit adéquatement le réel de la société et de ses individus et ce, sans que le contenu conceptuel philosophique de la valeur ne soit invoqué. Je vous préviens amicalement: si ce genre de contradiction vous fait frissonner, vous allez trouver la vie bien effrayante. Le monde est en effet rempli de contradictions qui mettent notre faculté de raisonner à l'épreuve. Évidemment, en l'occurrence, vous réduisez au ridicule ce qui constitue une contradiction ou plutôt un paradoxe stimulant pour l'esprit. Nous trouvons le même genre de paradoxe dans l'opposition entre ce que Schopenhauer appelait le "génie de l'espèce" et la liberté individuelle. Schopy utilisait notamment cette expression afin de désigner la façon qu'a la nature de dissimuler le caractère industrieux du sexe derrière le théâtre de nos amours. Évidemment, pour ce philosophe, la liberté découle de l'usage de la raison, laquelle ne peut que nous conduire à saisir la nature véritable et trompeuse de l'amour, une ligne de pensée qui finit immanquablement par le conduire en pleine crise du nihilisme. Dans ce contexte, une attitude plus prometteuse, plus saine, plus vitalisante est peut-être de considérer que notre liberté s'exprime au travers du génie de l'espèce ou en relation avec celui-ci, et non pas contre celui-ci (auquel cas l'expression du génie de l'espèce devient elle-même caduque). Il en va de même dans le cas des valeurs. La sociologie ne peut qu'admettre la relativité des mœurs éthiques, et le public avec, ce qui ne peut qu'influencer le cours de la pensée mais cela ne constitue pas pour autant une thèse philosophique (qui est différente d'une thèse scientifique). Car le problème est intact: qu'est-ce qui peut fonder une éthique ? Peut-on fonder une éthique ? Notre éthique n'est-elle jamais que le produit de la société à laquelle nous appartenons ? Toutes les questions qui touchent aux contradictions entre la modernité et la postmodernité m'intéressent beaucoup. Il est intéressant d'explorer comment nous pouvons concilier ce que nous avons perdu avec ce que nous avons gagné. C'est souvent dans ces paradoxes que que se cachent les territoires philosophiques les plus riches (et les débats les plus amusants). -

Faites vous une différence entre valeurs et principes ?
Dompteur de mots a répondu à un sujet dans Philosophie
Je reprends votre intervention initiale: "Le concept de valeurs est une horreur relativiste qui sous-entend que la vérité n'existe pas et que chacun valorise ce qu'il lui plaît ou ce qu'il reçoit de son environnement. Et toute valeur devient alors indéfendable rationnellement." 1) "Le concept de valeur sous-tend que la vérité n'existe pas": le concept de valeur n'est pas une thèse, c'est un fait sociologique (et psychologique ?). On peut constater que telle société ou tel individu est animé par telles valeurs, ou encore que je suis moi-même animé par telles valeurs. Le travail du sociologue est alors effectivement de lire l'audimat du collectif. 2) "Chacun valorise ce qui lui plaît": comme je disais, les valeurs s'érigent comme telles parce qu'elles sont partagées. Il n'est donc nullement question d'arbitraire individuel. 3) "Chacun valorise ce qu'il reçoit de son environnement": ça ne signifie pas pour autant que les individus sont purement passifs et qu'ils ne sont que le produit de leur environnement. Les valeurs constituent plutôt une sorte de socle autour duquel les réflexions éthiques peuvent se tisser. Parfois, les individus se définissent négativement par rapport aux valeurs ambiantes. Dans ce cas, elles n'en constituent pas moins des référents moraux. 4) "Toute valeur devient indéfendable rationnellement": les valeurs constituent donc des référents à partir desquels les individus peuvent élaborer des jugements éthiques, voire se donner des principes éthiques, qui eux peuvent très bien faire l'objet d'un débat rationnel, voire faire l'objet d'une recherche de vérité. Les valeurs pourront d'ailleurs évoluer en fonction de ce travail éthique. *** Je suis anxieux à l'idée que vous placiez l'impératif catégorique de Kant au même niveau épistémologique que la gravité. Je vous en prie, rassurez-moi ! -

Faites vous une différence entre valeurs et principes ?
Dompteur de mots a répondu à un sujet dans Philosophie
Oui, moi aussi j'ai eu ma phase boycott du livre-dont-il-ne-faut-pas-prononcer-le-nom. Au final, ça reste un ouvrage fascinant, sans compter que c'est le plus influent de l'histoire. Surtout l'Ancien Testament: un condensé de mythologie, de cosmogonie, d'histoire, d'anthropologie, de morale des temps anciens. Il y a des éditions "scientifiques" qui cherchent à rendre d'abord la vérité du texte plutôt qu'une vérité dogmatique. Je vous conseille celle d'Édouard Dhorme à la Pléiade. -

Faites vous une différence entre valeurs et principes ?
Dompteur de mots a répondu à un sujet dans Philosophie
Bien sûr qu'il a lu la Bible. Tout le monde a lu la Bible. Mais l'originalité de Kant est qu'alors que les religions proposent la Règle d'or comme un commandement de Dieu, il tente quant à lui de la fonder rationnellement. -

Faites vous une différence entre valeurs et principes ?
Dompteur de mots a répondu à un sujet dans Philosophie
Le principe entendu comme règle d'action rationnelle ne découle pas forcément d'une valeur. Par exemple, l'impératif catégorique de Kant (ne fait pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse) se veut une règle d'action autonome découlant de la nature même de l'éthique. De même, les éthiques déontologiques, utilitaristes, conséquentialistes ou des droits de la personne reposent certes sur des principes mais non sur des valeurs (ce qui n'empêche pas pour autant qu'elles puissent être influencées par des valeurs). Cela étant dit, des valeurs qui nous habitent peuvent effectivement faire l'objet de principes. Par exemple, si la générosité m'est chère, je peux adopter le principe de toujours donner un peu d'argent aux quêteurs que je croise. J'en profite pour récuser l'idée selon laquelle les valeurs constitueraient une horreur relativiste (je ne me souviens plus qui a écrit cela). En effet, je ne crois pas que quiconque ait jamais adopté de valeur de façon purement arbitraire. En excluant le groupe extrêmement sélect des individus créateurs de valeurs, celles-ci acquièrent une valeur à nos yeux précisément parce qu'elles sont partagées par d'autres - un groupe d'amis, de semblables, par notre société, etc. -
Souffrir: du latin "sub", qui signifie "sous" et "fero", qui signifie "porter". Le "sub" renforce l'idée de porter et évoque donc que souffrir, c'est porter un lourd fardeau. Il faut parfois retourner à la simplicité étymologique des mots pour se libérer d'acceptations particulières qui se sont incrustées dans la culture. En l'occurrence, peut-être, d'une acceptation quelque peu romantique de la souffrance. Car, de tout ce que tu dis, la vie te semble définitivement être un lourd fardeau. Je comprends ce que tu ressens bien que de toute évidence, la sensation te soit plus aigüe, et je pense que je ne suis pas le seul. Je te recommande de te précipiter sur un exemplaire de "Le mythe de Sisyphe" d'Albert Camus. Je pense que tu pourrais y trouver un propos qui correspond bien à ta sensibilité.
-
Tu assimiles le sacré au commandement moral, une conception que l'on retrouve effectivement notamment dans les religions. Mais chez un exemple qui me vient tête, soit celui de Georges Bataille, le sacré est plutôt conçu comme une sorte de sensation. En l'occurrence, c'est celle qui consiste à se perdre, à sortir de soi et à entrer en communion avec les choses. C'est une sensation que l'on peut retrouver notamment par le biais de l'art, mais aussi, toujours selon Bataille, par l'érotisme ou même le rire. Le sacré a toujours pour arrière-fond l'angoisse de l'individu en tant qu'être séparé du monde. On peut se demander si le sens du sacré diffère réellement dans les religions ou si ce n'est pas plutôt qu'il finit trop souvent par être instrumentalisé à des fins morales… En ce qui me concerne, j'ai toujours été fasciné par les atmosphères religieuses prises en dehors de leur contenu moral. Le suicidaire est-il un être qui a perdu le sens du sacré ? Qui se retrouve isolé en lui-même sans jamais trouver la sensation d'être lié à toutes choses ?
-
Tu sembles affirmer que la conduite du suicidaire découle d'une quelconque thèse ou d'un quelconque raisonnement qu'il se serait formé. Mais le propre des états de détresse, c'est précisément qu'il rend impossible la pensée rationnelle. Si je suis par exemple dans une situation de danger et que j'ai très peur, je vais réagir par instinct et je n'aurai pas vraiment le temps ni la capacité de raisonner. La pensée rationnelle est le propre de l'homme au repos, de l'homme oisif. Or, sauf exceptions, l'état d'une personne suicidaire est comparable au nôtre lorsque nous avons peur (même si la tonalité émotive n'est pas la même).
-
Albert Camus disait: "Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux: c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le reste, si le monde a trois dimensions, si l'esprit a neuf ou douze catégories, vient ensuite. Ce sont des jeux; il faut d'abord répondre." Ce qui est dingue en fait, c'est de se consacrer à un sujet qui ne nous interpelle pas vraiment, ce que la plupart font ici. Comme disait Valéry, les vrais problèmes philosophiques sont ceux qui tourmentent et gênent pour vivre. Or, forcément, une personne que le problème du suicide tourmente et gêne pour vivre vraiment ne pourra qu'émettre des réflexions à ce sujet qui comptent. Philosopher comme on parle de la pluie et du beau temps, c'est automatiquement dénaturer la philosophie. D'un certain point de vue, ce n'est pas faux, entendu que le philosophe chercher à formuler des jugements qui soient les plus justes possible sur les choses de la vie en vue d'atteindre la sagesse. Mais il faut s'entendre sur ce que signifie "juger". Dans la langue courante, on l'entend souvent au sens de "régler le cas de…". Je pense d'ailleurs que c'est en ce sens que tu l'entends: tu reproches à certains amateurs de philosophie de vouloir "régler le cas" du suicide. Or, on peut très bien se former le jugement que le cas du suicide ne se "règle" justement pas, qu'il demande à être traité au cas par cas, ou qu'il demande une bonne dose de nuances, qu'il recèle une large part d'ambiguïté.
-
J'aime la nuance syntaxique vous apportez en parlant de construire plutôt que d'aller vers ce que j'appelais la grandeur. Oui... Je vais utiliser un gros mot mais peut-être le monde d'aujourd'hui a-t-il quelque chose de plus... totalitaire ? Comme si la prégnance du système consumériste, d'une pensée narcisso-cynico-hédoniste sur les individus avait quelque chose de plus profond, de plus ancré.
-
Euh... mais le sexe et le genre sont différents. Pour le savoir, il n'est nul besoin d'être woke mais simplement de ne pas être resté scotché au XIIe siècle et d'avoir suivi l'essor des sciences humaines. Nous savons que les genres, c'est-à-dire les rôles qu'adoptent généralement les hommes et les femmes sont des constructions sociales. Cela est démontré par le fait que ces rôles changent selon la culture. Nous pouvons aussi penser qu'une certaine proportion de gens ne se sentiront jamais parfaitement à l'aise dans ces rôles préconstruits qu'ils doivent adopter. Par conséquent, si on ouvre la porte à ces gens à un certain espace de construction d'une identité de genre différente, plusieurs risquent effectivement de prendre cette voie. Je note 3 éléments problématiques à ce mouvement: - L'espace médiatique, politique et académique qu'il occupe est complètement disproportionnel à l'ampleur réelle des problèmes qu'il recoupe dans la société; - Il ébranle l'identité de quelques vieux croûtons dont la confiance vacille dès que tout n'est pas uniforme autour d'eux; - La franche la plus radicale du mouvement, qui se veut de gauche, n'hésite pas à se saisir des procédés de déconstruction de l'espace social issus de l'extrême droite: censure, autodafés, révisionnisme, etc. Les 2 premiers problèmes ne sont pas très graves. En revanche, le 3e devient préoccupant lorsqu'il est mis en relation avec le 1er: en effet, la frange radicale obtient une étonnante représentativité dans les mondes politiques, académiques et médiatiques. De ce fait, elle participe à une fluidification (par voie de déracinement) de l'espace public qui est normalement l'apanage du capitalisme. Elle risque aussi de faire basculer le processus tragique de la construction de l'identité vers une sorte de bric-à-brac consumériste (ce qu'entrevoyait Baudrillard dans La société de consommation). Enfin, si on met cette combinaison en relation avec le 2e problème, on obtient la magnifique soupe aux bêtises que nous observons actuellement.
-
En fait, vivre requiert toujours un acte de foi, entendu que la vie n'a aucune utilité réelle que la raison puisse établir. La différence est que le gouffre qu'il s'agit de sauter pour effectuer cet acte de foi dans le cours habituel des choses est moins grand. Nous pourrions décrire ce gouffre comme étant ce qui sépare notre monde affectif, intuitif, instinctif de notre raison. De manière générale, la raison consiste précisément en ce processus intérieur par lequel nous suspendons nos élans afin de préciser nos actes. En temps normal, nos élans ploient aisément la suspension imposée par notre raison. Nos enfants, nos parents, nos amis, nos valeurs: tout cela nous pousse à aller de l'avant malgré l'absurdité immanente des choses. La raison en est que ces choses nous poussent vers quelque chose de plus grand que nous, quelque chose que nous ne pouvons parfaitement appréhender et qui par conséquent nous tire justement de l'absurdité des choses. Les choses sont absurdes lorsqu'elles ne mènent pas à quelque chose de plus grand que nous. Une procédure bureaucratique est absurde lorsqu'elle n'a de fin qu'elle-même. Lorsque l'on remplit de la paperasse que pour remplir de la paperasse. S'il était annoncé que la fin du monde aura lieu dans 50 ans, c'est le "plus grand que nous" qui aurait l'air d'avoir soudain rapetissé. La vie s'apparenterait soudainement un peu plus à une procédure bureaucratique absurde: on ne vivrait plus que pour vivre. Le saut de la foi serait plus difficile à effectuer. Sans doute continuerions-nous de vivre pour les autres et pour les choses pour lesquelles nous vivons habituellement mais sans doute devrions-nous aussi nous en remettre à quelque d'autre, quelque chose de plus abstrait, à une grandeur cosmique. Nous nous creuserions la tête pour tenter de comprendre en quoi peut consister une telle grandeur cosmique et, précisément, ce creusage de tête ne serait autre que l'acte de la raison venant se frotter au gouffre à franchir.
-
C'est le propre du scientifique de jouer des formules, tout comme le pianiste joue du piano. Pourquoi cela vous irrite-t-il ? Auriez-vous la tentation de tirer sur les messagers ? Franchement, je ne vois pas pourquoi la pensée de l'anéantissement prochain de ce pour quoi vous vivez vous laisserait indifférent(e?). Ce qui permet de sauter par-dessus la pensée scientifique de l'anéantissement, c'est précisément le fait qu'elle se situe dans un horizon temporel que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais admettons que d'ici 50 ans les scientifiques puissent statuer que l'anéantissement de la vie sur terre dans un horizon temporel humainement appréciable est désormais inéluctable en raison de l'état de la crise écologique, je pense que nous aurions une excellente raison de devenir cinglés. Je comprends ce que vous voulez dire. Il y a un poète ici qui chante que "la fin de l'homme ne sera pas la fin du monde". Je trouve cette idée étrangement réconfortante. C'est peut-être à la pensée que nous, misérables humains, nous inscrivons au sein de quelque chose de plus grand. C'est donc une idée qui appelle une sorte de foi. Peut-être que celle de l'anéantissement de tout appelle une foi autrement plus immense.
-
De même que devenir un adulte c'est en quelque sorte être capable de faire des choix par conviction et non par pure recherche égoïste de plaisir, devenir un "adulte spirituel" (désolé, c'est un peu laid), c'est peut-être agir selon une certaine foi, contre tout anéantissement (et donc sans égard pour les arrière-mondes). Pour la beauté du geste, en quelque sorte. Quand j'étais petit, mon frère et moi construisions des châteaux de sable dans la partie de la plage destinée à être engloutie par la marée haute. Il fallait alors les protéger coûte que coûte, même si nous savions que nous allions inéluctablement finir par perdre. Mais en s'en foutait, car on s'amusait bien. Il convient aussi de se rappeler que la science n'est finalement qu'un instrument à notre service, un modèle théorique et donc fictif qui nous permet de prédire les processus du monde et donc de les influer. Mais précisément, ce n'est qu'une fiction (bien qu'il soit sans doute dangereux de l'écrire de nos jours...).
-
Que fait le chef de la tribu devant le péril ? Il tente d'embrasser la situation de la tribu aussi loin que porte son regard et au travers de l'ensemble de ses connaissances. Il résume la situation et en tire une résolution. Que la résolution soit présentée comme une vérité indélogeable n'est qu'une pure affaire de nécessité pratique. Je pense que ce n'est pas différent avec la philosophie: tout est une affaire de résolution et sa vocation est donc d'abord éthique. On peut penser que les anciens se livraient volontiers à l'élaboration de systèmes métaphysiques sensés régler définitivement le cas du monde parce que sur le cours de la sagesse, ils devaient concurrencer les attraits des vérités éternelles émanant de la religion. Et aussi sans doute parce que le monde changeait beaucoup moins rapidement. Les découvertes sur l'évolution du monde et l'accélération de la vie moderne ont rendu caduques toutes les prétentions à parvenir à quelque forme de résolution éternelle. Aussi me semble-t-il que plutôt que de rimer avec la recherche de la vérité, la philosophie a désormais plus à avoir avec un jeu de perspectives. Je fais une analogie avec la peinture: pendant longtemps, l'on a loué l'habileté du peintre à dessiner des contours nets et bien tracés. Tout cela a été révolutionné par Léonard de Vinci et sa technique du sfumato, qui consiste à ne plus représenter les contours que comme ils se présentent dans la nature, c'est-à-dire sans netteté définitive, mais toujours au travers de jeux de lumières et d'ombres. En effet, de Vinci avait remarqué avec raison que les lignes pures n'existent pas dans la nature. Ainsi, le sfumato crée des effets envoûtants, car bien qu'il procure aux peintures un réalisme frappant, il a aussi pour propriété de faire rêver, comme si le mystère des choses se révélait davantage dans ce réalisme flou. De mon point de vue, il en va de même pour la philosophie: les perspectives peuvent s'y mélanger avec des effets de sfumato langagiers afin d'inviter le lecteur ou l'auditeur à une méditation authentique, plutôt que de l'enfermer dans quelque construction logique.
-

Le pass sanitaire respecte t-il les valeurs humanistes ?
Dompteur de mots a répondu à un sujet dans Philosophie
On peut formuler toutes les hypothèses imaginables si ça nous chante. Mais la réalité va à peu près toujours dans le sens de l'hypothèse la plus économique en terme de contorsions de l'imagination. En l'occurrence, le pass sanitaire comme mesure incitative à se faire vacciner parce que la vaccination est le seul moyen respectable de sortir de cette pandémie à la con. La mission d'un philosophe est en bonne partie d'établir ce qui vaut d'être pensé. Je veux dire que le philosophe pose des questions afin de stimuler la pensée sur un sujet donné parce qu'il estime que les hommes doivent réfléchir à ce sujet plus qu'à un autre. Or, j'estime que de s'interroger à savoir si le pass sanitaire va dans le sens de la dignité humaine est un luxe incroyable. Inadmissible au regard de toutes les saloperies qui ont cours dans le monde. -

Le pass sanitaire respecte t-il les valeurs humanistes ?
Dompteur de mots a répondu à un sujet dans Philosophie
La question se pose certainement de savoir si la mécanique temporaire du pass sanitaire concoure à la dignité des hommes ou si au contraire elle la bafoue. C'est un débat fascinant. Je serais curieux de savoir ce que les hommes du monde qui subissent les affres de la guerre, de la famine, de la dictature, de l'esclavage, ce que les femmes afghanes, ce que les gens des pays qui commencent à être défigurés par les changements climatiques en pensent: est-ce que le pass sanitaire est une atteinte à la dignité de ces pauvres occidentaux ? -
Je vous ai jadis insulté AnnaLevine, et par conséquent il est tout à fait légitime que vous cherchiez à vous venger, et cela mérite a priori mon respect. Je sens toutefois que vous avez maladroitement sauté sur la première occasion de le faire, ce qui n'est pas sans me décevoir. En l'occurrence, je vous dirai que même les actes de conquête peuvent être interprétés comme des tentatives d'aménagement du monde. Je dirais même plus: l'aménagement d'un chez-soi - ne fut-ce que la plus chétive cambuse, n'exige-t-il pas un acte de conquête ? Par ailleurs, je vous pousserai cet argument d'autorité, à savoir que mon idée, par laquelle j'interprète Heidgger, a été piochée chez Arendt. Or, je suis convaincu que vous êtes du genre à encenser Arendt.
-
Je vous confirme que je l'ai lu. J'ai un recueil intitulé "Essais et conférences" (que j'ai fait purifié par un prêtre en l'achetant). Il contient un autre essai intitulé "... L'homme habite en poète..." ou la notion d'habitation connaît des développements supplémentaires. Un autre passage intéressant réside dans la conclusion du 1er texte: où Heidegger critique l'idée que les hommes de son temps se font de la crise de l'habitation - c'est-à-dire comme pénurie de logements. Heidegger maintient pour sa part, sans nier la pénurie de logements, que la véritable crise de l'habitation réside dans le fait que les hommes ne savent plus habiter.
-
Je doute que vous soyez capable de me proposer une lecture de Bataille que je n'ai déjà faite. Si la philosophie ne peut traiter des concepts qui ne relèvent pas spécifiquement de sa discipline, alors elle est condamnée à n'être qu'un bavardage stérile. Qu'est-ce que cela signifie de dire que la culture est un concept anthropologique ? Voulez-vous dire que c'est quelque chose dont ne devraient parler que les anthropologues ? Quant aux liens entre la culture et le bâtiment, je vous ferai d'abord remarquer que l'art du bâtiment fait partie de la culture. Par ailleurs, même si a priori deux mots n'ont pas de lien formel, le langage nous permet parfois de tisser des connections spéciales entre ceux-ci, par le moyen d'un assemblage analogique. Nous dirons alors que l'auteur veut faire image. Par exemple, je pourrais parler de l'"édifice de la culture" afin de montrer qu'elle n'est jamais que le produit de l'activité des hommes. Heidegger mange à la gauche de Belzébuth, quelques rangs après Goebbels et Himmler. Je ne m'approche jamais d'un livre de Heidegger sans m'assurer que la pièce dans laquelle je me trouve contient un crucifix. Quant à Sartre, il dort dans l'ombre de Staline qui lui-même dort dans l'ombre d'Azraël l'ange de la mort, qui lui-même dort aux côtés de Lucifer.
-
"[...] nous pensons, à partir de l'habitation, ce qu'on appelle d'ordinaire l'existence de l'homme. À vrai dire, nous délaissons ainsi la représentation courante de l'habitation. Cette représentation ne voit dans l'habitation qu'un comportement de l'homme parmi beaucoup d'autres."
-
L'un des propres de l'homme est effectivement d'aménager le monde afin de le rendre familier. Non pas seulement physiquement mais aussi et surtout par le moyen de la culture. Nous nous donnons des rites, des lois, des traditions qui nous permettent de nous sentir chez nous dans le monde. C'est une vision très humaniste en ce sens où cette oeuvre culturelle ne peut advenir que par un travail collectif.
-
De plus, les nazis descendent directement de Belzébuth. Vous lisez les nazis, vous lisez Belzébuth.
-
Je te confirme que dans mon lexique, une proposition normative n'est pas forcément relative aux mœurs collectives. À partir du moment où j'énonce ce qui devrait être, il s'agit d'une proposition normative. Par nature, la proposition normative cherche à s'établir comme norme, ne serait-ce que comme norme d'une situation spécifique, en l'occurrence une norme que je souhaite appliquer à ma propre vie, de moi à moi. Ce qui est ici appelé "proposition estimative" n'est jamais qu'une proposition énonciative portant sur le sentiment d'un individu. Ex.: "je trouve que cela est laid": cette proposition énonce ce qui est et non ce qui devrait être; elle vise à informer quant à ce que je ressens. Évidemment, dépendamment du ton sur lequel cette proposition est exprimée, elle pourra ou non acquérir un contenu normatif. Si par exemple je le dis sur un ton de dégoût et que je cherche manifestement à influencer, à rallier, alors on dira qu'un contenu normatif se profile en sous-texte, par exemple: "une chose aussi laide devrait être détruite". Cela signifie par extension que toute proposition énonciative est susceptible d'acquérir un contenu normatif. Quant à la proposition impérative, ce n'est jamais qu'une autre façon d'exprimer une norme. En effet, une injonction telle que "fais cela !" ne signifie jamais que "tu dois faire cela !" ou même "il faut faire cela." Remarquons enfin que sous une proposition normative, il y a toujours 2 proposition énonciatives qui se profilent: l'une portant sur mon sentiment, puisque par exemple "tu dois faire cela" implique que "je pense qu'il faut faire cela"; et l'autre portant sur un raisonnement éventuel, peu importe sa solidité, puisque "tu dois faire cela" implique que "il est préférable, dans une telle situation, de faire cela à cause de telle raison". Ce qui nous rappelle une chose, à savoir qu'une division entre propositions énonciatives et normatives n'est jamais que théorique, et que la réalité expressive de l'homme ne saurait s'y réduire. Si nous nous ramenons dans la division bipartite que je préconise, je pense que la philosophie relève d'un monde normatif. Le philosophe s'attache aux faits, à comment l'homme et le monde sont, mais c'est toujours au final dans le but de prescrire ce que devrait être une vie bonne. Seule la science est strictement attachée à un monde énonciatif.
-
En logique, une proposition normative est une proposition qui dit ce qui devrait être, qui édicte une norme. Par exemple, la proposition "les animaux ne doivent pas être maltraités" est une proposition normative, elle exprime une norme d'action. Par suite, comme tu le sais, un mot est à même d'exprimer plusieurs concepts différents. C'est le cas du mot norme, qui peut vouloir dire ce que je viens d'expliquer, ou encore une pratique sociale collective admise et qui fait plus ou moins consensus. On dira par exemple que se promener dans la rue habillé constitue une norme. Mais en l'occurrence, la proposition "les gens se promènent usuellement dans la rue habillés" est une proposition énonciative: elle livre un état de fait, elle dit ce qui est.