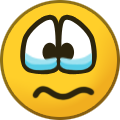-
Compteur de contenus
886 -
Inscription
Type de contenu
Profils
Forums
Blogs
Calendrier
Vidéos
Quiz
Movies
Tout ce qui a été posté par Exo7
-

Alain Jakubowicz se moque du "combishort" d’une députée LFI : "Tenue d’hiver, on redoute l’été"
Exo7 a répondu à un(e) sujet de kinobunika joy dans Beauté - Mode
J'avais pas vu ça sous cet angle... T'as peut-être aussi raison du coup !! -

Alain Jakubowicz se moque du "combishort" d’une députée LFI : "Tenue d’hiver, on redoute l’été"
Exo7 a répondu à un(e) sujet de kinobunika joy dans Beauté - Mode
C'est sûr, quand t'as raison, t'as raison... -

Alain Jakubowicz se moque du "combishort" d’une députée LFI : "Tenue d’hiver, on redoute l’été"
Exo7 a répondu à un(e) sujet de kinobunika joy dans Beauté - Mode
Bon, je suis allé voir sur Instruction générale du Bureau - Assemblée nationale et voilà ce qui est dit : – la tenue vestimentaire adoptée par les députés dans l’hémicycle doit rester neutre et s’apparenter à une tenue de ville. Elle ne saurait être le prétexte à la manifestation de l’expression d’une quelconque opinion : est ainsi notamment prohibé le port de tout signe religieux ostensible, d’un uniforme, de logos ou messages commerciaux ou de slogans de nature politique. Sinon depuis le 9 novembre dernier : La proposition soumise au bureau suggérait simplement de "recommander" veste et cravate pour les hommes. Mais un vote a eu lieu en faveur de "la veste obligatoire" dans l'hémicycle, indique une source parlementaire. "Est prohibé le port du short et du bermuda", qui était déjà de facto interdit par la demande d'une "tenue de ville". Assemblée nationale : veste obligatoire et cravate recommandée pour les députés -

Alain Jakubowicz se moque du "combishort" d’une députée LFI : "Tenue d’hiver, on redoute l’été"
Exo7 a répondu à un(e) sujet de kinobunika joy dans Beauté - Mode
Élu pour représenter la Nation, le député participe à l'exercice de la souveraineté nationale. Il vote la loi et contrôle l'action du Gouvernement. -

Alain Jakubowicz se moque du "combishort" d’une députée LFI : "Tenue d’hiver, on redoute l’été"
Exo7 a répondu à un(e) sujet de kinobunika joy dans Beauté - Mode
Quand venir à Dunkerque pour le carnaval ? DATES DU CARNAVAL 2023 -
"Le prix de la guerre, ce n'est pas que les morts des combattants, c'est aussi le silence des vivants" - J. Boutros.
-
"Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Mais parfois, les deux sont d'accord pour dire que vous êtes un idiot." - Unknown
-
-
-
Marx et Proudhon. D'autres formules socialistes germèrent dans les milieux des réfugiés politiques venus d'Europe centrale et orientale, tels les Russes Herzen et Bakounine, les Allemands de l'"Association des justes" fondée à Paris, ou enfin Karl Marx. Tandis que les socialistes dont on a parlé jusqu'ici répudiaient la violence, Karl Marx (1818-1883) insistait sur l'importance historique et la nécessité primordiale de la lutte des classes. Pour hâter l'avènement de la société socialiste, les travailleurs devaient s'organiser et s'unir, arracher à la bourgeoisie le pouvoir politique et réaliser la dictature du prolétariat afin de procéder ensuite à l'appropriation collective des moyens de production. A la demande d'ouvriers communistes de Londres qui lui demandaient de rédiger pour eux un programme, Marx, aidé par son ami Engels, écrivit le Manifeste communiste. Cette brochure, parue à Londres en avril 1848, passa inaperçue dans le fracas de la Révolution, mais elle devait connaître une immense faveur vingt ans plus tard et devenir le bréviaire des socialistes collectivistes. Proudhon avait, lui aussi, un programme social, mais il repoussait le nom de socialiste. Il aimait les paradoxes et les formules provocantes. Il s'était fait brusquement connaître par une brochure "Qu'est-ce que la propriété ?" (1840) où il répondait : "La propriété c'est le vol". En 1846, dans son Système des Contradictions économiques ou Philosophie de la Misère, il affirmait avec force la primauté des questions économiques. En fait, il était un modéré. Ancien prote d'imprimerie, il se posait en porte-parole et en défenseur non des ouvriers d'usine, mais des artisans et petits bourgeois , qu'il aurait voulu fondre en une classe sociale unique. Individualiste à l'extrême et libéral avant tout, adversaire acharné de toute institution d'autorité et d'unité, que ce fût l'Eglise ou l'Etat, et de toute intolérance, qu'elle vînt des révolutionnaires ou des gouvernements, il prêchait "l'anarchie", c'est-à-dire l'absence de gouvernement, ou tout au moins la réduction au minimum des pouvoirs de l'Etat. Il avait pour idéal "la justice", qui serait réalisée quand des associations groupant les travailleurs s'organiseraient, puis se fédéreraient, pour produire, et ensuite échanger leurs produits évalués selon la somme de travail qu'ils auraient exigée. Beaucoup moins que de la production et de la répartition des richesses, Proudhon se préoccupait de leur échange. Les procédés traditionnels du commerce lui paraissaient malhonnêtes ; il voulait créer une "banque du peuple" qui mettrait le crédit gratuit à la disposition des groupements ouvriers.
-
Moi aussi ça me rappelle quelqu'un, c'était le jour de son anniversaire, du coup il l'avait bien arrosé ; et quand il est revenu chez lui, évidemment sa clé n'allait pas dans la serrure... Mais la porte s'est ouverte quand même, et ce qu'il s'est dit en regardant sa voisine c'est : "je me souviens pas l'avoir invité"... Elle l'a regardé et a dit : "Vous être ivre !" lui, il a répondu "Je sais, mais j'ai une bonne raison...". " Laquelle" ?... "C'est parce que j'ai bu toute la journée"...
-
Les Communistes. Les autres écoles socialistes reprirent, en les transformant plus ou moins, les idées émises par Saint Simon, Fourier ou Owen. Elles diffèrent considérablement, d'après le rôle qu'elles attribuent à l'Etat dans la vie économique. Le communisme, qui ne laisse presque plus d'initiative à l'individu, fut défendu par Cabet, dont le roman, Voyage en Icarie, parut en 1840. "Tous les biens sont communs et ne forment qu'un capital social... exploité en commun... Les droits et les devoirs sont les mêmes pour tous : chacun a le devoir de travailler le même nombre d'heures par jour suivant ses moyens et le droit de recevoir une part égale, suivant ses besoins, de tous les produits... La nourriture, le vêtement, le logement et l'ameublement sont, autant que possible, les mêmes pour tous, préparés par la Communauté et fournis par elle à chacun. Tout est fait d'après un modèle adopté par la loi." Un ami de Cabet, Pecqueur, allait moins loin dans le désir d'uniformité, mais, à la façon des Saint-Simoniens, il disait : "L'idée la plus fécond que la science sociale puisse introduire est celle d'une administration centrale, intermédiaire nécessaire et absolu entre le producteur et le consommateur, présidant légalement à la délégation des instruments (de travail) et à la distribution des richesses." (Dans Fournière, ouvr. cité.) Louis Blanc. Cette intervention d'une "administration centrale" était au contraire rejetée par le catholique Buchez, par Louis Blanc et par les ouvriers qui rédigeaient le journal l'Atelier. Ils étaient partisans d'"associations ouvrières", c'est à dire de coopératives de production à direction ouvrière. Le salariat disparaîtrait et l'ouvrier toucherait le produit intégral de son travail. (Aux yeux des socialistes, le salaire payé par le patron est inférieur à la valeur du travail fait par l'ouvrier. Celui-ci ne touche donc pas le produit intégral de son travail : il est frustré au profit du patron.) Dans son livre, l'Organisation du travail, Louis Blanc préconisait la formation, au moins dans les industries importantes, d'ateliers sociaux, créés avec l'aide de l'Etat, mais administrés ensuite par les ouvriers eux-mêmes. L'appel à l'Etat était nécessaire pour que l'atelier social pût se fonder et commencer à fonctionner. "Dès que l'on admet qu'il faut à l'homme, pour être vraiment libre, le pouvoir d'exercer et de développer ses facultés, il en résulte que la société doit à chacun de ses membres et l'instruction, sans laquelle l'esprit humain ne peut se développer, et les instruments de travail, sans lesquels l'activité humaine ne peut se donner carrière. Or par l'intermédiaire de qui la société donnera-t-elle à chacun de ses membres l'instruction convenable et les instruments de travail nécessaire, si ce n'est par l'intermédiaire de l'Etat ?" Une fois que l'Etat a fourni les instruments de travail à l'atelier social, il doit ne plus exercer aucune autorité sur ce dernier. Louis Blanc rejette le "socialisme d'Etat" des Saint-Simoniens et de Pecqueur, qui, dit-il, aurait pour conséquence "la violence exercée sur l'individu sous le masque du bien public, la perte de toute liberté, une sorte d'étouffement universel." Dans les ateliers sociaux les salaire seront tous suffisants pour que le travailleur puisse vivre décemment, mais ils ne seront pas égaux pour tous. Quant aux bénéfices, ils seront divisés en trois parts : une sera distribuée à tous les ouvriers également, une autre sera consacrée aux oeuvres d'assistance, la troisième à l'élargissement de l'atelier. Près de dix ans auparavant, Buchez avait émis des idées semblables. Dans le "projet socialiste" qu'il rédigea pour les menuisiers en 1831, on lisait : "Tous exerçant l'état de menuisiers, considérant que le défaut (= le manque) d'un capital et non leur habileté les met à la disposition des entrepreneurs de menuiserie et que ceux-ci profitent d'une part considérable de la valeur des travaux exécutés par les ouvriers au delà du prix de leur intervention... ont résolu de s'associer entre eux pour exercer leur industrie en commun, afin d'acquérir un capital social commun (formé par L. Blanc par une partie des bénéfices annuels) qui les mettra, eux et tous les ouvriers qui se succèderont dans l'association, à même d'entreprendre directement des travaux." (Reste Karl Marx et Proudhon...).
-
Fourier et Owen. Fourier (1772-1837) était un petit employé de commerce. Dans des ouvrages où les bizarreries et les extravagances côtoient les vues profondes, il proposa un système très différent de celui de Saint-Simon. Nul recours à l'Etat, ni à une direction autoritaire, quelle qu'elle fût. C'est par l'association, "forme terrestre de l'attraction universelle", que le monde sera régénéré. On y arrivera en créant partout dans les campagnes des phalanstères : chacun est une exploitation agricole où vit et travaille une "phalange", groupe d'environ 1600 personnes, hommes et femmes. Le travail en commun sera attrayant, parce que chacun fera ce à quoi il s'intéresse et d'ailleurs, pour éviter la lassitude, on changera d'occupation plusieurs fois dans la journée. Fourier croyait que les différences de fortune sont voulues par Dieu. On trouvera donc au phalanstère des riches, des pauvres et des personnes aisées, et le confort ne sera pas le même pour tous. Il y avait dans ce système une large part d'utopie. Mais Fourier avait compris l'avenir de l'association et de la coopération. Il en fut de même pour Owen (1777-1858). Esprit à la fois pratique et mystique, ce fils d'artisan devint, très jeune, un des plus riches industriels d'Ecosse. Philanthrope sincère, il fit de ses usines des usines modèles, où la journée de travail était réduite, où les ouvriers étaient mieux payés et mieux logés, leurs enfants instruits dans des écoles gratuites. Déçu de ne pouvoir obtenir du Parlement de larges mesures sociales. Owen songea à créer, comme Fourier, des communautés agricoles, mais fondées sur le principe de l'égalité absolue : répartition des produits entre tous les membres selon leurs besoins ; répartition du travail selon l'intérêt général et les talents de chacun. Owen tenta une expérience aux Etats-Unis : elle échoua (1825-1829). Sans renoncer au communisme et pour en préparer l'avènement, Owen prêcha alors la création d'associations ouvrières sous la forme de coopératives de production, dirigées par les travailleurs eux-mêmes : ainsi le patronat serait aboli. La monnaie métallique serait remplacée par des bons de travail, au moyen desquels les ouvriers échangeraient mutuellement leurs produits (1832). Cette tentative échoua, elle aussi. Mais Owen avait donné l'élan au mouvement coopératif anglais, comme au mouvement syndical. En 1844 une vingtaine de tisserands anglais fondèrent dans la ville de Rochdale une coopérative de consommation, sur le double principe : vente au prix courant, partage des bénéfices entre les acheteurs au prorata de leurs achats. L'exemple de ces Pionniers de Rochdale a été suivi dans le monde entier. Prochain chapitre : les communistes...
-
La doctrine de Saint-Simon. En France le socialisme a précédé la transformation industrielle, puisque le système de Babeuf date du Directoire. Sous l'Empire et la Restauration deux penseurs proposèrent des systèmes de réorganisation politique et sociale : Saint Simon et Fourier. Selon Saint Simon (1760-1825), la société actuelle est organisée de façon à la fois anarchique et injuste. D'une part elle attribue le pouvoir à des classes "inutiles" et réduit à une situation subalterne les véritables "producteurs" ; d'autre part elle est fondée sur l'exploitation de l'homme par l'homme. A cet état de choses, Saint Simon proposait de substituer "l'Etat industriel", où la direction appartiendrait à la "classe industrielle", c'est-à-dire à la "classe occupée des travaux les plus utiles" : savants, artistes, cultivateurs, industriels, commerçants, banquiers. La société nouvelle serait fondée non sur la liberté et l'égalité - pour lesquelles Saint Simon n'avait que dédain - mais sur l'autorité et la hiérarchie. Elle se donnerait pour tâche d'une part l'exploitation rationnelle des richesses du globe, et d'autre part l'amélioration la plus rapide du sort de la classe la plus pauvre. La révolution économique se doublait en effet d'une révolution morale et religieuse. A la fin de sa vie, Saint Simon prêchait un "nouveau christianisme", qui devait avoir ses dogmes, son clergé, son culte. Saint Simon avait trouvé dans la jeunesse intellectuelle quelques disciples enthousiastes , comme Auguste Comte, Enfantin, Bazard (un des chefs de la Charbonnerie). Ils donnèrent à sa doctrine un caractère nettement socialiste. Tous les instruments de production (la terre, les capitaux, les mines, les canaux, plus tard les chemins de fer etc...) seraient enlevés aux particuliers et attribués à la Société. L'Etat les distribuerait à ceux qui seraient les plus aptes à les utiliser. Chacun serait ainsi placé à la fonction où il pourrait être le plus utile et il serait rétribué selon son travail. Ainsi la production des richesses et leur utilisation seraient organisées rationnellement. L'héritage serait supprimé. D'autre part les Saint Simoniens insistèrent, plus encore que leur maître, sur la nécessité d'une profonde transformation spirituelle. Dans la "Société industrielle", chacun sera tenu d'adhérer à l'enseignement intellectuel et religieux édicté par l'Etat. Le Saint Simonisme fut ainsi tout ensemble une doctrine collectiviste et une religion, le tout dans une atmosphère d'autoritarisme et même d'intolérance. L'Ecole Saint Simonienne ne garda pas longtemps son unité. Certaines idées religieuses et morales d'Enfantin, devenu le chef spirituel de la secte sous le nom de "Père", choquèrent de nombreux disciples. De l'enseignement de Saint Simon, les Saint-Simoniens conservèrent avant tout l'idée qu'il faut mettre le monde en valeur. Aussi furent-ils souvent de grands hommes d'affaires : ils s'intéressèrent aux chemins de fer, aux exploitations minières, aux entreprises bancaires. Enfantin étudia les travaux publics qu'on pouvait tenter en Algérie et songea très tôt au percement de l'isthme de Suez, qu'un jeune Saint Simonien, Ferdinand de Lesseps, devait réaliser plus tard. Suite :"Fourier et Owen"... sous presse...
-
-
ça reste un bouquet....
-
Les réformateurs sociaux. Abandonnés à eux-mêmes, les ouvriers ne pouvaient rien faire pour améliorer leur sort. En France, il ne leur était permis ni de s'unir pour former des syndicats, ni de faire grève pour obtenir du patron une diminution du nombre d'heures de travail ou un relèvement de salaires. Ils n'en tentèrent pas moins d'organiser des grèves et parfois avec succès : ils utilisèrent à cet effet les sociétés de secours mutuel, fondées dans un certain nombre de métiers pour venir en aide aux compagnons frappés par la maladie ou le chômage, ou bien des sociétés de résistance, créées pour s'opposer aux patrons qui voulaient abaisser les salaires. Déjà une femme, Flora Tristan, proposait de fédérer tous les ouvriers du monde en une "Union Ouvrière". Beaux rêves, que venaient briser les répressions brutales des gouvernements de Londres, Paris et Berlin, ou la phrase de Casimir Perier, après l'échec du soulèvement de Lyon en 1831 : "Il faut que les ouvriers sachent bien qu'il n'y a de remèdes pour eux que la patience et la résignation." Cependant en Angleterre, en Allemagne et surtout en France certains esprits s'indignaient à la pensée que la misère des ouvriers s'accroissait au moment même où les affaires prospéraient. Puisque la liberté économique et la libre concurrence étaient génératrices de misère sociale et d'anarchie, il fallait y renoncer et édifier la société économique sur des bases nouvelles. A partir de 1840 environ, ces réformateurs sociaux reçurent le nom de socialistes. Il fallait d'abord organiser rationnellement la production des marchandises (ou, comme on dit, des richesses) : non seulement la quantité des richesses s'accroîtrait immédiatement, mais le gaspillage, les disettes, les crises de surproduction disparaîtraient. Ces richesses il fallait ensuite les distribuer à tous équitablement, au lieu de les réserver aux riches. Pour opérer ce bouleversement de la société actuelle, certains socialistes voulaient faire appel à L'Etat et lui confier la direction effective de toute la vie économique. D'autres, au contraire, se méfiaient de l'Etat, dont ils redoutaient le caractère autoritaire et tyrannique. Ils imaginaient plutôt les hommes groupés en associations libres de travailleurs qui s'organiseraient et s'administreraient elles-mêmes. Du moins les socialistes étaient-ils unanimes - à l'exception de l'Allemand Karl Marx et du petit groupe des partisans de Blanqui - pour rejeter tout emploi de la violence. Pénétrés d'optimisme, ils étaient convaincus que le passage de la société actuelle à la société future serait facile et qu'une ère de bonheur allait bientôt s'ouvrir pour l'humanité. Leurs théories avaient un parfum religieux et, même quand ils n'étaient pas chrétiens, ils parlaient avec émotion de la réalisation toute proche du "royaume de Dieu". A suivre... prochain épisode : la doctrine de Saint-Simon...
-
Le régime capitaliste. Après 1815, l'aristocratie d'argent, maîtresse de l'industrie, du commerce, de la banque, accrût son rôle dans l'Etat. En France les deux premiers ministères de Louis-Philippe eurent à leur tête des banquiers, Laffitte et Casimir Perrier. La bourgeoisie dirigea la vie politique en Belgique; elle obtint le droit de vote en Angleterre après la réforme électorale de 1832; elle siégea dans les assemblées des Etats allemands. Partout, elle gouverna au profit de ses intérêts matériels. La bourgeoisie était passionnément attachée à la propriété et à la liberté économique. En vertu du droit de propriété privée, il est permis à une entreprise privée de posséder des instruments de production (exploitations minières, moyens de transports, etc...), qui jouent parfois un rôle capital dans la vie de la nation. En vertu du principe de la liberté économique. Chaque entreprise travaille comme elle l'entend, produisant autant qu'elle le peut, vendant au prix qu'elle juge le plus rémunérateur, dans la seule intention d'augmenter ses bénéfices propres : L'Etat ne doit limiter en rien la libre initiative des chefs d'entreprise (1). De cette liberté découle la concurrence que ces entreprises se font entre elles. Cette libre concurrence développe l'esprit d'initiative des patrons et a souvent pour conséquence l'amélioration des produits et l'abaissement de leur prix de vente. Ce régime économique, fondé sur l'importance accordée à la propriété privée, à la liberté économique, à la libre concurrence, est connu sous le nom de régime capitaliste ou, plus simplement, de capitalisme. Il n'est pas sans dangers : Chacun travaillant à sa guise dans le seul dessein de s'enrichir, il y a souvent gaspillage d'efforts, anarchie économique et des crises de surproduction, aussi désastreuses pour le patron obligé de fermer son atelier que pour l'ouvrier jeté au chômage. Parmi les ouvriers, les moins malheureux étaient ceux qui travaillaient comme compagnons dans l'atelier d'un artisan, vivant de la vie du patron et traités par lui presque sur un pied d'égalité. Beaucoup d'entre eux faisaient, comme sous l'Ancien Régime, leur Tour de France et étaient groupés en compagnonnages, souvent rivaux les uns des autres. A côté de ces ouvriers, il y avait ceux qui travaillaient à domicile, particulièrement dans l'industrie textile : un négociant leur fournissait le métier et la matière première, puis leur achetait pour un salaire de famine le produit fabriqué. Enfin, peu nombreux encore, étaient les ouvriers d'usine, souvent anciens paysans venus à la ville dans l'espoir d'améliorer leur sort. La concentration ouvrière était d'ailleurs faible en 1848 : en France on ne la trouvait qu'autour de Mulhouse, de Lille et Roubaix, de Rouen, de Saint-Etienne. Jamais sans doute les ouvriers anglais et français ne furent aussi malheureux que dans la période 1815-1848. La cherté du pain, la fréquence des crises économiques, l'usage des machines qui créait souvent le chômage, l'abondance de la main-d'oeuvre (surtout des femmes et des enfants) qui faisait baisser les salaires, contribua à rendre atroce la misère des ouvriers. Or les travailleurs ne pouvaient pas compter sur l'intervention de l'Etat en leur faveur. C'est à peine si à Londres et à Paris, les députés consentirent à voter quelques lois pour protéger les enfants dans les usines; ils se désintéressaient des adultes. (A suivre...) (1) Les industriels et les propriétaires français demandaient cependant à l'Etat de les protéger, par des droits de douane, contre la concurrence étrangère. Mais logiquement, le régime de liberté économique exige le libre échange. Références : J. Isaac, A. Alba, J. Michaud, Ch. H. Pouthas.