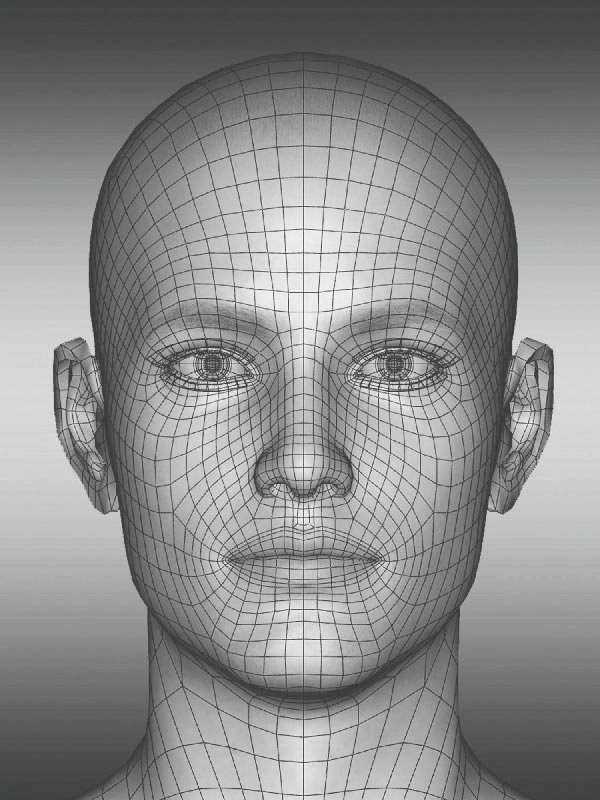-
Compteur de contenus
1 420 -
Inscription
-
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Blogs
Calendrier
Vidéos
Quiz
Movies
Tout ce qui a été posté par Guillaume_des_CS
-

Le commerce est "le" premier "fait" civilisateur. D'accord?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
J'en pense qu'il est "le" premier "fait" civilisateur. Mais en fait, il y a un problème dans la formulation. J'ai induit tout le monde en erreur (y compris moi-même) en utilisant "civilisateur" plutôt que "civilisationnel" (qui n'est pas dans le dico). Je m'explique: Vous l'aurez probablement remarqué, j'adore la langue française! Je l'aime! Nan mais, là, vraiment, genre un truc de fada quoi... Et ça a commencé il y a longtemps... Elle et moi sommes vraiment de vieux complices quoi... Le problème, c'est qu'au fur et à mesure de notre compagnonnage je me suis rendu compte qu'elle était incomplète! Qu'il lui manquait plein, nan mais alors... plein!, de mots. Et je n'ai cessé d'en inventer... Tiens, là par exemple: "moraligion"! Ailleurs: "effiqualité". Etc. etc. J'en suis épuisé de lui en accoler à tout va... Alors, pour "civilisationnel", j'y ai renoncé. Consciemment. Délibérément. Et j'ai eu tort! "Civilisationnel" eût constaté un état. "Civilisateur" constate une intention. Dès lors tout le monde s'est engagé dans un raisonnement de causalité: j'aurais dit que "le commerce fonde la civilisation". Or, j'ai voulu dire l'inverse exactement: l'existence du commerce (le fait "commerce") permet de constater que la civilisation est là. Et c'est le "premier" fait qui le permet. Et bien sûr, si j'ai choisi "fait" plutôt que "acte", c'est pour la même raison de "passivité", de constat a posteriori (pléonasme volontaire)... Donc, maintenant que tu connais ma position @CAL26 (bon, tu peux la questionner n'est-ce pas...), quelle est la tienne? -

Le commerce est "le" premier "fait" civilisateur. D'accord?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Intéressant... Rousseau(?)... Cependant, pas d'ac! À quoi sert le langage dans "l'acte de commerce" sinon à le structurer? N'est-il pas forcément secondaire?... -

Le commerce est "le" premier "fait" civilisateur. D'accord?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Et, selon "moi", vous êtes d'accord sur l'essentiel... Vous n'êtes juste pas au même "moment" pour observer... "le temps" ? -

Le commerce est "le" premier "fait" civilisateur. D'accord?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Darwin?... -

Le commerce est "le" premier "fait" civilisateur. D'accord?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Bon, à l'évidence (la mienne), tu choisis de rester sur le plan de l'humour... Et merci encore! Cependant, la question reste entière... (et de mon côté, je vois qu'elle est mal formulée... quelqu'un a parlé de "cause" et de "conséquence" je crois... ??? très important... je prépare une réponse... c'est une clé en effet...) -

Le commerce est "le" premier "fait" civilisateur. D'accord?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Merci pour l'humour. Ça détend un peu... C'est tellement important même... Oui, euh... de mémoire (qui flanche un peu ces temps-ci...) on parle d'éléphants ici. Mais... pardonne-moi, mais il me semble que tu me proposes une preuve par l'inverse, qui, hélas ne fonctionne pas La question que je posais était: comment peux-tu être sûr qu'ils ne sont pas conscients? Or tu me donnes un exemple d'animaux conscients... (ou peut-être ai-je mal compris, me suis-je mal exprimé, etc.) bien cordialement, -

Le commerce est "le" premier "fait" civilisateur. D'accord?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Je ne suis pas d'accord avec "vieux délires philosophiques". Mais je souscris au sens général de la phrase, et à "l'intention" que je lui prête(!). Il me semble, en effet, que cette intention (que je lui/te prête) est de bousculer, questionner les poncifs séculaires en regard de "promesses" scientifiques. Autrement dit, j'y vois davantage un engament qu'un enseignement. Et là, est à mon avis, la vraie "dimension philosophique" (mais bon, tout le monde l'aura déjà compris depuis longtemps, n'est-ce pas?)... -

Le commerce est "le" premier "fait" civilisateur. D'accord?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Bravo! (si tu conviens qu'ils ont "créé" ces meta-outils, car les utiliser est une chose, les créer en est une autre...) Bien sûr il faudrait montrer toute la différence (en termes de conséquences) entre l'outil et le meta-outil. Ou plutôt entre la capacité de créer un outil ou un meta-outil. Mais bon, c'est du "lourd" là... Est-ce la vocation d'un forum de discuter avec un tel degré de focalisation? Difficile de répondre... (J'aimerais! Mais j'en doute...) -

Le commerce est "le" premier "fait" civilisateur. D'accord?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Intéressant. J'inverserais la proposition cependant: n'étant pas prévoyants, ils ne peuvent se projeter dans l'avenir. Mais en gros, cela ne change rien. "Par manque de conscience de soi" me pose un problème: en es-tu sûr? Sur quoi (quelles recherches?) bases-tu cette affirmation? (qui sincèrement me semble intéressante en ce sens que je n'avais jamais envisagé cette problématique sous cet angle "évident" de la "réaction" opportuniste (instinctive?)) La guerre comme "fait" civilisateur? En se basant sur la nation? "nation" n'est pas "civilisation". De mon point de vue, c'est même presque l'inverse. Non, pas l'inverse: l'opposé! -

Le commerce est "le" premier "fait" civilisateur. D'accord?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Pas d'ac Très intéressant (pour moi). Si je comprends bien(?): le problème: la violence et la cruauté "animales" de l'être humain; la méthode: contourner le problème plutôt que de l'affronter(?) le moyen: l'innovation (?) -> la symbolisation(?) Pour la suite de ton post, je partage globalement ton analyse. Cependant, elle me semble davantage fondée sur l'histoire que sur la philo(?). Mais bon, why not? Alors me vient la question suivante: — Où est passé le commerce? Où le situes-tu? Il est forcément apparu un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Pour pouvoir me positionner en regard de ton analyse, j'ai besoin de savoir si tu le mets en amont ou en aval de ce qui me semble être ton choix en matière de "fait civilisateur" premier (ou principal), non? Merci. -
J'ai cliqué sur "j'aime", car j'aime ton approche du "je". Il me semble que nous ne sommes pas très éloignés dans notre analyse, mais il me semble évident que nous abordons la problématique du "je" sous deux angles différents(?). Ton approche me paraît davantage fondée sur l'anthropologie quand la mienne le serait davantage sur la philosophie politique(?). Merci en tout cas. C'est intéressant car cela me pose une question: comment combiner les deux?...
-

Le commerce est "le" premier "fait" civilisateur. D'accord?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Absolument d'accord. C'est pourquoi j'ai pris certaines précautions dans ma formulation (je crois)...? Edit: Oops ! @EnchantantPardon. Je n'avais pris les précautions que dans l'énoncé du sujet (et non dans le titre). Je comprends mieux ta réaction. J'ai modifié le titre... Sorry -
Dans mon petit livre, j'aborde ce point. J'ai pensé à poster ici différents extraits pour te répondre, mais la question étant un peu complexe, je devrais poster quelque chose comme 300 ou 400 lignes (en trois ou quatre extraits). Pas raisonnable. J'y ai renoncé. Je vais donc te faire (à mes risques) une réponse un peu caricaturale de ma position sur ce point: Je n'aime pas sa tête (!). Je sais, je ne devrais jamais écrire cela, mais je pense que tu comprendras ce que j'essaie de dire... Je maudis, j'abhorre, je condamne son idée de domination de la nature par la science et la technique... Le "je" de Descartes est plus proche de mon "Je" que de mon "je"; cepedant, je conviens dans mon bouqin que mon "je" est bien le "je" cartésien, à une nuance près... (extrait ci-dessous) Enfin, je dois admettre que je l'instrumentalise un peu. Après tout, ce n'est pas moi qui l'ai rendu si célèbre (et important), n'est-ce pas? C'est un peu "le chiffon rouge" idéal pour questionner cette société (la nôtre, la civilisation occidentale)... Mais à mes yeux il n'a même pas innové!... Il n'a fait que perpétrer un modèle pluri-millénaire en le rationalisant. Me tromperais-je? (N'oublies pas que je ne suis pas philosophe... = pas de culture philosophique académique...) Extrait: — Je vois... Bon, laisse-moi résumer pour qu'on puisse avancer : dans ta logique, "je" est l'individu intime, premier, essentiel et unique qui fonde chacun d'entre-nous ; ce "je" là surgit spontanément avec la toute première pensée ! En langage kovanien, Descartes n'aurait pas dit « Je pense donc je suis » mais « Je deviens quand je pense », d'accord ? — D'accord. — C'est une différence un peu subtile...: ton "je" et le sien sont bien les mêmes, n'est-ce pas ? — En effet. — Mais par jeu ton "je"..., Kovanien le dédouble ! Comment s'y prend-il ? En créant "Je", qui lui... ne pense pas mais fonctionne, ne vit pas mais existe et n'est pas vraiment "Moi", mais plutôt "Lui". Pourquoi le fait-il ? Pour me permettre d'aborder le problème de la synonymie du "Je" et du "Moi" sous un autre angle, d'un autre point de vue... Un point de vue inversé et non pas opposé... Mais ce problème est un prétexte, n'est-ce pas ? C'est en fait tout problème de toute nature que je pourrais aborder par ce nouveau moyen. C'est donc lui, le moyen, qui charpente la logique kovanienne ! Est-ce bien ainsi ? — C'est ainsi. Fin de l'extrait.
-
Merci de ta question @Loufiat J'ai créé le sujet dans cette rubrique "philo". J'y participerai dès que possible (j'ai un gros travail en cours...)
-

Le commerce est "le" premier "fait" civilisateur. D'accord?
Guillaume_des_CS a posté un sujet dans Philosophie
Le commerce est "le" premier "fait" civilisateur. C'est moi qui l'affirme. C'est ma vision. Je poste ce sujet en philosophie car je base ma position sur l'analyse philosophique et non sur l'analyse historique. Cela étant, je peux comprendre qu'on soit d'un point de vue différent et qu'on l'argumente – philosophiquement? – en se basant sur l'histoire du commerce. (Prudence cependant, car le risque me semble grand de voir le topic devenir celui de la colonisation...?) Merci de votre participation.- 100 réponses
-
- commerce
- civilisation
-
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
-
Pour moi, de mon point de vue, la passé est une trace; le futur est un projet (une utopie); mon présent (moi dans ce présent): décide de leurs poids respectifs. Et franchement, mon utopie pèse plus lourd (beaucoup plus lourd) dans la balance que les livres d'histoire (que pourtant je connais "pas trop mal"...)!
-
cela ne m'est JAMAIS arrivé dans MA PROPRE VIE (MA VIE RÉELLE). J A M A I S Par contre, je l'ai vu mille et une fois au cinéma, à la télé, dans les romans, dans les livres d'histoire, etc. Cela t'es-t-il arrivé ? Attention! Je ne suis pas négationniste. Je pose une autre question ici: sommes-nous condamnés à projeter le passé dans le futur? Le futur ne s'écrit-il qu'au passé?... Notre présent n'existe-t-il pas? Est-il neutre dans la détermination de notre avenir? (C'est la rubrique "philo" hein?)
-

Feminisme : Tribunal de l'impuissance sexuelle des mâles.
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Deremensis dans Philosophie
je suis assez d'accord avec ça... désolé, je ne comprends pas ce que tu veux dire ; tu compares le féminisme à une société mature ? c'est incompréhensible pour moi, sincèrement idem, pas compris arf... ça y est, compris ce n'était pas un dialogue en fait... -
Non. L'athéisme n'est pas anti-religieux. Il est extra-religieux. Supra-religieux (quand il est militant). Jamais "anti"... On n'est pas athée pour entrer en croisade... On est athée pour ne pas y entrer. Refuser (pour soi-même) la possibilité même d'un "être supérieur" à soi-même n'implique pas de devoir le combattre, puisqu'il n'existe pas pour soi-même... Connais-tu un seul athée qui soit militant anti-religieux? C'est-à-dire qui "acte" contre une religion? Et ne me cite pas Brassens (anti-clérical n'est pas synonyme d'athée...) ou qui sais-je...
-

Feminisme : Tribunal de l'impuissance sexuelle des mâles.
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Deremensis dans Philosophie
Oui. -

Feminisme : Tribunal de l'impuissance sexuelle des mâles.
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Deremensis dans Philosophie
Bon, sincèrement je n'ai pas lu le post auquel tu sembles répondre, mais... N'êtes-vous pas, tout simplement, en train de vous répondre en vous positionnant sur deux plans différents? C'est en tout cas ce qui me semble évident, rien qu'à te lire... (Ai-je gaffé là?) -

4 principes tout simples pour... changer de monde ?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
PS: je me rends compte que je vous vouvoie... Heu..., que vous me vouvoyez après m'avoir d'abord tutoyé. J'ai beaucoup de mal avec le "vous" (ayant longtemps vécu dans des pays où il n'existe pas). Votre tutoiement était spontané. J'y serais plus à l'aise, croyez-moi. Ce "vous" (pas le vôtre en particulier, n'est-ce pas...) me semble si cul-cul... Niant-niant... Heu... comment dire? Pseudo-hypocrito-distanciation pseudo-protectrice? Arf... Après, je respecterai scrupuleusement votre choix. Bien cordialement, -
Non, désolé. Je n'en suis [probablement] pas capable. Peut-être accepteriez-vous, pour m'aider, ou pour aider à la diffusion de vos idées (votre pensée?), car c'est quand même bien le but d'un forum que de proposer ses idées, n'est-ce pas?, peut-être accepteriez-vous d'ajouter quelques mots, quelques phrases explicatives à vos conclusions? Car il me semble en effet que vous ne livrez que conclusions... Cela m'inquiète encore davantage alors... Si je vous comprends bien, vous me dites là que votre discours n'est pas ésotérique. Qu'il n'est pas réservé, par la subtilité des sous-entendus que ne peuvent entendre que les initiés, à quelques élus. Ou ai-je mal compris? C'est bien possible, n'est-ce pas? Car si j'ai bien compris, je vous accorde intention bienveillante dans la recherche du dialogue (qu'à l'évidence vous manifestez). Mais, si j'ai mal compris... (trop de possibilités... à vous de préciser?)
-

4 principes tout simples pour... changer de monde ?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Non non, ne me remerciez pas. Ce n'est que "jouissance" pour moi (la vie quoi! la vraie...). Mais bon, il est vrai qu'il y plein d'autres "trucs" qui prennent plein de temps... Je reviens DQP -

4 principes tout simples pour... changer de monde ?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
"-Tout est jouissance: je valide, parce que ce que je vais faire me plait sainement" Cependant, le deuxième principe kovanien dit: "La vie est jouissance". Tu conviendras qu'il y a là grande différence. Tout n'est pas jouissance dans la vie telle que nous, humains, la vivons (la torture, l'injustice, la maladie, etc. etc.), mais la vie elle-même, toute forme de vie, est fondamentalement jouissive; c'est en tout cas ce qu'affirme K. En d'autres termes: à la base la vie est jouissance, et c'est ce que nous en faisons qui contrarie et contredit cette qualité première de la vie. Et les contradictions que nous avons progressivement opposées – au cours des deux derniers millénaires notamment –, à cette qualité première de la vie, font que nous l'avons quasiment oubliée! Cet oubli est d'ailleurs probablement l'une des deux principales raisons pour lesquelles il nous est si difficile d'accepter spontanément cette simple affirmation ("La vie est jouissance"), la seconde étant plutôt d'origine judéo-chrétienne, la vie étant, sous cet angle, davantage souffrance, et la "jouissance" se trouvant être une récompense à venir (après la vie terrestre) du courage à supporter cette souffrance (c'est ainsi que je le comprends, mais je peux me tromper...). Bien. Une fois encore je te rappelle que mon but au travers de ces principes n'est pas d'affirmer des vérités vraies, mais d'établir des postulats fondamentaux d'une théorie sur lesquels nous puissions nous mettre tous d'accord en termes de leurs significations, et non forcément de leur véracité. Il me faut donc préciser l'acception que je donne, dans ce contexte (du principe K), aux deux mots "vie" et "jouissance". La vie, est acceptée ici au sens biologique du terme. Le dictionnaire (CNRTL) nous dit: "Ensemble des phénomènes énergétiques (assimilation, croissance, homéostasie, reproduction, etc.), évoluant de la naissance à la mort, que manifestent les organismes unicellulaires ou pluricellulaires." Bien. Cette définition a le mérite de nous mettre sur la piste au travers des trois "mots clés" que j'ai soulignés, mais... sans être fausse, elle est très insuffisante car elle porte en elle contradiction! En effet, ne nous faut-il pas prendre en compte le premier principe de la thermodynamique dès l'instant où nous parlons d'énergie? Or, que nous dit ce principe*: "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme." Dès lors, n'est-il pas hasardeux d'associer "naissance" et "mort" à "énergie" dans une définition de la vie? Si la vie est énergie (et c'est bien l'acception que lui donne le deuxième principe kovanien), elle ne peut donc ni naître, ni mourir. La définition de la vie acceptée dans le principe kovanien serait donc la suivante: "Ensemble des phénomènes énergétiques (assimilation, croissance, homéostasie, reproduction, etc.) que manifestent les organismes vivants." En supprimant "naissance" et "mort", et la caractérisation des organismes de la définition initiale, j'étends par ailleurs, délibérément, le processus de vie au-delà du champ de la seule vie animale ou végétale. Je dis bien: "délibérément" (...). Expliquer ici et maintenant jusqu'où cela pourrait nous emmener serait nous entraîner trop loin de notre sujet. (Gardons-en un peu pour la suite?...) Voyons maintenant ce qu'est la jouissance dans le deuxième principe kovanien, et pour commencer, voyons ce que n'est pas (ou pas exclusivement) la jouissance dans ce principe K!... J'ai souligné le mot "plaît" dans ta phrase car il est symptomatique. En effet, l'acception courante que nous donnons spontanément à "jouissance" est très proche de "plaisir", pour ne pas dire synonyme. Le dictionnaire, ibid., nous dit d'ailleurs: "Plaisir... Action de jouir... plaisir intellectuel, moral que procure quelque chose..." Bien. Le mot "jouissance" emporte bien la notion de "plaisir" dans son acception kovanienne, mais cette notion n'est pas première. La dimension première de "jouissance", dans le principe kovanien, est la dimension... juridique!: "Fait de posséder, d'être titulaire d'un droit... Droit, possibilité d'user, de se servir de quelque chose, d'en tirer des bénéfices, des avantages.", ibid. On le voit aisément, je pense, cette définition juridique n'exclut pas la notion de plaisir: "...tirer des bénéfices, des avantages.", et non des inconvénients ou des souffrances... Le deuxième principe kovanien aurait donc [presque] pu s'écrire ainsi: "La vie est jouissance temporaire d'énergie" ou encore "La vie est le moment pendant lequel un organisme jouit d'énergie", etc. Mais alors il aurait perdu son caractère universel en se réduisant à la vie biologique des seuls organismes considérés comme vivants par l'être humain (or, notre connaissance en la matière est plutôt limité...), et il aurait réintroduit la contradiction évoquée ci-avant. * "Le premier principe de la thermodynamique, ou principe de conservation de l'énergie, affirme que l'énergie est toujours conservée. Autrement dit, l’énergie totale d’un système isolé reste constante. Les événements qui s’y produisent ne se traduisent que par des transformations de certaines formes d’énergie en d’autres formes d’énergie. L’énergie ne peut donc pas être produite ex nihilo ; elle est en quantité invariable dans la nature. Elle ne peut que se transmettre d’un système à un autre. On ne crée pas l’énergie, on la transforme. Ce principe est aussi une loi générale pour toutes les théories physiques (mécanique, électromagnétisme, physique nucléaire...) On ne lui a jamais trouvé la moindre exception, bien qu'il y ait parfois eu des doutes, notamment à propos des désintégrations radioactives. On sait depuis le théorème de Noether que la conservation de l'énergie est étroitement reliée à une uniformité de structure de l'espace-temps. Elle rejoint un principe promu par Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »." (Source Wikipedia) PS: il me reste au moins six à huit points importants de ta critique à adresser... Merci encore de la patience!