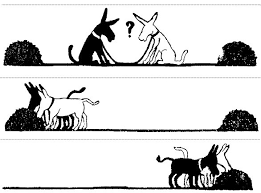-
Compteur de contenus
670 -
Inscription
-
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Blogs
Calendrier
Vidéos
Quiz
Movies
Tout ce qui a été posté par zeugma
-
bonjour Déjà-utilisé, vous donné une forme affirmative à cette phrase "d'ailleurs, j'imagine bien que la vérité n'est qu'une forme dérivée de l'idée de justice justement. Que primitivement Bon et Mauvais/Mal ont donné naissance à des principes secondaires comme vrai et faux, enfin c'est une piste que je travaille..." c'est ce qu'il faudrait développer et analyser dans les fonctions de l'intellection dans l'induction, la déduction, et le syllogisme logique, en partant du fait que ce qui est juste n'est recherché qu'au travers d'une quête, comme ce qui existent a priori comme un bien existent, que la vérité sera alors l'équilibre entre l'indécidable et le défini, comme un acte de justice sans autre coupable que l'ignorance ou l'erreur, mais voulant rendre compte que la connaissance juste est la fin du "procès " intérieur...l'intellection... et puis tu nous dis " Et est-ce que le bonheur, notre bien-être sont concomitants à la vérité ou au savoir ? Je ne le pense pas, en tout cas, ce n'est pas généralisable à tout un chacun !" sans doute mais il y a pourtant un lien de causalité incontournable, c'est que le savoir et la véracité de ce savoir, c'est à dire sa qualité universelle, repousse l'ignorance et l'erreur dans la même mesure que ce qu'il va lui permettre de poser un choix opératif qui sera accepter volontairement comme un bien, et de là une prémisse au bonheur ou au bien être, c'est pourquoi si nous ne pouvons plus délibérer et choisir tel ou tel réalité comme un bien, nous devenons assujettis à une consommation aveugle...ramenant le bonheur à un mimétisme environnementale, et le bien être au plaisir addictif sans cesse renouvelé... bien à toi D.U
-
...ce qui manque à une intelligence est ce qui la fait tenir sa position sans entrevoir celles des autres... la question théologique de la transsubstantiation, est un mystère que seule la foi du croyant "touche" quant il communie, et ne se prête pas à l'investigation de la mesure scientifique, pour cette raison que la finalité de l'Eucharistie est l'édification du corps mystique des croyants par et dans le corps du Christ... que certain est l'arrogance de vouloir tout juger à l'aune de la physique est justement une des raisons qui donne à la foi, à l'espérance et à la charité, une prévalence, car si dieu est inaccessible par l'intelligence naturelle, les voies qui mènent à lui le sont aussi, ce que St Thomas à donné dans la question 75 article 4 de la IIIa pars...je ne post que la fin de l'article : "....Car il est évident que tout agent agit en tant qu'il est en acte. Or tout agent créé est déterminé dans son acte, puisqu'il appartient à un genre et à une espèce déterminés. L'action de tout agent créé se porte donc sur un acte déterminé. Ce qui détermine un être quelconque dans son existence actuelle, c'est sa forme. Donc aucun agent naturel ou créé ne peut agir que pour changer une forme. C'est pourquoi toute conversion qui s'opère selon les lois de la nature est une conversion formelle. Mais Dieu est l'acte infini, nous l'avons vu dans la première Partie. Aussi son action atteint-elle toute la profondeur de l'être. Il peut donc accomplir non seulement une conversion formelle, c'est-à-dire obtenir que des formes se remplacent dans un même sujet; mais il peut produire une conversion de tout l'être, c'est-à-dire dans laquelle toute la substance de ceci se convertisse en toute la substance de cela." Et c'est ce qui se produit, par la vertu divine, dans ce sacrement. Car toute la substance du pain est convertie en toute la substance du corps du Christ, et toute la substance du vin en toute la substance du sang du Christ. Cette conversion n'est donc pas formelle mais substantielle. Elle ne figure pas parmi les diverses espèces de mouvements naturels, mais on peut l'appeler " transsubstantiation", ce qui est son nom propres." Si nous pouvions passer par l'expérimentation scientifique au delà de ce qui constitue la nature matérielle de la quantité et de la quantité, il serait possible de saisir les déterminations spécifiques de l'Eucharistie, qui est la réalisation en acte dans les espèces sensibles du pain, de ce qu'elle réalise en nos âmes si nous sommes croyants, mais puisque ce sacrement est destiné aux seules croyantes et croyants, il est tout à fait normal qu'il échappe dans sa nature et ses effets aux athées, sinon à quoi servirait la conversion de l'intelligence par la foi, de la mémoire par l'espérance et de la volonté par la charité ? dieu fait que certains reste hors de ce mystère et c'est bien ainsi, vu ce qu'il en ferait... P.S les bla bla bla du sieur zenalpha sont en effet la transformation de son ignorance en un langage inepte, puisqu'il ne peut accéder à la vraie connaissance de ce qu'est l'eucharistie...
-
bonjour Déjà-utilisé, effectivement, quand je te disais ce qui sera à développer, à mon sens, c'est en quoi elles sont toutes deux, science et philosophie, contributives du destin de l'humanité comme phénomène vivant...j'avais une idée en tête... développement propositionnel l'humanité est un phénomène vivant, "phénomène" car c'est autant une "existence collective" en devenir dans un milieu de vie, qu'une appropriation personnalisée et identifiée en chacune de nos individualités, la présence de notre corps respectif, de ces fonctions vitales et de ces opérations intellectuelles et volitives... un petit aparté la distinction intelligence/volonté n'étant pas acceptée par tous, je ferais en sorte de ne pas l'utiliser comme argumentaire central de cet exposé, puisque qu'il va s'agir de commencer à donner à la science et à la philosophie leur place respective, et contributives à l'intelligibilité générale que l'humanité à d'elle-même...et que la distinction : intelligence/volonté n'est pas acceptée par tous les scientifiques et par tous les philosophes... premier regard critique sous forme de questions... 1/ est-ce que cette distinction entre intelligibilités scientifique et philosophique est réelle, légitime et donc définissable ? 2/ quant à leur assignation à contribuer au destin de l'humanité, est-ce au niveau a) de leur fonction discursive et récursive ou/et b) de leur appartenance au bien commun de l'humanité, que cette contribution doit s'inscrire ? réponses : 1/ considérations générales de la distinction entre science et philosophie... si ce que nous connaissons, est presque toujours conditionnellement un "comment" ou/et un "pourquoi", c'est que le mode naturel de l'abstraction, nous présente le réel sous un seul aspect, mais sous deux modes d'inférences... l'aspect c'est la présence sensible (même pour des connaissances scientifiques, qui reviennent sensiblement in fine sous formes de lecture de résultats ou écoutes des autres) , les inférences sont " comment cela est ainsi " et "pourquoi cela est comme ceci ", le comment serait donc une inférence des causes : formelle, efficiente, matérielle et exemplaire du réel, le pourquoi serait une inférence de la cause finale... les sciences étant dans l'inférence du comment et la philosophie dans l'inférence du pourquoi et du comment aussi...(toutefois, la répartition qu'effectue les cinq causes étant aussi sujet de non-recevabilité pour certaines personnes, je ne baserais pas non plus toute cette approche sur la distinction entre science et philosophie uniquement dessus)... alors la distinction entre science et philosophie ne se trouverait-elle pas aussi dans la direction de performativité distincte aux deux...? la science en faisant un compte rendu performatif du réel par son intelligibilité de cohérence interne théorie/expérimentation/preuve/reproductibilité...opterait pour une direction descriptive du réel significatif...(la signification) la philosophie en faisant un compte rendu performatif du réel par son intelligibilité : définitionnel, non-contradictoire, logique, de totalisation et d'admissibilité...opterait pour une direction interprétative du réel signifié...(le sens) nous voyons donc si cela s'avère exact, que leur distinction dénote avant out leur complémentarité, dans ce qu'elle ont toutes deux "affaire au réel" et donc par ce qu'il a de distinction en lui aussi, entre sa multiplicité d'objets et sa diversité d'objets...la signification provenant de la comparaison numérique des objets, le sens provenant de l'appréhension de la diversités des objets... pour allez plus loin, si la distinction entre science et philosophie n'est pas une séparation puisque elles ont toutes deux une légitimité propre et aussi une légitimité commune (comme essayera de le montrer le prochain post) peut-on quand même voir en chacune d'elles une différentiation fonctionnelle stricte, au point ou nous en déduirons qu'elles soient incompatibles dans leurs discours conclusifs...? non...en fait car si nous distinguons ce qui motive la dynamique constitutive de chacune d'elles, nous aurons nécessairement à leur accorder une similitude au niveau de la recherche de la véracité, une équivalence dans la "respectabilité" qu'elles acquièrent en t'en que produites par l'intelligence humaine qui cherche le bien et le bon, même si l'équivalence en bon et bien n'est pas totale, comme nous allons le développer dans le 2ème moment de cette question... mais il est dès à présent possible de faire émerger une définition de la distinction entre science et philosophie, en disant qu'elle est : une possibilité de saisir symétriquement une appropriation des objets et limites distinctif du réel matériel, et conceptuel... 2/ tout d'abord qu'est-ce que la fonction de l'intelligibilité en générale, me direz-vous ? en disant que cette fonction à une double signification, de mission (vers le bien) et de régulation(par le bon), je vous dirais qu'elle est à la fois dynamique et statutaire de l'intelligibilité de chacune, la science étant à la recherche du bon comme équivalence du vrai dans une régulation du savoir, la philosophie étant à la recherche du bien comme équivalence de la vérité, c'est sa mission, appelée sagesse parfois... et donc cette fonction/mission/régulation est de faire passer de l'inconnu au connu et du connu à l'inconnu, car étant des êtres en devenir, nous sommes toujours entre deux rives...la rive de l'inconnu/connu car si nous posons un question c'est que nous partons d'un inconnu, et l'autre rive, car si nous posons une explication ou une explicitation, c'est que nous admettons un connu... ainsi selon moi, nous sommes entre ces deux rives comme sur un pont qui avance avec le courant (le réel) ... et ce serait cela la fonction de l'intelligibilité, de flotter sur le courant du réel , ce qui pourrait s'appeler "un radeau", avec comme objectif, d'étendre la superficie de ce dernier, jusqu'à ce qu'un jour peut-être nous puissions faire toucher les deux rives de l'inconnu/connu et du connu/inconnu... mais là où commence une métaphore, là aussi elle doit finir, car maintenant il faut essayer de dire ce que sont spécifiquement l'intelligibilité scientifique et l'intelligibilité philosophique...d'ailleurs plus tard il faudra revenir sur la notion de "fonction"... a) ce que je désigne comme l'intelligibilité scientifique discursive, c'est une abstraction formelle qui construit un champs représentatif logique à partir de la saisie d'éléments significatifs, propres à établir des liens de causalité stable ou évolutif du réel... ce que je désigne comme l'intelligibilité scientifique récursive, c'est une modélisation théorique qui structure les éléments significatifs du réel et certaines causes stables et/ou évolutives, en vue de rendre compte des lois et qualités des réalités observées... ce que je désigne comme l'intelligibilité philosophique discursive, c'est l'aptitude de l'abstraction proprement subjective, qui recherche à établir par la signification que chaque réalité à en elle-même, un sens universel au réel... ce que je désigne comme l'intelligibilité philosophie récursive, c'est la compréhension du réel objectif et subjectif comme : définissable, analysable, structurelle et porteuse d'un sens, en vue de poser (ou pas) dans un discourt universel, un compte rendu du double réel, subjectif et objectif... maintenant entrons dans le centre du questionnement, et essayons de développer en quoi science et philosophie, sont contributives du destin de l'humanité comme phénomène vivant... pour ce faire je vais déroger à la recherche de ce que sont les qualités inhérentes à "la contribution, pour voir tout de suite le "en quoi", car avec ce qui peut être mis déjà sous "l'étiquette"du terme "contribution", nous pourrions remplir toi et moi, plusieurs dizaines de pages bien serrées de lignes bien denses de termes biens complexes... et donc je préfère partir des liens historico-évolutifs, par lesquels l'intelligence humaine a et peut utiliser les deux types d'intelligibilités, scientifique et philosophique, pour désigner sa propre direction, voir s'accorder sa propre destinée, voir se définir elle-même comme sa propre destination, voir assumer son propre destin...les moments ci-dessous, désignent indifféremment l'intelligibilité scientifique et philosophique, car ce que je veux établir c'est d'abord en quoi elles sont toutes deux unies dans le champs évolutif de l'intelligibilité humaines... toutefois, une simple lecture donnera déjà les lieux et moments où l'une et l'autre dominées... premier lien : le moment où l'intelligibilité devient normative d'un savoir... (pierre taillé, maîtrise du feu, perfectionnement des techniques de productions etc...) deuxième lien : le moment où l'intelligibilité devient une souscription à un modèle comportemental... (édification des lois, consensus des mœurs, régulation de l'agir morale et du faire pratique par le politique.) troisième lien : le moment où l'intelligibilité devient une garantie de rétrocession du réel... (modularité des savoirs théoriques, interventions sur les causes de la vie, reproduction, maladies, accidents...) quatrième lien : le moment où l'intelligibilité devient une construction spécifique... (théorisations, systématisations, idéologies, dogmes, structures sociétales politiques etc...) cinquième lien : le moment où l'intelligibilité devient une constatation décisionnelle de l'action humaine... (religions, choix spéculatifs, choix pratiques, responsabilisations personnelles, usages des moyens techniques...) nous voyons donc que selon ces liens historico-évolutif, les intelligibilités scientifique et philosophique ont eu part et ont part, tout comme, auront part au destin de l'humanité comme phénomène vivant, mais "en quoi" l'une et/ou l'autre auraient une prévalence, sera débattu dans un prochain post, puisque "la petit idée exprimée ici", est déjà sujette évidement à amendements... bien à toi Déjà-utilisé...
-
Le vide, le néant, l'homme et sa vacuité
zeugma a répondu à un(e) sujet de zenalpha dans Philosophie
voilà ce que j'attendais de lire avec impatience depuis plus d'un mois que je vous ai rejoins sur ce site... avec cette dernière phrase et toutes celles que tu nous as donné, Déjà-utilisé, nous pouvons commencer ce travail sur : qu'est-ce que l'intelligibilité naturelle...? merci grandement à toi D-U.... -
Le vide, le néant, l'homme et sa vacuité
zeugma a répondu à un(e) sujet de zenalpha dans Philosophie
à quel moment et à quel propos peut-on alors s'exprimer? ...et rechercher la vérité en philosophie, ou comme un citoyen parmi les autres ? si toutes mes interventions sont sous-tendues par une forme revendicatrice, c'est que le "climat" intellectuel devient l'unique point de vue du positivisme des sciences, alors je te retourne ta phrase Samira en te disant : Le monde ne peut pas être juste ce que tu voudrais qu’il soit, en éliminant tout ce qui ne correspond pas à ta vérité, ce n’est pas parce que certaines choses te dérangent qu’elles ne doivent pas exister.... pour le reste de ton post, qui pose encore une fois la confusion entre le vrai scientifique et la vérité plus universelle, parce qu'elle inclus le bien et la pérennité de la vie, quand tu voudras en débattre en t'en que personne responsable du bien commun, tu me feras signe ou pas.... P.S je suis sur ce site pour commencer un travail de fond sur l'intelligibilité humaine, et je ne perdrais pas plus de temps dans une opposition stérile avec des scientistes... -
ha si si pour moi l'expérience physique de la pollution est une mise à l'épreuve de la réalité d'une destruction progressive de la nature, mais cela n'empêche pas que nous ne pourrons pas échanger là dessus, tant que vous en serez à justifier l'injustifiable sur l'intelligibilité propre de la science dans sa responsabilité de ce fait...
-
non non tu ne rêve pas il m'a fustigé là où j'était d'accord avec lui pour une fois ... n'est-ce pas curieux cela...comme si l'opposition radicale lui était devenue une addiction, et qu'une légère privation le fasse entrer dans un état de manque...ha la la ces junkies scientistes...
-
Jedino bonjour...il est intéressant de poursuivre ce débat, car il fait apparaître la distinction entre notre connaissance respective de l'objectivité et de la subjectivité, qui nous sera utile quand nous aborderons les questions et les inférences sur l'IA... vous aurez aussi tout au long de ma réponse aux passages de votre texte ci-dessous (que je souhaite avoir "découpé" au bon endroit ) un fil rouge que je présenterais sous le titre : "la connaissance scientifique ou l'art de faire muter le sens en signification" n'y voyez rien de dégradant dans cette "mutation", car nous sommes ici sur un terrain qui échappe à la morale ou à une quelconque déontologie supérieure, mais juste à la logique interne de l'intelligibilité scientifique... ainsi le premier passage cité sera celui ci : "Je ne définis pas ainsi l'objectivité puisque je parle de ce que j'appelais la "vérité subjective". La preuve n'est pas l'interprétation du réel, elle est seulement ce qui permet d'attester que la théorie, l'affirmation, avancée est avérée." ce que j'avais mis en avant dans le passage faisant de la preuve comme "vrai objective" devenant "vérité subjective" à l'intelligibilité scientifique, c'est justement cette mutation de la signification en sens... ainsi personnellement je perçois que la preuve scientifique en t'en qu'attestation de la véracité de la théorie, opère aussi un ancrage inductif logique du "vrai objectif " comme "vérité" pour le sujet qui l'a mise à jour, le scientifique... et donc fait muter ce que "signifie" cette preuve, à savoir "d'attester que la théorie, l'affirmation, avancée est avérée." en une vérité trans-personnelle puisqu'elle dégage un "vrai universel" ( cette preuve n'appartenant pas au domaine de la conviction individuelle mais de l'objectivation matérielle via la théorie) qui repositionne l'intelligence dans un au delà de sa limite subjective... c'est sans doute pour cela que vous ajoutez : "Cela explique également qu'il est possible de ne pas y croire. Est-ce un travers de ma propre foi en la science ? Possible. En tous les cas, je note que ce qu'elle prouve est bien plus vérifiable qu'aucune autre chose de notre existence. En cela, je crois, en effet, que son degré de certitude est plus grand que le reste, ce qui n'enlève rien à la valeur du reste." c'est en disant : "ce qu'elle prouve est bien plus vérifiable qu'aucune autre chose de notre existence" que la mutation de la signification logique de l'intelligibilité scientifique devient un sens pour cette même intelligibilité, ceci est clairement exprimée, puisque vous dites "ce qu'elle prouve" c'est à dire "sa signification", est justifiée par le "bien plus (grandement) vérifiable", et cette vérification positive devenant l'archétype du vrai, c'est à dire "un sens" "une vérité"qui s'impose devant toute autre chose de notre existence...la mutation est effectuée, comme isométrie positive entre signification et sens...(j'avais relevez le même glissement sémantique lors d'un échange avec Zenalpha) not bene : il est à noter que vous dites aussi : son degré de certitude est plus grand que le reste, comme si la quantité graduelle (plus grand) était l'aune de la véracité dans le domaine de la preuve scientifique par l'extension numérique de cette l'intelligibilité du réel matériel, en un faisceau concentrique de vérifications propres à saisir par l'addition, ce qui est du domaine de la certitude...(ceci se retrouve aussi dans la notion de réplication et de reproductibilité de l'expérimentation comme validation de la preuve j'y reviendrais) ... ce qui me semble bien décrire en quel contexte vous inscrivez cette preuve, puisque si vous lui conférez la signification d'être l'énoncé de l'exactitude de la théorie par l'expérimentation, elle soit de facto la mesure qui domine la qualité par la quantité (exactitude).... ainsi si vous aviez dit : "son degré d'évidence est meilleur que le reste des évidences " j'aurais juste ajouté : certes vu la diversité des évidences, certaines sont soutenues par des preuves objectives scientifiques irréfutables...mais vous ne l'vez pas dit comme cela... pourtant vous avez ensuite ajouté : "Donc, en soi, nous pourrions dire qu'une preuve n'est jamais qu'une interprétation du réel (en tant que perception particulière) permettant d'attester qu'une autre interprétation, supposée universelle, l'est suffisamment pour être portée comme telle." là je vous rejoint entièrement... après au sujet de la lumière et de l’œil vous dites : "De fait, la lumière n'est pas l'acte de la vision, c'est bien la réception de la lumière sur l'organe permettant de le (la) percevoir et par la suite de l'interpréter qui l'est." c'est que vous n'avez pas suivit la notion "d'acte" ainsi que je l'avais explicité, puisque vous faite de la réception de la lumière sur l'organe " œil " cet acte, alors que cette réception n'est que l'actualisation de la potentialité de l’œil, c'est-à-dire l'activation de sa capacité à voir... ainsi je disais que la lumière est l'acte propre qui à produit l'évolution de la potentialité de voir comme finalité de l’œil... la distinction entre acte et activation, ne semble à première vue qu'une bien petite chose, mais se trouve justement très importante dans le prima de l'acte sur la puissance...et va finir par nous faire voir le réel sous un mode différent si vous mettez la puissance comme prima sur l'acte...ce que fait l'intelligibilité scientifique qui part de la potentialité de la matière(observation des phénomènes et modélisation des données significatives), donc des effets pour recherche les causes de ses activités...j'y reviendrais aussi plus tard... car la fin de votre paragraphe est plus significatif encore de ce retournement car vous dites : : C'est même plus complexe que cela puisque la vision consciente que nous avons n'est pas le réel tel qu'il nous apparaît mais l'interprétation de ce que sera le réel dans le micro instant qui suit par notre cerveau." il y a dans cette phrase un des glissements qui me met le plus en colère intellectuellement dans se passage :" la vision consciente que nous avons n'est pas le réel tel qu'il nous apparaît" . là encore est-ce à dire que ce que je vois et la conscience que j'en n'ais sont deux choses différentes ou juste distinctes ? oui au plan biologique donc et réactif de la pupille et de la figuration imaginative, mais non si je prend la vue comme un tout organique qui naturellement me donne des informations sur mon environnement visible...je n'insiste pas sur ce point maintenant ce qui suit est plus intéressant... vous ajoutez : "Au contraire, quand je parle de "vérité objective", je l'entends comme le fait qu'elle est relative à l'objet lui-même, la lumière, qui est indépendant de tout sujet." je suis d'accord sur ce point... " En cela, c'est un objet de science, ce qui n'empêche pas de croire des choses fausses à son sujet. Il n'empêche, et comme je le disais plus haut déjà, l'ignorance ne justifie pas de le placer dans la subjectivité." là aussi je suis d'accord, mais il faudrait ajouter, que le verbe croire: "de croire des choses fausses à son sujet" suggère que ce n'est que par la croyance, et donc subjectivement que je peux m'attacher à une fausseté à son sujet, alors qu'une théorie peut être elle aussi fausse pour tout un tas de raison...l'emploi par vous de ce verbe "croire" ne peut pas être fortuit, puisque vous avez quand même un niveau logique du langage assez cohérent et précis, cet emploi doit donc être sciemment posé là comme ligne de démarcation entre l'objectivité et la subjectivité...car c'est en ajoutant in fine :" l'ignorance ne justifie pas de le placer dans la subjectivité." dit bien que pour vous la connaissance en sa pleine signification est une connaissance qui est objective et scientifiquement prouvable, mais que ce qui est subjectivement cru ou su par un autre moyen que l'intelligibilité scientifique reste "sujet à interprétation" plus ou moins fausse ou vraie, mais indécidable comme réalité universelle... ce qui est curieux c'est que vous reprenez la notion de foi dans ce passage : " il est exact que j'ai davantage foi en un fait qui se montre reproductible et prédictible qu'en une assertion dénuée de tout fondement ". comme nous l'avons mis en évidence dans le forum sur le scientisme, la "foi "en la science est une sécularisation de la foi religieuse sous un aspect de logique positiviste...si cette "foi" n'était pas cause aujourd'hui de tant de décisions contre-nature je n'aurais rien à y redire, mais j'y vois une des causes de notre dérive comme je vous l'avais dis dans un autre échange... vous poursuivez et dites :" En revanche, je le considère comme étant pour l'heure l'accès le moins mauvais pour accéder à ce qu'est la réalité. J'ai précisé plus tôt dans ce sujet que j'entendais la vérité comme moyen de tendre vers la réalité, comme étant, je cite : " la vérité n'est qu'un regard humain porté sur la réalité, elle est donc par essence une vision particulière de ce qui est ". Il me semble assez clair que je ne considère pas la science comme la réalité ultime, bien que je le (la) considère effectivement comme le meilleur moyen existant pour y tendre. "le moins mauvais" le choix du moindre mal pour moi n'est pas suffisant... "la vérité n'est qu'un regard humain porté sur la réalité" pour la philosophie réaliste, la vérité est l'adéquation de l'intelligence avec le réel...veritas est adaequatio rei et intellectus... "bien que je le (la) considère effectivement comme le meilleur moyen existant pour y tendre." pour ma part, je préfère la voie de la contemplation... vous concluez: "D'ailleurs, je n'ai pas le sentiment non plus que notre désaccord soit si profond que cela sur le sujet qui nous concerne." sans doute pas dans notre motivation respective à tendre vers le bien comme fin, mais reste les moyens intellectuels que nous choisissons pour y parvenir, qui eux sont issus de deux acceptions du réel, qui par moment se complètent, par moment se contredisent et quelques fois même s'opposent...
-
voilà tout ce à quoi se résume la critique de ceux qui ne peuvent pas admettre que même à partir de théories vérifiées expérimentalement ayant valeur de preuves, le réel ne leur appartient pas...et qui veulent enfermer toute l'intelligibilité humaine dans une représentation du monde, ou plutôt dans une explication du monde des phénomènes... ai-je dis une seul fois ce que cette personne me reproche ? Le soleil ne tourne pas autour de la terre et la theorie physique n'a pas predit l'existence d'objets physique avant l'expérimentation ou l'observation... non pas une seul fois j'ai opté pour un modèle de représentation du réel qui serait "héliocentriste"ni me suis opposé à ce qui fait une des spécificités de la théorisation, à savoir, son extrapolation prédictif à partir de données générales, de l'existences de lois dynamiques et d'objets particuliers... donc ce qui est maintenant nécessaire, c'est de savoir pourquoi il existe chez certaines personnes cet enfermement ou plutôt ce réductionnisme formel... qui peut aller du cognitivisme au connexionnisme, pour fonder une connaissance structurelle du raisonnement... et de la logique modale à la logique inductive, pour fonder une théorie logique du langage... P.S pour alimenter notre connaissance, cet article d'Alexandre Monnin : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB_JeY2_rRAhXLcRQKHTZ8DPYQFghEMAU&url=https%3A%2F%2Fhal.inria.fr%2Fhal-01151072%2Ffile%2FL_ingenierie_philosophique_de_Rudolf_Car.pdf&usg=AFQjCNHnGpQUd51oSlpDKlaL8yboLG884g&sig2=hNHTedcrCoyw57TgPhm9tQ En cache Pages similaires
-
Le vide, le néant, l'homme et sa vacuité
zeugma a répondu à un(e) sujet de zenalpha dans Philosophie
bonjour à toi nolibar, ce que tu dis semble résonner comme le bon sens, qui mènerait tout à chacun de ses imperfections vers un équilibre vertueux, constant, évolutif, de notre conscience... et pourtant est-il uniquement besoin de se driver pour être au monde, en symbiose, même partielle, et par cet équilibre, ouvrir un futur durable de vie et de bonheur ? n'y a-t-il pas une dimension humaine qui ne peut se résoudre à emprunter la voie du milieu, comme le suggérait Confucius, et qui serait cause de notre exaction continuelle, une sort d'irrecevabilité du réel, qui mettrait en porte à faux l'humanité et le monde, depuis "toujours" comme l'on dit, et même si ce "toujours" est lui même une projection impropre de la durabilité de notre recherche de stabilisation naturelle, il serait peut-être instructif de le prendre en compte pour élucider la spécificité propre du destin de l'espèce humaine... -
vous vous offusquez parce que viens de toucher juste dans votre tendance de fond à proposer l’intelligibilité scientifique comme première et mesure de toute l'intelligibilité du réel présent et futur... et vous réagissez comme un enfant à qui on enlève son jouet...mais vous n'êtes en fait qu'un butor doublé d'un obscur réductionniste, c'est en faisant de telles déformations de la réflexion des autres personnes que vous dressez la table à toutes les formes de scientismes possibles... alors que je disais en réponse à cette phrase de vous: Elles touchent les faits experimentaux et c'est presque "magique" que la prediction ou la retroaction d'un fait collé parfaitement à la theorie "non c'est logique...le réel est la cause et vos théories n'en sont que le reflet formalisé..." vous n'avez même pas essayez de reprendre mon argumentaire et vous monter dans les tours, comme un artiste à qui on dit que son oeuvre est moche... si votre probabilisme vous tient tant à coeur comme statisticien, ne le mettez pas continuellement comme preuve que l'intelligibilité scientifique oeuvre pour le bien de l'humanité c'est assez révélateur de la confusion que vous faite entre le beau harmonique des mathématiques et le bien de la pensée qui semble continuellement et totalement vous échapper... P.S un bon conseil ....ne perdez plus de temps à me lire si cela vous bouffe le foie ou la foi que vous avez dans l'intelligibilité scientifique comme source unique de savoir...
-
l'intelligence organisationnelle pose aussi une question dont il me semble que peu de personne font cas...je veux dire la complémentarité des systèmes d'informations...ces nœuds informatifs sont autant de source de diffraction du savoir que de causes de déformation des informations, ce qui est plus le cas dans la gestion informatique des informations, mais qui se retrouve aussi en toute projection d'une réalisation inter-disciplinaire... les différents "langages" tant en science avec les mathématiques, que dans la programmation en langage informatique, inclus une re-conceptualisation sous un mode de fonctionnalité logique, mais pas de cette logique qui nous est commune avec la philosophie, plutôt un logique post-inductive qui pose comme acquis la part décidable, et synthétise l'organigramme comme étant lui même un concept...( "la monade" dans le langage informatique) et le principe de non-rétrocession en mathématique (le processus de Markov) ou (constructivisme de brouwer avec les mathématiques intuitionniste)... alors que la logique "antique" fait que : " L'induction est historiquement le nom utilisé pour signifier un genre de raisonnement qui se propose de chercher des lois générales à partir de l'observation de faits particuliers, sur une base probabiliste. "(citation de Mr Wikitruc) la logique post-inductive inaugure une systématisation de l'entrée d'une donnée comme positive quantitativement, quelque soit sa valeur qualitative... il suit donc que l'intelligence organisationnelle qui opte pour cette systématisation, nous fait entrer dans la notion d'une néguentropie du savoir, avec des caractéristiques de cohérence quantitative des données et plus par ce qui nous faisait naturellement émerger de l'entropie de l'inconnu de la pensée humaine, à savoir sa qualité de saisir le bien dans son unité avec le vrai... la suite plus tard...
-
Le vide, le néant, l'homme et sa vacuité
zeugma a répondu à un(e) sujet de zenalpha dans Philosophie
c'est bien d'avoir ce sens de l'autocritique nolibar, mais tu devrait quand même te rendre compte que des décisions sont prisent dans le monde tous des jours à partir de conceptions erronés et dangereuses...qu'il faut mettre en lumière pour garder un semblant de vie collective et de vie tout court... et si je reprend ton "ex libris": "En toute chose, il ne faut pas rechercher une vérité qui nous convienne, parce qu’elle nous rassure, flatte notre ego, mais tout simplement la vérité. Celle-ci ne sera pas forcément à notre goût. Un véritable savoir, gage de plus de liberté, ne peut s’acquérir qu’à ce prix." il me semble pourtant que tu es un vrai chercheur... -
Le vide, le néant, l'homme et sa vacuité
zeugma a répondu à un(e) sujet de zenalpha dans Philosophie
bonjours Samira, tu dis : "personne n’impose de croire ce que dit (disent) les scientifiques" tu es vraiment sérieuse quand tu dis cela ? tu sais fort bien que ne pouvant matériellement pas refaire tout le processus de recherche dans tous les domaines que les scientifiques explorent, une part de confiance, non seulement dans l'exactitude de leurs résultats, mais aussi dans la méthodologie utilisée, et surtout sur le bien fondé de ces recherche, conduit à "croire" que ses résultats sont justes, mais plus encore, bien menées, et surtout justifiés...d'ailleurs ce verbe "croire" que tu emplois souvent révèle bien de quoi il s'agit, c'est de prendre la science pour une pourvoyeuse de bonne parole, quelque chose entre une religion et une académie/usine de production d'idées sur le monde... que certaines recherches scientifiques partent d'un problème humain concret, pour en circonvenir les causes et en déduire des effets positif à la résolution de ce problème, il n'y a rien à dire, plutôt à applaudir, mais que l'expertise scientifique fasse glisser la conscience communautaire dans une forme de soumission comme celle de l'élève dans la classe de son professeur, c'est un abus de pouvoir et un détournement d'autorité... puis tu dis:"ils décrivent ce qu’ils ont vu non ce qu’ils ressentent." non...voir est aussi ressentir, sauf si tu pense que l’œil du scientifique et l'interprétation qu'il a de sa vision ne sont plus humain, mais quelque chose de tellement objectif, que c'est quasiment ce que qu'enregistre son microscope électronique... c'est d'ailleurs sous cette erreur de jugement d'existence qu'il arrive parfois le pire aux scientifiques, c'est-à-dire d'être tellement convaincus que ce qu'ils expérimentent est inconditionnellement vrai, que le bien fondé de cette recherche l'est aussi... c'est de ce glissement que je parle ici et là sur ce forum et dont il faut être conscient, car faute de le contenir et de remettre l'esprit scientifique dans une voie qui profite au bien de tous, nous allons vers une hégémonie de l'intelligibilité scientifique...oups, mais c'est déjà le cas...j'ai dû rater un épisode de la série "je peux tout et j'en profite"... puis tu ajoutes : "A aucun moment, je n’ai évoqué qu’il fallait remettre en cause les représentations du passé de certains par exemple comme tu fais allusion aux traditions… " pourtant tu as dis : 1/ -Oui parce que les connaissances sont à l’infini et 2/ on a l’impression que pour certains parce qu’ils vivent de telle façon dans le présent, 3/ils ont du mal à comprendre 4/que la représentation du passé ne corresponde pas à ce qu’elle est dans le présent, ce qui pourtant est impossible. tout d'abord, 1/ tu postules que les connaissances sont infinies, mais je t'ais dis qu'il fallait distinguer l'infini en acte et l'infini en puissance, les sciences recherchent méthodologiquement dans cet infini en puissance, elles peuvent donc ce passer de l'infini en acte, qui est pris en compte dans certaines traditions philosophique et religieuses aussi... puis tu dis 2/: tu conditionnes la connaissance de "certains" (que tu ne nomme pas) par ce qu'ils vivent de telle façon dans le présent, ce "de telle façon" n'est ce pas ce qui désigne les personnes qui ne vivent pas avec le réalisme scientifique comme mesure de leur jugement d'existence ? et tu ajoute: 3/ "ils ont du mal à comprendre", mais qu'est-ce qu'est ce mal à comprendre ? et de quel point de vue te places-tu pour dire qu'ils ont du mal à comprendre ? car enfin tu affirmes : 4/"que la représentation du passé ne corresponde pas à ce qu’elle est dans le présent", si tu fait correspondre uniquement des représentations, tu pourrais aussi bien dire l'inverse, si tu étais passéiste, mais il ne s'agit pas que de représentation, mais de savoir si l'intelligibilité scientifique apporte une part nécessaire et incontournable de connaissance à l'évolution de la connaissance humaine... la représentation est comme l'intuition/inspiration dont tu parles ensuite, une question de jugement de valeurs, mais pas ce qui est universellement partagé par tous les êtres humains... pour la fin de ta phrase :" ce qui pourtant est impossible."tu veux surement dire qu'il n'est pas possible de comprendre le présent uniquement à la lumière du passé, ce qui est une évidence mais aussi n'exclus pas que la lumière du passé nous soit en partie indispensable pour comprendre le présent et envisager le futur...sans quoi nous serons à la merci de l'inventivité compulsive du marché et de la rentabilité...oups, mais c'est déjà le cas...j'ai dû rater un épisode de la série "je peux tout et j'en profite"... question subsidiaire : est-ce à dire que tu penses que les scientifiques par leur recherche se sont totalement émancipés du conditionnement de leur vie, et perçoivent le réel tel qu'il est sans interférence de leur propre vécu ? tu continues en disant : "......vu l’évolution, il peut y avoir modification." dans tout ce paragraphe tu t'en tiens à comparer tel résultat scientifique avec tel autre, juste en disant que la progression des savoirs est linéaire et qu'il y un mieux évolutif intrinsèque de l'intelligibilité scientifique, mais cette progressivité est-elle toujours justifiée dans le champs de la connaissance générale des idées ? et surtout la direction induite de la recherche scientifique est-elle dû à la logique d'un continuum d'intelligibilité spécifique à chaque science, ou à une intra-régulation des savoirs, qui pose comme nécessaire cette recherche après celle ci, parce que la matière est saisie formellement à travers ses points de variations ? mais tu ne poses pas en parallèle ces deux questions, car ce serait sans doute replacer la recherche scientifique comme relative au savoir générale... tu poursuis en disant : "ce ne serait plus de l’objectivité mais de la magie, de la croyance que de croire qu’un scientifique doit tout savoir même ce qu’il ne connaît pas ou ce qui n’existe pas en connaissance dans son présent… " en effet l'objectivité doit rester humaine, et ne pas être captive de l'intelligibilité scientifique, pourtant sous un aspect d'humilité que tu prêtes au devenir (évolution) de l'intelligibilité scientifique, tu la démarque de la magie, de la croyance... mais ses deux formes de connaissances ne sont pas admises sous le même rapport, et surtout pas vers la même finalité, et de ce que l'humanité perçoit du réel... dire que : puisque l'objectivité scientifique est évolutive et qu'elle est toujours dans l'incomplétude de son savoir propre sur la matière....ne conduit pas à nier toutes les autres connaissances théologiques, et même "surnaturelles" ou "paranormales"comme on dit... là encore tu semble placer l'objectivité scientifique comme mesure du vrai de toute la connaissance humaine...ce que je récuse... tu conclus :" Enfin peu importe, mon avis était plus de définir ce qu’est la subjectivité pas (de l') d’exposer dans le détail…" bizarre cette conclusion d'ailleurs, car une définition n'a-t-elle pas en vue d'énoncer ce qu'est la chose le plus synthétiquement possible ? y incluant les occurrences détaillées sous une forme circonscrite ? ainsi la définition de l'inspiration correspond beaucoup mieux au mode subjectif de la recherche scientifique que la définition de l'intuition...pour les raisons que j'ai développé dans mon dernier post...et que je reprend dans le P.S pour ma part je conclurais en te citant une dernière fois : "La recherche d'une vérité, c'est qu'elle a son utilité, que cela soit pour la personne elle-même, pour certains ou pour tout le monde." cette phrase révèle deux chose de ta conception de la vérité: la première c'est que tu dis la recherche d'une vérité, c'est à dire, soit d'une part de la vérité, soit d'une vérité qui soit autonome et circonscrite, cela est bien la définition du "vrai" atteint par la science, mais ne peut servir de "vérité" pour la conscience collective, puisque une vérité qui est partielle, même en étant vrai ne peut rendre compte de la totalité du réel...qui est ce qui est bon et ce qui est bien... deuxième chose, tu ramènes la notion de vérité à une utilité, et c'est aussi un abus de définition (puisque tu sembles y tenir) de la vérité, car la vérité est "infiniment" autre chose qu'une utile connaissance, mais bien ce par quoi l'intelligence humaine se détermine (sa gratuité) , qui inclus sa direction et son mode de fonctionnement(sa simplicité), mais aussi ses choix et la garantie de rechercher un bien (sa finalité) , que nous appelons aussi le bonheur... dans cet élargissant de la notion de vérité, son utilité est amplement assumée par trois autres qualités, qui sont : sa gratuité, sa simplicité, et sa finalité...oublier ces trois notions, ou réduire la recherche de vérité juste à son utilité personnelle, individuelle ou collective, fini tôt ou tard à ne la considérer que dans son usage rationnel, et plus du tout dans sa finalité contemplative... P.S : l'intuition naît d'un inconnu subjectif, et alors que ce qui fait naître l'inspiration, c'est un connu objectif, une matière... ainsi la recherche scientifique tout comme l'expression artistique est une inspiration, car ce qui la fait naître c'est une dynamique de recherche logique ou esthétique à partir d'un connu observé (science) ou imaginaire (arts) et qui fait reculer l'inconnu... ce sont des créativités... alors que l'intuition c'est l'inverse, c'est un inconnu spontané ou provoqué qui fait reculer le connu... -
...évidement, si votre intention était de dire innocemment ce que d'autre pouvait comprendre coupablement, c'est que la maîtrise du langage recèle parfois des pièges inhérents, que même une bonne volonté comme la votre ne peut déceler et donc éviter... c'est pas grave on vous pardonne ce manque de précision involontaire... quant aux rêves prémonitoire bien sûr qu'ils sont une réalité, mais ce n'est pas ici et avec vous qu'il serait profitable d'en parler...
-
Le vide, le néant, l'homme et sa vacuité
zeugma a répondu à un(e) sujet de zenalpha dans Philosophie
1/ la loupe n'est pas accessible à tous et tout le temps donc elle est un choix sélectif artificiel de visualisation, et comme tel c'est un objet scientifique puisqu'il est un objet qui s'interpose entre l’œil et le réel...alors que dire du microscope électronique... 2/les connaissances ne sont pas à l'infini en acte mais seulement en puissances, et la science se base sur cet infini en puissance de la matière pour continuer sa recherche, vous dites représentation du passé, mais pensez vous que ces personnes ne vivent que de représentations ? ce n'est pas parce que la science pose une représentativité évolutive du présent que toutes les autres formes de conscience du présent sont obsolètes, les traditions ont toujours quelques chose de bien si elle ont été un bien dans le passé... 3/ j'ai dis que vous confondiez intuition et inspiration et que vous réduisiez : l'objectivation de la certitude à la subjectivité de l'évidence...ce qui n'est pas pareil... 4/le ressenti est d'ordre psychologique, cela inclus des potentialités diverses de la connaissance et de la volonté, selon qu'il s'agisse des différentes intelligibilités du réel, et nous devons donc savoir ce qui est le propre de chacune d'elles... la subjectivité du scientifique est de porter objectivement son intelligence à découvrir un lien de nécessité entre deux réalités, celle de l'artiste sera de mettre en perspective la forme et le dynamisme de sa créativité, celle de la commune intelligence sera de faire coïncider un moyen à une fin... vous voyez bien que la subjectivité est une alliance entre l'acte et le devenir de la personne, mais que certains actes non de fin qu'eux même, tels sont pour moi les actes qui sont issus de l'objectivité scientifique et sont dirigés vers leur prolongation, la reproductibilité ou la recherche performative de la théorie... -
Le vide, le néant, l'homme et sa vacuité
zeugma a répondu à un(e) sujet de zenalpha dans Philosophie
Déjà-utilisé salutations...en répondant à la phrase de tison2feu : " Il me semble que les théories scientifiques sont modifiées parce qu'elles ne sont, ni n'ont jamais prétendues être, objectives à 100%. " tu dis :....Elles ne sont pas hasardeuses..... certes elles ne sont pas hasardeuses, puisque le jugement prudent interpose constamment un veto à la réceptivité objective de la conscience...juste que parfois des facteurs d'indécidabilité ouvre à une option plutôt qu'une autre sans facteur décisionnel fort... mais en règle générale, qu'elle serait alors l'élément additionnel apposé à l'objectivité scientifique qui ferait que d'une part la théorisation serait évolutive, et que d'autre part, le psychisme du chercheur pourrait en être un influx subjectif...? mon avis c'est la substitution du bien par le bon...car c'est le seul élément qui ait cette double propriété de passer le barrage de la prudence subjective et objective, (que nous retrouvons dans la philosophie politique par exemple) et aussi de permettre une progressivité quantitative de la théorie, en élevant son degré d'assertivité... du moins c'est ce qu'il me semble lorsque l'on dit cette réalité est bonne, parce qu'elle remplie les objectifs qui lui était assignées, ex: une théorie confirmée par l'expérimentation, mais on ne recherche pas si cette théorie est un bien pour la science en générale... je m'explique, ce qui est bon est progressivement une acceptabilité du vrai dans la réalité objective, le bon réclame toujours une adaptabilité de la conscience à cette nouvelle réalité, alors que ce qui est bien est immédiatement accepter par la conscience comme acte/fin... le bon serait alors l'affaire de l'objectivité et le bien de la subjectivité... tout se passerait alors comme si... et je te cites :" le subjectif étant bien plus difficile à identifier, surtout lorsqu'il fait consensus, il l'est bien plus facilement ( d'identifier le subjectif ) lorsque l'on a changé justement de paradigme, avant nous étions comme aveugles." cette cécité propre à une époque où la certitude dominait sur l'évidence, faisait du bon et du bien une seule réalité dogmatique à accepter, puis de la disjonction du bon et du bien de l'intelligibilité scientifique, c'est-à-dire entre l'objectivation du savoir ( ce qu'il est bon de savoir) et la subjectivité du savoir ( le bien fondé d'un savoir), se pose la question de la suite de notre lecture du réel...notre futur... le subjectivisme absolu qui voudrait que seul le bien soit nécessaire comme vérité, fait que le bon ne devienne qu'une appréciation secondaire soumis au devenir incontrôlable du futur, et l'objectiviste qui tient dans la preuve, issu de expérimentation le bon point fixe de cohérence entre son agir et le réel observé, fait que le bien n'est plus qu'une mesure du jugement morale... le bien et le bon doivent rester unis pour que dans le futur soit choisi: le meilleur bien dans un monde bon à le recevoir...l'individu est un bien pour un bon groupe... P.S tu excuseras cette "logique binaire bien bon" que je semble développer au fil de mes posts, c'est que souvent les nuances entre deux amis sont plus édifiantes que les oppositions entre deux ennemis... bien à toi D.U -
Le vide, le néant, l'homme et sa vacuité
zeugma a répondu à un(e) sujet de zenalpha dans Philosophie
non....vous oubliez ou plutôt vous supposez que la loupe est accessible à tous, c'est l'erreur majeure de la scientificité de l'intelligence qui prend en présupposant que nous pouvons tous comprendre comme comprend un scientifique... c'est une erreur tragique sur l'évolution de l'intelligibilité générale du monde et de ses phénomènes, car elle conduit à prendre des décisions civilisationnelles en mesure de cette connaissance spécifique proposée par les sciences... d'ailleurs vous dites ensuite : "pourquoi penser que ce que l’on a décrit à telle période n’était pas objectif parce que dans le présent, l’objet n’a plus la même forme ? " parce que l'évolution de la recherche scientifique ne recoupe exactement l'évolution de l'intelligibilité du monde, et de ne voir que, ou en premier lieu la progressivité de l'objectivité scientifique, on fini par voir le monde uniquement que conne un "objet de l'intelligibilité scientifique" ce que je récuse pour ma part... vous dites enfin : "Si une personne dit par intuition ou autres, que tel objet est de telle forme, c'est être subjectif puisqu'il (elle) se base sur son ressenti personnel, que cela s'avère vrai dans le futur, ça ne change pas le fait que sa réponse était subjective." vous confondez une fois de plus mais surement de bonne foi, comme Jedino, l'objectivation de la certitude et la subjectivité de l'évidence... l'intuition dont vous parlez est en fait ce qui est commun aux scientifiques et aux artistes mais s'appelle plus exactement l'inspiration, et relève alors d'une connaissance subjective de sa propre objectivation du réel... et donc ce n'est pas une réponse subjective qui est donnée par cette intuition/inspiration, mais une figuration de son objectivité qui peut ou pas se retrouver confirmée, avérée, être réalisé ou réalisable dans le futur... il faut toujours bien distinguer ce que la connaissance subjective porte en elle de certitudes qui peuvent se recouper avec les évidences et ce qu'une connaissance objective porte en elle d'évidences qui sont recoupées avec la certitude, qui est comme je l'ai dis ailleurs une unité entre l'assertion et l'assentiment... le jugement de valeur...éthique pratique et esthétique : certaines connaissances objectives évidentes, peuvent être reconnues vraies sans être acceptés comme bonnes ou belles, par ce qu'elles sont inacceptables pour le bien de ma conscience (ex: une méchanceté, un génocide, une laideur) , mais quand je veux avoir la certitude qu'une réalité est bonne, je la recherche comme un bien pour ma conscience, ainsi la certitude avalise un bien alors que l'évidence valide le bon ou le mauvais... ces deux cas n'inclus évidement l'erreur possible de mon jugement et le manque d'informations décisives pour que ce jugement soit vrai... de plus, ce n'est pas la quantité de l'information qui produit la décidabilité mais la qualité des informations que je choisi d’intégrer à ma délibération consciente en vue du choix... celui ci étant autant la désignation d'une réalité, que l'éviction de toutes celles qui ne sont pas retenues comme bonnes... -
....résoudre le problème des rêves prémonitoires, c'est trouver où se trouve l'arnaque... attention à l'inférence logique des éléments de votre phrase, car elle implique sous un rapport complétif, que l'existence des rêves prémonitoires est un problème à résoudre qui équivaux à découvrir où est "l'arnaque", je traduit peut-être abusivement où est "le danger de se tromper"... si vous avez donné cette phrase dans un sens univoque, elle veux dire que notre façon de percevoir le futur est inconditionnellement lié à notre connaissance du passé et du présent, si vous l'avez donnée dans une sens métaphorique, elle veux dire que, tant que nous restons à imaginer le futur, nous ne pouvons prendre le passé et le présent comme mesure de sa réalisation... dans les deux cas cette phrase fait l'impasse sur la dynamique constante du savoir humain dans son évolution, et donc oubli que nous avons un continuum d'intelligibilité comparable au continuum phylogénétique de notre corps... enfin, l'oubli aussi que si le futur n'est pas connaissable dans ses détails, la connaissance de "ses structures porteuses"est quand même nécessaire pour faire des choix décisionnels au quotidien...
-
comme d'habitude vous usez de sophisme pour détourner la vrai question dans une "diffraction" post-logique de votre fabrique... dans certains cas des comités consultatifs d'éthiques sont appelés à statuer sur le bien fondé de telle ou telle recherche, mais sur l'impact de la science sur la conscience communautaire, cela semble impossible, c'est pourquoi je reviens si souvent sur la place de l'intelligibilité scientifique dans l'évolution de l'intelligence humaine... vous voyez bien que la confiance que l'opinion publique accorde aux scientifiques est mesurée par ce qu'elle connait de ses résultats, c'est à dire presque rien... par contre les applications techniques issues de certaines recherches sont "expérimentées" si je puis dire au quotidien par tout à chacun, donc il serait très heureux que nous puissions juger aussi de la conduite et de la direction générale des sciences, tant physique que biologiques... au risque de se réveiller un jour avec la gestion d'une nouvelle énergie type nucléaire, ou une nouvelle question éthique sur le génome humain type eugénisme, et sur ses éventuelle modification, tout comme un nouveau dossier OGM... cachées sous des aspects de pertinence, il y a une perfidie et une perversion dans votre réflexion, quand vous dites : "Les maths et la physique n'expliquent pas tout....sont limitées....mais, en compensation de cette limitation, elles touchent La realité comme aucune discipline ne peut le faire dans ce domaine " si j'accepte cette compensation comme gage de véracité, je m'engage à donner aux mathématiques et à la physique un blanc seing en ce qui concerne l'évolution de la connaissance de la matière, et donc à lui accorder une totale et libre possibilité de recherche dans ce domaine qui après tout n'est pas morale et donc n'a pas de répercussion sur le quotidien, mais c'est oublier que le destin de l'humanité est "un" et que chaque modification au plan de l'intelligibilité du réel fini par engendrer un effet proportionnel à la cause qui a présenté telle connaissance comme vraie... il me semble que vous ignorer ce qui intercède dans la structuration de l'intelligibilité de la conscience humaine, et que vous ne compreniez pas la pleine mesure de la causalité d'un savoir particulier sur la conscience communautaire..; vous poursuivez : 1- Elles touchent les faits experimentaux et c'est presque "magique" que la prediction ou la retroaction d'un fait collé parfaitement à la theorie non c'est logique...le réel est la cause et vos théories n'en sont que le reflet formalisé... 2- Elles donnent une explication par des structures qui éclairent la signification d'un phénomène physique. L'électromagnétisme puis la force nucléaire forte puis la force nucléaire faible entrent chacune dans un groupe mathematique qui permet de les predire. On comprend dès lors une coherence des différentes forces qui a accouché de la theorie des jauges devenue Le modele standard de la physique des particules grace à laquelle tu utilises l'ordinateur mais l'usage particulier n'est pas l'effet générale...reprendre l'exemple des voitures... 3- Elles sont un treuil ontologique donc elles ne predisent pas que des phénomènes mais aussi l'existence d'objets physique avant de les avoir experimenté : le photon, l'anti matiere, les quarks, le neutrino, le boson de Higgs.....autant de realités physique prédites par les maths ontologique !!! non ....seulement "formel" je me suis déjà opposé à cet abus de langage de votre part... la connaissance scientifique ne treuil que de nouvelle connaissances scientifiques...et pas une existence naturelle de l'humanité vers un destin heureux... réveillez vous et sortez de votre fascination mystagogique de la science, cette religion vous égare et nous perdra dans les termes que vous lui prêtez...
-
Le vide, le néant, l'homme et sa vacuité
zeugma a répondu à un(e) sujet de zenalpha dans Philosophie
oui: la peur de l'erreur, comme motivation à trouver une cohérence interne entre la théorie et l'expérimentation...force... la recherche d'une nouvelle théorie, comme motivation à porter toujours plus loin l'explicitation formaliste scientifique...force... la concurrence entre chercheurs, ou "saine" rivalité, comme motivation à boucler un projet scientifique par une publication reconnaissant "inventeur"...faiblesse... la complémentarité d'une équipe scientifique, qui aboutie souvent à ne voir que le nom de celui ou celle qui dirige les travaux, mais qui sans les autres membres n'aurait été si loin...faiblesse... la pression psychologique historique et sociétale, comme repoussoir à l'urgence de chercher dans telle ou telle direction plutôt que dans telle autre...force... la diversité et l'ampleur des moyens techniques mis à disposition du chercheur, comme conditionnement matérielle et psychique limitatif à l'aboutissement d'une recherche...faiblesse... le respect ou l'irrespect de la conscience communautaire, comme motivation positive ou négative du chercheur à entreprendre telle type d'expérimentation pour vérifier sa théorie et ses calculs...force, faiblesse... etc...la liste n'est point close et vous pouvez vous reporter sur un autre post, où j'énumérait dix "situations" pour répondre à Zenalpha qui me reprochais de me référer à un dogme et à une vision antique, pour réfléchir sur les enjeux de la science moderne... -
hummmmm, je suis assez embarrassé par votre raisonnement, car il me semble que vous donnez à l'objectivité, la place qui revient à la preuve, et à la subjectivité, la place qui revient à l'assentiment... ainsi quand vous dites : "Mon raisonnement s'est focalisé sur ce que j'appellerai "vérité objective". Mais il existe effectivement une "vérité subjective", à savoir une vérité qui tient lieu d'interprétation du réel et qui n'est pas en mesure d'être remise en cause."...pour moi ceci est la définition de la preuve, pas de l'objectivité... de plus vous dites : "Que la lumière transporte une énergie quantifiable est de l'ordre de la "vérité objective", scientifique ici. Son degré de certitude est grand, autant que peut l'être un savoir scientifique vérifié par l'expérience. Sauf à douter de la science pour une raison ou une autre, comme je l'ai longuement expliqué précédemment, cette vérité-là est admise par tous. En cela, il existe un degré de certitude qui a toute sa place ici. " là encore et c'est plus flagrant encore, vous adoptez une forme de rhétorique qui me gène, puisque vous dites : la vérité objective que la lumière transporte une énergie est le résultat d'une expérimentation technologique, elle issue d'une théorisation de la physique, alors il me semble que vous étendez "l'objectivité"à une connaissance qui n'est admise que part la petite part des humain qui ont fait eux même assez de sciences pour en comprendre la théorisation... ce qui au final n'est pas du tout objectif, puisque le partage de cette connaissance inclus de facto que ceux qui n'ont pas intellectuellement refait tous les calculs qui vous font dire que la lumière transporte une énergie, sont obligés de vous faire confiance...ce qui n'est plus une connaissance objective, mais assujettie à votre objectivité scientifique... de plus vous dites :" Son degré de certitude est grand, autant que peut l'être un savoir scientifique vérifié par l'expérience."...non pas par son expérience, mis par l'expérimentation scientifique nuance votre honneur...ce n'est pas équivalent, puisque l'expérimentation ajoute deux moyens termes à l'expérience du scientifique, la théorie appliquée et l'usage de machines spécifiques à cette expérimentation...ainsi son degré de certitude est en fait un degré cohérence interne entre la théorie, les calculs et l'expérimentation...ce n'est donc une certitude de l'intelligence humaine qu'à travers le média scientifique...et sa vérification est avant tout une démonstration de la production de l'intelligibilité scientifique pour elle-même... vous poursuivez en disant: "Seulement, il ne faut pas oublier que nombres de personnes perçoivent les couleurs différemment : ainsi, le rouge devient vert et le vert devient rouge, par exemple. Personne, ici, n'est plus proche ou plus lointain de la réalité : ce n'est qu'une interprétation différente et tout à fait personnelle d'une même réalité. Cette expérience de la lumière, qui est l'interprétation qu'en fait notre sens visuel couplé avec le cerveau, n'est pas universelle, et c'est en ce sens que je parlerais d'une "vérité subjective". D'une telle vérité, un degré de certitude n'a pas de sens, en effet. " là j'avoue que vous m'avez bluffé, car vous posez la lumière naturellement saisie comme une interprétation subjective, donc aléatoirement concordance selon les individus, ce qui vous permet de la ramener à une vérité subjective, et ainsi de ne plus voir le principale, c'est que c'est la lumière qui est l'acte de la vision, et même plus qui si la lumière n'existait pas, notre œil ne se serait jamais développé pour la recevoir...non, l'expérience de la lumière n'est pas une interprétation de l’œil et du cerveau, elle est ce qui donne à l’œil et au cerveau la perception des formes, et plus exactement elle est le facteur premier de l'évolution de l’œil de la vue, alors si justement l'expérience de l’œil qui perçoit la lumière avec des nuances qualitative et quantitative est universelle, l'expérience de l’œil est de point de vue là très objective ... ce sont les explications de la lumière reformulées pas la science physique qui ne sont pas universelles car elles exigent une connaissance appropriées pour en décrypter la signification, elle est donc de ce point de vue là subjective ...ce que vous dites est une inversion flagrante et ça c'est du Descartes réchauffé... en reprenant l'exemple de l'ami enfin vous dites : "Mais ce cas est plus complexe puisque, si notre relation avec cette personne est une relation de confiance, nous sommes amenés à discuter de faits étant de l'ordre de l'objectif, ce qui nécessite un minimum de recul malgré tout pour confirmer ou infirmer ce qu'ils peut nous raconter. La nuance pourrait aller sur d'autres aspects puisque si nous savons la personne experte sur le sujet, nous aurons tendance à faire confiance en son discours. " pas nécessairement, et nous pourrions dire comme le fit Aristote: la vérité et Platon, je les aime tout deux, mais je préfère la vérité... car ce n'est pas en s'appuyant sur une autorité morale que nous sommes sûr qu'une réalité soit vraie, pas plus que de douter systématiquement de la parole de nos proches qui nous fera les aimer plus... je tiens une fois de plus, non pas à vous contredire juste pour vous contredire, mais à reporter certains retournement de votre logique, à suggérer que votre option intellectuelle fait suite à une certaine formalisation de la logique scientifique, qui veut que l'expérimentation, et sa reproductibilité, soit garante de la véracité d'une relation causale générale de l'intelligence face au réel... ce n'est pas ma position, la certitude que la science porte sur le réel est une certitude conditionnée et obtenue dans un cadre de réflexion artificiel, celui de la théorisation, du calcul et de l'usage de machines, elle ne peut donc pas être appelée certitude universelle d'un fait...car cela reste quelque chose de naturellement soumis à l'appréciation de chaque personne, scientifique ou pas... in fine vous dites: "Ainsi, nous privilégions la certitude pour une "vérité objective" et la confiance pour une "vérité subjective", sachant qu'une vérité subjective peut être l'expérience d'une vérité objective. " non... nous privilégions le certitude pour une vérité subjective issu de l'assertion et de l'assentiment, et nous privilégions l'évidence et le constat de la preuve pour la vérité objective, scientifique ou pas d'ailleurs...
-
par les trois phrase qui suivent, Dompteur de mots, ne faites-vous pas une rétraction entre la vérité comme concept : "véracité" et comme précepte : "le vrai" ? puisque pour vous c'est le contexte qui prime dans le premier cas aboutissant à la véracité, et dans le deuxième cas d'un problème aboutissant au vrai, voir au vraisemblable... "L'idée de "vérité réelle" ou de "vérité absolue" n'a pas sens. La vérité se pose toujours dans le cadre d'un problème ou d'un contexte précis." ensuite vous dites : Il y a deux conditions pour que l'on puisse aborder les choses sous l'aspect de la vérité: un contexte, et d'autre part la supposition a priori que tout a une raison - une supposition qui s'incarne de façon synthétique dans l'adverbe "pourquoi". mais là aussi se serait encore ramener la notion de "vérité" à une fonction de cohérence raisonnable, puisque vous dites : " la supposition a priori que tout a une raison" alors que le pourquoi inclus une notion de finalité absente dans la seule cohérence raisonnable, sauf si vous pensez que cette cohérence est la fin de l'acte de l'intelligence ... en plus vous dites : Si (? c'est ) un peu comme dire que le fait que nous ne puissions mesurer l'infini constitue un trou dans notre appréhension de l'espace." la notion d'infini pour une intelligence humaine est double en acte et en puissance, en puissance elle est est inconnaissable, mais en acte elle est ce qui n'a pas de fin...et ce n'est pas un trou noir, tout manque d'évidence n'est pas une certitude... "Mais nous nous sommes éloignés de la question de l'utilité de la vérité." là je suis d'accord...
-
Le vide, le néant, l'homme et sa vacuité
zeugma a répondu à un(e) sujet de zenalpha dans Philosophie
oui pourtant si nous regardons ce que l'émergence de "l'esprit des sciences" à modifier dans l'évolutivité de l'humanité, nous pouvons fort bien lire les lignes de forces et de faiblesses, psychologiques à l'oeuvre... en acceptant comme il fût dit par ailleurs et moult fois, que le scientifique est un être de chaire et de sang et donc soumis aussi à une part de fluctuation comportementale, comme toutes les autres personnes humaines... "Il me semble que les théories scientifiques sont modifiées parce qu'elles ne sont, ni n'ont jamais prétendues être, objectives à 100%." ce référer au sujet en cours "le point communs aux humanités"... -
OUI... tu dis ensuite : "Je ne suis pas sûr de bien comprendre ? Réduis-tu cette remarque à l'Art, ou au contraire, à toute activité humaine ?" oui à toute activité...humaine... je te cite encore : "Je préfère voir en la science et la philosophie une complémentation, plutôt que deux catégories, au même titre, que l'objet perçu n'est pas indépendant du sujet percevant, il existe des liens qui les unissent, et je pense qu'il en va de même entre philosophie et science, un lien de parenté qui ne s'est jamais vraiment estompé en somme, je donnerais bien une image un peu bateau et grossière comme le yin et le yang." mais tu as tout à fait raison..."que l'objet perçu n'est pas indépendant du sujet percevant"... c'est ce que je disait dans cette phrase : "autour de deux axes la subjectivité et l'objectivité, qui se distinguent, mais ne sont point séparées, puisqu'elles relèvent toutes deux de la même source et tendent vers la même fin..." la vie comme phénomène est l'émergence de la qualité dans la quantité, par l'individuation du sujet...mais connait-on une qualité dans le réel, sans une certaine quantité ? et une quantité qui n'aurait pas aussi une certaine qualité ? ainsi je n'ai jamais dis que ces deux options "parfaite" et "totale" était antinomiques... la science et la philosophie ont toutes deux une interdépendance dans cette recherche d'autonomisation du sujet...mais que, comme dans la nature, le parfait doit précéder le totale, le diverse précéder le multiple, la qualité précéder la quantité... cette préséance est une découverte que l'ordre génétique est aussi un ordre de perfection... ce qui sera à développer, à mon sens, c'est en quoi elles sont toutes deux, science et philosophie, contributives du destin de l'humanité comme phénomène vivant... ...bateau et grossière...le yin et le yang...y vois-tu peut-être encore une expressivité post religieuse ?, et pas une représentativité infrangible du principe/concept de la non-dualité primordiale du Tout... bien à toi...D-U