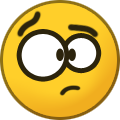-
Compteur de contenus
3 006 -
Inscription
-
Jours gagnés
1
Type de contenu
Profils
Forums
Blogs
Calendrier
Vidéos
Quiz
Movies
Tout ce qui a été posté par satinvelours
-
Le racisme c’est partir de ce postulat : nous sommes déterminés par des facteurs (physiques) qui s’imposent à nous. Le racisme c’est nier la liberté et la responsabilité qui en découle. Le racisme c’est la lâcheté du médiocre. Celui qui, incapable d’affirmer sa volonté de puissance, va en chercher les fondements dans une volonté autre que la sienne : la nature. Bref le raciste est un produit de cette idéologie de la culpabilité : le christianisme, idéologie qui continue de faire ses ravages même parmi les athées d’origine chrétienne. Les Grecs n’avaient pas besoin de se réfugier dans l’ADN pour s’affirmer supérieurs, ah ah ah !!! Ils avaient le courage et le culot de leurs affirmations.
-
Je donne mon temps à ceux qui vont créer le monde, pas à des gens comme vous qui sont déjà morts.
-
La science : « une méthode rigoureuse qui traque l’erreur » ? Quelle horreur ! Bien sûr il ne faut pas exagérer la portée de votre pensée. Vous n’êtes pas un scientifique et votre pouvoir social, en matière de transmission scientifique (vous n’êtes d’évidence ni prof, ni chercheur) est nulle. Mais quel esprit totalitaire que le vôtre ! La science n’a jamais été créée pour traquer l’erreur ! J’imagine la tête de mes élèves les plus brillants si je leur disais cela ! C’est fatiguant cette médiocrité de l’esprit, qui diffuse à tout va sur les réseaux sociaux. Permettez-vous l’erreur ! vous tous qui lisez ces messages, bien sûr, permettez-vous l’erreur, l’erreur est la vie, l’erreur est l’origine de la création.
-
Lettre 49-2 19 janvier 2019 Samuel, En 751 les Francs régnaient sur un territoire allant de la vallée du Rhin jusqu’aux Pyrénées. Leur chef Pépin le Bref, fils de Charles Martel, l’homme qui arrêta les Arabes à Poitiers en 742 prit de force la royauté cette année-là. Avec lui une nouvelle dynastie commença d’exercer le pouvoir : celle des Carolingiens faisant suite à la précédente, celle des Mérovingiens, fondée par Clovis le premier roi franc, en 481. A sa mort en 768 son royaume fut partagé entre ses deux fils : Charles et Carloman. Ce dernier mourut en 771. Charles devint le seul maître du royaume et se fit appeler Carolus Magnus, Charlemagne. Il entreprit aussitôt d’agrandir son territoire. Il est porté par la foi chrétienne qui lui donne pour mission d’assurer la transmission du message chrétien jusqu’aux limites de l’univers. C’est ainsi que chaque printemps il inaugure une nouvelle campagne militaire, bataillant à l’est, au sud-ouest et au sud du territoire franc. En 805 il stoppe cette politique de conquête. Il règne alors sur un territoire qui comprend (références aux pays actuels) les trois-quarts de l’Allemagne, une partie de la Belgique, les trois-quarts de l’Italie, presque toute la France et les régions espagnoles de Pampelune et de Barcelone. Il connut une seule défaite contre les Arabes ommeyades d’Espagne. Comme ils faisaient souvent des incursions en Septimanie (le Languedoc-Roussillon actuel ) et en Provence, Charlemagne entreprit de les soumettre en conquérant l’Espagne. Mais il dut battre en retraite non sans perdre son arrière-garde commandée par Roland. Elle fut massacrée par des montagnards basques. Cet épisode malheureux est relaté dans la chanson de geste : « La chanson de Roland ». Note : à cette époque la notion de nation, France, Allemagne, Italie, etc. n’existe pas. Seules existent les notions de lignage – origine familiale - et de fief – règne d’un maître sur un territoire. Il n’y a pas non plus de langue unifiée même si le latin continue d’être couramment parlé. L’unité de l’Europe est portée par le christianisme occidental, le catholicisme, dont l’Église c’est-à-dire la communauté des croyants, est dirigée par le Pape établi à Rome. Les Carolingiens veulent obtenir une consécration spirituelle. En 752, Pépin, le père de Charlemagne, reconnaît au Pape Étienne II un droit de possession sur des terres situées au nord-est de Rome, appelées Exarchat de Ravenne. En échange de cette reconnaissance le Pape sacra en 754 Pépin, roi, au nom de Dieu. En 756 Pépin conquiert les terres de l’Exarchat de Ravenne alors revendiquées par des seigneurs locaux et les donne au Pape. Ainsi naissent les États pontificaux et se noue entre les Carolingiens et les dirigeants spirituels du catholicisme une alliance politique. Charlemagne réaffirmera cette alliance et protégera les Papes contre toutes attaques territoriales. Le 25 décembre 800 alors que Charlemagne était venu à Rome pour arbitrer un différend local, le Pape Léon III couronna Charlemagne en faisant prononcer par l’assemblée cette adresse : « A Charles, auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire ! » Le titre d’empereur qui n’avait plus plus été porté en Occident depuis 476 ressuscitait ainsi en faveur de Charles. Ce nouvel Empire, fierté des Occidentaux, ne pesait toutefois pas lourd face à l’empire abbasside. L’historien anglais Richard Fletcher dans son livre : « La croix et le croissant » édité en 2010 écrit ceci : « Comparé à l’Empire de Haroun al-Rachid, l’Empire de Charlemagne faisait figure de petit poisson face à une baleine ». Rome par exemple la ville la plus peuplée de ce nouvel Empire comptait, en 800, 30 000 habitants alors que Bagdad en comptait plus d’un million. En 800 se faisaient face, autour de la Méditerranée, au sud, l’Empire abbasside centré sur Bagdad, au nord-est et au nord l’Empire byzantin (l’Empire romain d’Orient) centré sur Constantinople, au nord l’Empire de Charlemagne (considéré par les Occidentaux comme le nouvel Empire romain d’Occident) centré sur Rome ( résidence du Pape) et sur Aix-la-Chapelle (résidence de Charlemagne) et à l’ouest l’Espagne des Omeyyades centrée sur Cordoue. Nous parlerons de l’Empire byzantin et de l’Espagne ultérieurement. Nous allons maintenant voir comment les Judéens prirent place dans ce vaste monde.
-

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Kierkegaard dit que ce choix de soi est le plus important à faire. Quel type d'être humain je peux moi, par mon existence, réaliser ? Pour que cette question soit posée dans toute sa radicalité et qu'elle ne soit pas abandonnée dès la première difficulté rencontrée, c'est d'injecter la question du temps. Kierkegaard va donc nous expliquer que cette question nous devons nous la poser du point de vue de l'éternité. L'éthicien est celui qui doit se demander quel type d'être humain il veut réaliser « quel moi éternel il veut être ». Il doit construire une représentation de soi sous la catégorie de l'éternité. Il y a là quelque chose de nietzschéen. Il nous faut nous penser sous cette forme de l'éternité. Nietzsche récupère de Kierkegaard cette idée mais cela deviendra : il nous faut nous hisser jusqu'à la pensée d'éternel retour, c'est-à-dire est-ce que je vais être capable d'assentir à la vie, de dire oui à la vie si ce que je vis ici maintenant est susceptible de se reproduire une infinité de fois, est susceptible de se reproduire dans l'éternité de tous les temps. Si mon esprit supporte cette idée, je deviens un surhomme, celui qui montre son amour illimité de la vie qu’elles que soient les catastrophes que la vie apporte à l’espèce humaine dans son ensemble. Il y a quelque chose de commun entre ces deux penseurs. La manipulation du temps sert de critères de sélection et d'instrument de radicalisation. Le devoir ne supporte pas le temps, il s’inscrit dans l'éternité. Je ne peux pas imaginer la loi morale en choix qui serait limité dans le temps. Si ce « tu dois » exprimant la loi morale est bien l'expression de la moralité pure, alors sa valeur doit être éternelle. Cela doit être vrai aussi bien pour les temps qui ont précédé que pour maintenant, que pour ceux qui ouvriront. Si je dois faire des exceptions, je ne suis pas dans la moralité. C'est vrai que le temps ici va jouer un rôle très important. Les sphères de l'esthétisme, de l'éthisme et du religieux ce sont des formes que devraient prendre notre existence. Ce sont des schémas conceptuels philosophiques qui normalement permettent de construire concrètement et d'orienter son existence. Cela ne veut pas dire qu'au travers de ces schémas on a un découpage de chaque vie humaine en tant que serait enfance-adolescence-maturité. Le stade esthétique n'est pas forcément la jeunesse, même si dans la réalité notre immaturité nous porte davantage à être des esthètes, au sens de Kierkegaard, que des éthiciens. C'est le fait mais ce n'est pas le droit. En droit il conviendrait de traverser au plus vite ces sphères de l'existence. La sphère de l'éthique n'est pas le renoncement à la jouissance parce qu'on n'a plus l'énergie et que l'on vieillit. Dans la réalité nous voyons bien combien l'existence se marque par des retours. Nous pouvons tomber à nouveau dans le stade esthétique à un âge très avancé. Chez Kierkegaard ces sphères en fonction de l'existence sont des figures emblématiques, des modèles, des archétypes qui nous montrent des constellations d'éléments qui doivent nous servir à organiser et en même temps orienter notre existence. -

« Boire un grand bol de sommeil noir... »
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Littérature
Baladilla de los tres rios A Salvador Quinteros El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. ¡Ay, amor que se fue y no vino! El río Guadalquivir tiene las barbas granates. Los dos ríos de Granada uno llanto y otro sangre. ¡Ay, amor que se fue por el aire! Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino; por el agua de Granada sólo reman los suspiros. ¡Ay, amor que se fue y no vino! Guadalquivir, alta torre y viento en los naranjales. Dauro y Genil, torrecillas muertas sobre los estanques, ¡Ay, amor que se fue por el aire! ¡Quién dirá que el agua lleva un fuego fatuo de gritos! ¡Ay, amor que se fue y no vino! Lleva azahar, lleva olivas, Andalucía, a tus mares. ¡Ay, amor que se fue por el aire! Traduction : Pierre Darmangeat Le fleuve Guadalquivirva parmi oranges et olives. Les deux rivières de Grenade descendent de la neige au blé. Hélas, amourqui s’en fut et ne vint !Le fleuve Guadalquivira la barbe grenat.Des rivières de Grenade, l’une pleure et l’autre saigne. Hélas, amourqui s’en fut dans l’air !Pour les bateaux à voiles, Séville a un chemin ; mais dans l’eau de Grenade rament seuls les soupirs. Hélas, amourqui s’en fut et ne vint ! Guadalquivir, haute touret vent dans les orangers. Darro et Genil, tourelles mortes sur les étangs. Hélas, amourqui s’en fut dans l’air !Qui dira que l'eau emporte un feu follet de cris ! Hélas, amourqui s’en fut et ne vint ! Porte la fleur d'orange, porte l'olive,Andalousie, à tes mers. Hélas, amourqui s’en fut dans l’air. Le son lorquien est aussi un son enfoui, caché dans les feuilles et l’obscurité, d’où il jaillit. Et l’Andalousie toute entière en témoigne juste dans ses fleuves.Le cri crépite ; il est Loiseau et il est le feu. Si « l’eau apporte un feu follet de cris », la convocation par Lorca de cette nature chargée de musique fait également signe à son maître et ami Manuel de Falla, auteur de El amor brujo de la fameuse danse du « fuego fatuo » (feu follet) : on ne peut pas croire que la citation soit ici inconsciente. https://www.youtube.com/watch?v=7BP7nIpjNs0 -
Lettre 49-1 17 janvier 2019 Samuel, Pour bien comprendre le rôle que tinrent les Judéens dans la période historique qui commence en 750 avec l’avènement des Abbassides et qui sera étudiée, dans cette lettre, jusqu’au début du neuvième siècle, il est nécessaire de présenter les deux Empires de cette époque : l’Empire des Abbassides et l’Empire carolingien. Des relations nouées entre ces deux empires surgira une nouvelle branche judéenne qui s’établira en Europe occidentale, centrale et orientale : les ashkénazes. L’empire abbasside de 750 à 809 Les Omeyyades avaient fini par fonder une aristocratie arabe héréditaire fondée sur leurs armées et le paiement de tributs. Une opposition se forma progressivement. Pour partie elle était composée de malawi, nom donné aux convertis à l’islam issus de populations non arabes, qui revendiquaient l’égalité avec les seigneurs arabes, égalité promise par le Coran à tous les musulmans qui leur aurait permis de ne plus payer l’impôt. Pour une autre partie elle était composée de nombreux Persans qui supportaient mal la domination arabe et enfin pour partie par les chiites, partisans de Hussein le fils du quatrième calife Ali, qui avait réclamé le califat et avait été tué par les Omeyyades. Une coalition de révoltés finit par lever une armée rassemblée sous le drapeau noir d’un descendant d’Abbas, un oncle de Mahomet. Cette armée massacra les Omeyyades en 749-750. Une nouvelle dynastie régna sur l’empire arabe pendant cinq siècles, la dynastie des Abbassides (nom dérivé de Abbas) dynastie dont le dernier calife fut tué par les Mongols en 1258. Cette dynastie rompit avec le principe aristocratique de descendance. La plupart des califes abbassides furent des fils de mères esclaves d’origine étrangère, seule l’origine arabe du père étant désormais prise en compte. Un Omeyyade échappa au massacre : Abd al-Rahman. Il débarqua en Espagne en 755 et, à la tête d’une petite armée, il renversa le gouverneur qui avait prêté allégeance aux Abbassides. Il s’empara de Cordoue en 756, établissant une dynastie omeyyade d’Espagne qui dura jusqu’en 1031. Le deuxième calife de la dynastie des Abbassides, Al-Mansour, qui régna de 754 à 775, transféra la capitale de l’Empire, de Damas en Syrie à Bagdad en Mésopotamie, ville qu’il construisit près de l’ancienne capitale de l’Empire sassanide, Ctésiphon (voir lettre 45). Dans ce choix il faut voir un déport du centre de gravité de l’Empire musulman vers l’ancienne Perse. Les Persans ayant formé l’essentiel de l’armée des révoltés c’est sur eux que les nouveaux maîtres arabes s’appuyèrent. C’est ainsi qu’influencés par la culture orientale perse les califes arabes devinrent des autocrates religieux revendiquant une origine divine. Mais l’influence sassanide se concrétisa surtout dans l’administration de l’Empire. Rompus à l’exercice du pouvoir les Persans restèrent nombreux dans l’administration impériale qu’ils dirigèrent par leur représentant : le vizir. Ils furent rejoints par une nuée de fonctionnaires recrutés chez les mawali originaires des toutes les ethnies du royaume. Depuis le début du règne des Abbassides le vizirat se transmit de père en fils dans l’illustre famille persane des Barmakides. L’influence arabe s’estompa, le brassage des populations commença à réunir dans une même communauté arabes, demi-arabes et non arabes, les vecteurs de l’unité étant la religion et la langue arabe. Même les Arabes versés dans la pratique de la guerre furent progressivement évincés au profit d’une armée constituée de troupes payées, recrutées parmi des esclaves turcs appelés les mamelouks. Sous ce double pouvoir, le pouvoir religieux exercé par les Arabes et le pouvoir administratif exercé d’une main de maître par le vizir, de culture persane, l’empire musulman connut un développement économique prodigieux qui rayonna dans le monde entier. Il est légitime de parler ici d’une culture arabo-persane, dont les principes unificateurs furent la religion et la langue, et dont les effets civilisationnels furent déterminants dans l’histoire de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique. Ce développement économique d’envergure, agriculture, artisanat, production manufacturière, métallurgie, textiles, papeteries (la production de livres produits à moindre coût grâce au papier eut un impact intellectuel et culturel puissant sur la littérature, les sciences, la religion…) s’accompagna d’une activité commerciale intense qui dynamisa non seulement l’économie impériale mais aussi l’économie mondiale. Les marchands de l’Empire ne cessèrent de faire des opérations d’import-export avec l’Inde, la Chine, l’Empire byzantin, la Scandinavie et les peuples de la Baltique (via les Khazars et les Bulgares) l’Afrique et même mais modérément avec l’Europe de l’ouest, région restée relativement repliée sur elle-même. Le développement des relations commerciales et des activités entrepreneuriales induisit la création d’une activité bancaire. Les changeurs qui assuraient la conversion entre les deux monnaies en circulation, le dirham d’argent d’Orient et le denier d’or d’Occident finirent par créer des établissements bancaires qui facilitèrent et accélérèrent le rythme de l’économie en créant de nouveaux modes de paiement (chèques, lettres de crédit) et en distribuant des prêts. L’Empire connut son apogée sous le règne d’Haroun al-Rashid (786-809). Ensuite il connut d’importantes divisions politiques sur lesquelles nous reviendrons (mais l’influence de ces divisions sur l’activité économique resta d’abord limitée). Notons que le basculement géographique de l’Empire vers l’Orient provoqua des déclarations d’indépendance politique à l’ouest. L’Espagne en 756, le Maroc en 788, la Tunisie en 800 installèrent des dynasties locales qui restèrent toutefois largement assujetties économiquement à Bagdad. Note : Haroun al-Rashid prit en affection le fils du vizir, Djaafar, d’origine persane. Celui-ci tomba amoureux de la sœur du calife, Abbassa. Il la demanda en mariage. Haroun le prit mal et accepta à condition que les amoureux n’aient pas de relation conjugale. Ils acceptèrent mais un enfant naquit quand même dans la clandestinité. Haroun finit par en être informé. Alors il fit assassiner Djaafar et tous les adultes de la famille des Barmakides. Il est probable que cette décision brutale permit à Haroun de se débarrasser d’une famille dont il commençait à craindre le pouvoir. Cette élimination provoqua des frictions entre arabes et persans, ce qui explique les divisions politiques mentionnées ci-dessus. Notons enfin que les rapports compliqués entre le calife et le vizir inspira de nombreux contes du recueil des « Mille-et-une nuits » ce qui contribua à faire de Haroun un personnage légendaire, symbole de l’Orient fabuleux.
-

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Le stade de l'éthique Le choix de l'éthique se construit autour de deux éléments centraux. 1) L'existence L'existence va se reconstruire autour du choix. L'existence comme éthique arrache l'individu à l'indifférence et va le contraindre à choisir. Non seulement le contraindre à choisir, mais le contraindre à se choisir. La propriété marquante de ce moment de l'éthique qui reconstruit notre existence, c'est l'idée que l'individu va s'arracher à l'indifférence qui était la sienne et va être dans la nécessité de choisir et de se choisir lui-même. 2) La soumission La soumission à des normes, principes et valeurs d'ordre général. Soumission d'obéir à des principes, de servir des valeurs qui ne sont pas individuelles mais qui appartiennent à la communauté à laquelle on vit. L'individu va s'élever à la dimension morale et éthique. L'individu a épuisé tout ce que ce stade esthétique pouvait lui apporter. Il a compris que la jouissance qui lui procure cette sphère esthétique est illusoire que c'est le masque du désespoir, c'est le masque de sa mélancolie qui se laisse davantage guidé par ses plaisirs plus qu'il ne les guide. Donc le stade éthique commence par le choix et particulièrement le choix de soi. L'esthète devient donc éthicien lorsqu'il se pose la question de ce qu'il veut devenir, c'est-à-dire à terme ce qu'il veut être. Mais cette question, que devenir, quel type d'homme, d'être humain je choisis d'être, en implique une autre qui est assez complexe et qui est celle du temps. En effet l'esthète vivait dans un éparpillement de ses désirs et cet éparpillement impliquait nécessairement une fragmentation du temps. Au fond l'esthète est celui qui jouit de chaque instant sans lier nécessairement entre eux l'ensemble de ces instants. L'éthicien lui, veut unifier son existence d'où les normes, les principes, et pour ceci il va lui falloir changer son rapport au temps. Il va donc falloir qu'il apprenne à s'inscrire dans cette chose qu'il ignorait jusqu'à présent, et cette chose est tout simplement ce que Bergson appellera ce temps intérieur qui est la durée. Apparaît donc la durée. Cette découverte qu'il ne s'agit pas de fragmenter le temps, de s'enfermer dans les limites de l'instant, mais que maintenant se pose la question du lien entre tous ces instants qui finissent par constituer un certain temps, qu'on appelle la durée, va communiquer à l'éthicien une autre conception de l'infini. On a vu que pour celui qui vit emprisonné dans la sphère de l'esthétique l'infini apparaît sous forme de l’infinité des jouissances. Ici pour l'éthicien l'infini apparaît comme cette durée que l'on découvre et qui est illimitée. On ne voit pas ni pourquoi ni comment elle s'arrêterait, ni sur quoi elle ouvre. C'est pour cela que Kierkegaard va répéter que le propre de l'éthicien, de celui qui maintenant essaye de vivre sur un plan éthique, c'est cette capacité qui lui faut travailler à se projeter dans la durée c'est-à-dire projeter son existence du point de vue de l'éternité. -

« Boire un grand bol de sommeil noir... »
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Littérature
Barrio de Córdoba Tópico nocturno En la casa se defienden de las estrellas. La noche se derrumba. Dentro hay una niña muerta con una rosa encarnada oculta en la cabellera. Seis ruiseñores la lloran en la reja. Las gentes van suspirando con las guitarras abiertas. Traduction : Pierre Darmangeat Quartier de Cordoue Topique nocturne Dans la maison, l’on se défend des étoiles. La nuit s’effondre. À l’intérieur est une enfant morte avec une rose rouge cachée dans sa chevelure. Six rossignols la pleurent sur la grille de la fenêtre. Les gens soupirent avec leurs guitares ouvertes. Autre traduction : Thomas Le Colleter (?) On se protège des étoiles dans la maison. La nuit s’effondre. À l’intérieur, il y a une enfant morte Avec une rose écarlate cachée dans les cheveux. Six rossignols pleurent aux grilles. Des gens soupirent avec les guitares ouvertes. Ce poème illustre avec une acuité particulière ce lien profond du chant et de la mort. Le cante naît de l’expérience du deuil. Au centre du poème, au cœur de la maison, « la niña muerta » rayonne comme point focal et origine du chant. C’est elle qui suscite dans la suite du poème le chant des rossignols et le soupir des guitares ; c’est par elle que la guitare va venir répondre au repli initial de l’espace sur lui-même, à la nuit effondrée, par l’ouverture du chant, les « guitarras abiertas ». On assiste au même phénomène de concentration sous l’effet de la mort, puis la résolution en musique, dans le poème « Muerte de la Petenera (cité plus haut p.6). La mort dans la maison ; elle exerce son pouvoir d’attraction comme un trou noir, en attirant à elle tout l’espace alentour : les ombres effilées dessinent un mouvement de resserrement de l’espace et de convergence vers le point nodal de la maison, lieu de l’agonie de la chanteuse. De ce phénomène de resserrement naît le chant. Tout se passe comme si le son de la guitare n’éclatait ( « se rompe ») qu’au prix d’une extrême concentration de l’espace, suscitée à son tour par l’expérience de la mort. Le rapport privilégié que les musiciens entretiennent avec la mort leur donne un statut à part. Lorca confère en effet aux différents chanteurs qui peuplent son Poème une véritable dimension de mythification ( La guitare fait pleurer les songes). -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
L'on doit à Kierkegaard toute une théorisation philosophique de cette notion qu'est l'ironie. L'ironie chez Kierkegaard est cette attitude qui consiste à nier constamment la consistance de toute réalité finie. Dans la vie l'ironie est une modalité de l'existence. Elle se marque dans les discours, elle a besoin de langage. L'ironie nous décale en permanence des choses. Quand nous sommes ironiques par rapport à un propos nous n'adhérons pas à ce propos mais au contraire nous essayons de creuser une distance, un écart par rapport à ce propos pour essayer de nous protéger, de trop adhérer. L'ironie nous met en surplomb par rapport aux événements, aux autres, cela peut être aussi par rapport à soi-même. L'ironie parce qu'elle est décalage va contribuer à nous arracher à l'immédiateté de la jouissance. Ce n'est pas seulement une figure de style chez Kierkegaard elle constitue une véritable catégorie existentielle au moyen de laquelle l'individu se place au-dessus de lui-même, de ce qu'il vit. Par ironie il se tient comme en surplomb de lui-même. En se tenant désormais décalé, en surplomb avec lui-même, en utilisant l'ironie, progressivement il va s'arracher à la sphère de l'esthétique. « L'ironie c'est l'esprit qui toujours nie » Hegel. L'ironie est la marque de la négativité de l'esprit mais c'est une marque qui est socialement acceptée et acceptable. C'est une négativité qui s'exerce dans des limites, et parce que cette négativité n'est pas radicale et s'exerce dans certaines limites, elle est non seulement acceptée dans la société mais parfois recherchée, valorisée dans certains milieux. Avec l'ironie donc la sensualité va s'observer et va se transformer, c'est-à-dire progressivement se spiritualiser. -
-

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
c) Le troisième élément est véritablement l'attitude du désespoir. La mélancolie va libérer le désespoir qui est une attitude plus convulsive, plus crispée. Mais en même temps cette attitude bien que plus violente est déjà quelque chose d'intellectuel. Le désespoir suppose en effet que nous puissions réfléchir les choses et en particulier réfléchir l'impasse de la jouissance, impasse à laquelle nécessairement nous sommes amenés si nous dévouons notre existence à la recherche de la jouissance stricte. Le désespoir apparaît chez Kierkegaard comme à la fois le fruit d'une réflexion naissante et en même temps le moteur de cette réflexion. « Tu as scruté la vanité de toutes choses mais sans aller plus loin. A l'occasion tu te plonges dans cet état, et tandis que tu t'abandonnes un moment à la jouissance tu te pénètres en même temps de sa vanité. Tu es ainsi constamment hors de toi-même, je veux dire dans le désespoir ». A partir de là on va rencontrer une idée que l'on ne quittera plus jusqu'à la forme la plus élaborée de l'existence pour Kierkegaard qui est être soi, s’appartenir à soi-même, être en possession de soi. Mais il faut pour cela que nous cessions de vivre sur le mode de l'immédiateté, de la fragmentation qui est le mode du stade esthétique et que nous donnions consistance à ce moi qui pour l'instant, n'en n'a pas. Toutes ces modalités révèlent deux choses. D'abord que ce stade esthétique doit être dépassé, abandonné, comme ne révélant aucune vérité véritable pour le sujet. Ensuite le stade esthétique révèle au sujet de l'existence deux formes d'infini. En effet on a vu que la règle de l'esthète est de ne pas choisir puisque ne choisissant rien il demeure dans l'infinité du possible. Mais ne pas choisir, demeurer dans l'infinité des possibles nous confronte à ce que Hegel appelle le mauvais infini qui n'est que le masque de notre vacuité. C'est progressivement en découvrant cela que l'esthète comme moyen de défense élabore une attitude qui est l'ironie. -

« Boire un grand bol de sommeil noir... »
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Littérature
Encrucijada Viento del Este; un farol y el puñal en el corazón. La calle tiene un temblor de cuerda en tensión, un temblor de enorme moscardón. Por todas partes yo veo el puñal en el corazón. Traduction : Pierre Darmangeat Carrefour Vent de l’Est ; un réverbère et le poignard dans le cœur. La rue vibre comme une corde tendue, elle vibre comme une mouche énorme. De toute parts je vois le poignard dans le cœur. Autre traduction : Thomas Le Colleter (?) Vent d’Est, un fanal et le poignard en plein cœur. La rue a le tremblement d’une corde en tension, le tremblement d’un frelon énorme. Partout oui je vois le poignard en plein cœur. C’est ce travail de concrétion du sentiment dans l’espace que se livre, de manière emblématique, le poème « Encrucijada ». À partir de l’énonciation de trois éléments symboliques, simplement présentés, énumérés (sans verbe), Lorca parvient à une forme de dramatisation, d’épure du sentiment d’angoisse. Le poème s’oriente vers la cristallisation obsessionnelle de l’image du « poignard en plein cœur », qui finit par occuper tout l’espace mental. Dans ce théâtre, aucun renvoi n’est fait au référent ; le poème nous met sous les yeux une réalité psychique, il l’incarne. Dans cette tentative d’appréhension de l’essence du sentiment, le résidu est purement musical ; autour de l’image du poignard dans le cœur en effet, ne persiste que la perception auditive : le tremblement d’une corde en tension (celle d’un violon ? d’une guitare ?) qui s’apparente au bourdonnement d’un frelon énorme. ( La guitare fait pleurer les songes ) -
-
-

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
A l'époque de Kierkegaard l'hystérie est conçue comme une maladie de la simulation. L'hystérique est soupçonnée mimer, simuler des troubles pour attirer sur elle l’attention. Avant les travaux de Breuer et Freud on a conscience que dans l'hystérie il y a quelque chose qui intéresse la représentation c'est-à-dire l'hystérique n'est hystérique qu'à partir du moment où il y a un regard pour la voir. L'hystérique est la malade, car il a fallu attendre les travaux de Breuer et de Freud pour commencer à détecter des symptômes y compris chez les hommes. Auparavant même lorsque les hommes étaient hystériques on ne les postulait pas comme tels, puisque l'hystérie était censée provenir d'une humeur baladeuse de l'utérus. Mais on a compris que dans l'hystérie quelque chose d'un trouble intéresse la nécessité de se donner en spectacle, de se représenter, de faire en sorte que tous les regards convergent vers soi. Les hystériques vont être particulièrement punies de leur maladie puisqu'elles seraient de fausses malades, leur maladie serait imaginaire et elles se livreraient à cette débauche de cris et de gesticulations et autres comportements troublés et troublants que pour arracher une attention que dans la normalité on ne leur accorderait pas. Kierkegaard a peut-être compris intuitivement que le cœur même de l'hystérie n'est pas autre chose qu'une peur du face à sa propre jouissance. On sait maintenant d'une façon clinique, c'est la peur de sa propre jouissance puisque dans la jouissance il y a quelque chose de l'ordre du vide, cette mélancolie, hystérie de l'esprit qui ne parvient pas à se ressaisir. L'esprit n'a pas encore trouvé la voie qui va lui permettre d'émerger, de s'arracher à la chair dont il est tout à fait l'esclave. C'est cette existence emprisonnée qui aux yeux de Kierkegaard conduit à l'angoisse. L'esprit se manifeste d'une façon négative sous cette forme dégénérée qui est d'une part la mélancolie et d'autre part l'angoisse qui se saisit de Néron. Il arrive un moment où tout homme normalement constitué ne peut plus se satisfaire du mode de vie esthétique. Il ne peut plus se satisfaire de l'immédiateté. Il acquiert peu à peu au travers même de son expérience esthétique une forme de maturité qui réclame une forme de vie supérieure. Le mélancolique type Néron est celui qui masque au moyen de l'infinité de ses jouissances la finitude de la jouissance. Le mélancolique est celui qui aspire à l'infini mais qui se trompe d'infini. Il loge l'infini dans l'infinité des plaisirs, des jouissances en en variant la forme sans limite. Mais ceci n'est pas le véritable infini que l'on ne peut trouver qu'en Dieu dans le stade final. -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
b) Deuxième élément plus complexe. Ce qui va permettre ce passage est un élément un peu paradoxal que Kierkegaard appellera plus tard le désespoir. Ces grandes figures sont des figures qui s'organisent autour de l'un de ces éléments qui devient l'élément principal permettant le passage. Le rôle du désespoir et de la mélancolie : désespoir de celui qui découvre sa finitude et les limites qui sont les siennes précisément dans sa prison de chair c'est-à-dire dans son corps. Découverte des limites propres à la sensualité qui ne parvient pas à se spiritualiser. Dans le cas de Johannes il y a un cheminement, la spiritualisation de la sensualité se fait. Dans le deuxième cas ce sera plus violent. On va faire l'épreuve d'une impossibilité de rencontrer l'esprit et c'est cette épreuve très douloureuse qui va permettre le bascul. Kierkegaard pense à la figure de Néron. « La mélancolie de Néron ». Pour Kierkegaard Néron incarne l'esprit qui ne parvient pas à s'élever au-dessus de la chair et qui meurt progressivement au travers des excès de cette dernière. Alors Néron halète, épuisé. « L'empereur n'a de repos que dans la jouissance mais voilà que l'angoisse le prend au cœur même de son plaisir. » La jouissance est ici simplement le masque de l'angoisse. Qu'est-ce qui suscite l'angoisse de Néron ? C'est le vide qui se creuse au sein même du plaisir. Néron s'angoisse face au vide laissé par l'esprit qui ne parvient pas à s'élever. Il est le plus seul des hommes, plus nu que ceux qui ne possèdent rien. « Il brûle la moitié de Rome mais son tourment reste le même. Bientôt les distractions de ce genre ne le réjouissent plus. » Puisqu'aucun plaisir n'est susceptible de calmer cette angoisse alors Néron va « répandre l'angoisse autour de lui ». A la fin de cette analyse Kierkegaard nous pose un diagnostic sur Néron. Néron est un mélancolique. Kierkegaard définit la mélancolie comme « une hystérie de l'esprit ». Cette définition nous éclaire et nous enténèbre à la fois parce que Freud n'a pas encore écrit sur l'hystérie. On ne peut plaquer sur le texte de Kierkegaard la conception moderne et contemporaine de l'hystérie. Il nous faut donc revenir en arrière. -

« Boire un grand bol de sommeil noir... »
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Littérature
¡AY! El grito deja en el viento una sombra de ciprés. (Dejadme en este campo, llorando). Todo se ha roto en el mundo. No queda más que el silencio. (Dejadme en este campo, llorando). El horizonte sin luz está mordido de hogueras. (Ya os he dicho que me dejéis en este campo, llorando). Traduction A. Bial Ay! Le cri abandonne au vent l'ombre des cyprès. (Laissez moi dans cette campagne, en pleurs.) Tout est détruit dans le monde. Il ne reste que le silence. (Laissez moi dans cette campagne, en pleurs.) L'horizon sans lumière est dévoré par les incendies. (Je vous ai dit de me laisser dans cette campagne, en pleurs.) Traduction : Pierre Demangeat Aïe ! Le cri laisse dans le vent une ombre de cyprès. (Laissez moi dans ce champ, pleurer.) Tout s’est brisé dans le monde. Il ne reste que le silence. (Laissez moi dans ce champ, pleurer.) L’horizon sans lumière est mordu de brasiers. (Je vous ai dit de me laisser dans ce champ, pleurer.) « La douleur prend chair dans et par le chant. Qu’il soit cri, cordes frottées ou cordes pincées, le chant n’est donc pas seulement sonore : il est un corps. Il laisse une ombre derrière lui. À force de densification, il se mue en sujet, devient invisible, palpable. L’ombre portée du cri a, naturellement, à voir avec la mort : le cyprès, symbole mortuaire, n’apparaît pas ici de façon anodine. » ( La guitare fait pleurer les songes : Thomas Le Colleter. Université Paris IV–Sorbonne). https://www.youtube.com/watch?v=zhaasbl8L7c -
Lettre 48 9 janvier 2019 Samuel, Sous la domination des quatre premiers califes et de la dynastie des Omeyyades la condition des Juifs des territoires conquis par les Arabes va s’améliorer. En échange de leur sujétion politique et militaire qui implique certaines obligations : ne pas porter assistance aux ennemis de la vraie foi, payer tribut et aider à l’effort de guerre, les communautés juives se voient offrir la sécurité physique, la liberté religieuse et économique, et l’autonomie communautaire. Les communautés juives de Perse, de Palestine, d’Afrique du Nord et d’Espagne accueillent donc les Arabes favorablement car ceux-ci les délivrent des persécutions récurrentes exercées par le monde chrétien. En Espagne surtout, là où le pouvoir wisigothique interdisait toute manifestation du judaïsme et séparait les enfants de leurs familles pour les confier à des familles chrétiennes, les Juifs accueillent les Arabes en libérateurs. Mieux ils collaborent activement avec l’envahisseur qui va jusqu’à leur confier la garde des villes conquises. Autre changement significatif : la levée de l’interdit, païen aussi bien que chrétien qui fermait aux Juifs les portes de Jérusalem. Plusieurs dizaines de familles peuvent désormais s’y installer (voir lettre 47-2). Le calife Mu’awiya premier de la dynastie ommeyade installera aussi des Juifs en Syrie où il s’est établi, les considérant comme des alliés. Les Omeyyades favorisent aussi le retour des Juifs à Alexandrie. La conquête musulmane va bouleverser les structures économiques des communautés juives. Au moment de la conquête l’économie juive aussi bien en Palestine que dans l’ensemble de l’Orient était fondée pour l’essentiel sur l’agriculture. Le tribut foncier (tribut sur la terre et la production agricole) imposé aux Juifs va éloigner ceux-ci du travail de la terre et les inciter à se tourner vers les professions commerciales ou artisanales. Les Omeyyades tiennent à marquer la supériorité de l’islam sur le judaïsme. Ainsi, en 691, ils construisent sur l’esplanade de l’ancien Temple de Jérusalem le Dôme du Rocher et la mosquée al-Aqsa. En 716 ils fondent une ville arabe en Palestine, à l’ouest de Jérusalem, Ramleh mais ils réservent tout un quartier de la ville aux Juifs qui y pratiqueront le métier de teinturiers. En 750 les Omeyyades seront renversés par une nouvelle dynastie arabe : les Abbassides. Ceux-ci mettront en place une nouvelle culture musulmane sur les territoires conquis par les Omeyyades. Bon courage pour la reprise au lycée. Je te souhaite une belle année avec la perspective d’un départ conquérant en Russie ! Je t’aime
-

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
C'est la figure la plus accomplie, néanmoins la plus éloignée de Don Juan, figure toute artificielle. Pour Johannes l'artifice est poussé à la limite de sa propre possibilité. On ne peut avoir être plus artificiel que ce personnage. Kierkegaard le fait apparaître dans « le journal du séducteur » comme un artifice dans l'artifice. Présentation de construction artificielle par le jeu littéraire et la fiction. Cela se présente comme laboratoire expérimental où s'élabore et s'éprouve en même temps ce qui parachève la posture de l'esthète. Le personnage de Johannes représente la séduction réfléchie, c'est-à-dire la séduction jouissant d'elle-même. La véritable jouissance et la véritable séduction se réfléchissant, ce faisant la jouissance s'épure puisqu'elle provient maintenant de la réflexion sur la jouissance. Il n'y a plus rien chez Johannes de la puissance démoniaque de la sensualité. Toute l'énergie vitale que l'on trouvait encore chez Faust est maintenant convertie en capacité réflexive laquelle n'obéit en rien à la spontanéité. Mais pour construire cette machine de la séduction, la réflexion aura besoin de la ruse et du cynisme, ces deux éléments qui rendent odieux le texte. Johannes se contemple en train de séduire Cordélia. Toute son entreprise vise à accomplir son art et à le porter à un degré ultime de maîtrise et de perfection. Ce moment atteint, la rupture figure la seule solution. Elle est nécessaire. La jouissance n'est plus que dans la quête réfléchie et la séduction devient un jeu avec soi-même. « Tout est image, je suis mon propre mythe » dit Johannes. L'objet est évacué. Trois éléments sont repérables dans l'œuvre de Kierkegaard qui permettent de passer de la sphère esthétique à la sphère éthique. La sphère éthique va se présenter comme un dépassement nécessaire de la sphère esthétique. Ces sphères ne sont pas indépendantes les unes des autres, ni extérieures. a) Le premier élément pourrait être représenté par le personnage de Johannes. C'est la sensualité mais qui est confrontée à l'esprit et qui va peu à peu être spiritualisée. Le plaisir le plus vif pour Johannes est de voir qu'il peut justement triompher de la sensualité pure. C'est la jouissance que l'on retire à voir l'esprit triompher de la sensualité pure, sorte d'alchimie qui lentement va transformer de l'intérieur la sensualité, la spiritualiser et -
Lettre 47-2 7 janvier 2019 Samuel, A Médine la révélation va devenir plus concrète, adaptée à la résolution des questions sociales et politiques. Comment organiser la justice, la vie en commun, l’héritage, etc. Le Prophète devient un chef d’État qui doit régler tous les problèmes qui se posent à un État, si petit soit-il. Il réunit sous l’autorité d’un seul Dieu, Allah (dieu qui faisait déjà partie des divinités préislamiques) toutes les tribus de Médine, lui-même se posant donc comme le messager d’ Allah. Il tente de réunir aussi sous son autorité les trois tribus juives de Médine : les Qaynuqa, les Banu Nadir et les Banu Qurayza. Pour cela il prend beaucoup au judaïsme : le monothéisme bien sûr, mais aussi des traditions judéennes : le shabbat, le carême du Kippour par exemple et il fait ses prières en se tournant vers Jérusalem. En tant que chef de la cité de Médine il se doit d’assurer la subsistance de ses administrés. L’économie locale n’est pas assez productive. Aussi Mahomet va se lancer dans une guerre de conquête pour s’emparer des biens de consommation dont il a besoin. Sa cible va être la riche cité de la Mecque. Mais les Judéens ne vont pas le suivre dans cette politique de conquête. D’abord ils ne supportent pas vraiment que Mahomet tente de leur imposer son autorité, mais ensuite ils préfèrent entretenir des relations d’échange commercial avec les maîtres de la Mecque. Mahomet ne peut pas accepter que dans la cité qu’il dirige des tribus lui fassent défaut. Aussi, en 624 il va obliger la tribu de Qaynuqa à quitter Médine. Elle émigrera dans l’actuelle Transjordanie. Puis en 625 il expulse la tribu des Banu Nadir qui se réfugiera à Khaybar, une oasis peuplée de Juifs et située à 150 kilomètres au nord de Médine. Quand la troisième tribu, celle des Banu Qurayza, prit parti contre lui dans sa lutte contre la Mecque il sera radical : il tuera les hommes et il vendra comme esclaves les femmes et les enfants. Du coup la révélation va changer. Mahomet fait maintenant les prières en se tournant vers la Mecque, il avance le shabbat au vendredi, il remplace le carême du Kippour par le ramadan mais surtout il va donner un autre sens à la nouvelle religion qu’il est en train de bâtir. Par la Révélation qui se déroule sur 20 ans et qui s’enrichit ou change dans ses attendus en fonction des événements, il va construire cette audacieuse vision : Allah est le seul Dieu depuis toujours et la Révélation est la seule parole vraie d’Allah, parole qui a toujours été et qui est maintenant révélée par le Prophète ; Abraham est le fondateur de l’islam, il est le premier musulman, en tant qu’il est le premier à avoir annoncé le monothéisme. Tous ceux qui sont nés après lui sont musulmans tandis que les Juifs et les chrétiens n’auront pas compris ou auront déformé la parole d’Allah.Mahomet est donc celui par lequel advient la seule vérité. Il établit l’antériorité de l’islam sur le judaïsme et le christianisme. Il continue sa politique de conquête territoriale. Ne parvenant pas à s’emparer de la Mecque il va s’attaquer en 628 à l’oasis de Khaybar. Les Hébreux résistent mais sont vaincus. Mahomet va inaugurer une politique qui sera plus tard institutionnalisée par ses successeurs : il offre aux Hébreux sa dhimma c’est-à-dire sa protection en échange de quoi ils doivent lui livrer la moitié de leur production agricole. Il poursuit sa marche vers le Nord, il occupe le sud de la Palestine. En 630 il soumet enfin la Mecque. Impressionnées par cette victoire même les tribus nomades les plus éloignées de Médine commencent à lui faire allégeance. Il meurt en 632. Son successeur, le Calife Abu Bakr (Calife signifie député, député du Prophète) qui régna de 632 à 634 poursuit l’œuvre de Mahomet en soumettant toute l’Arabie et en remportant des premières victoires contre les Perses et les Byzantins [l’Empire byzantin est l’autre nom donné à l’Empire romain d’Orient, par référence à Byzance qui était l’ancien nom de Constantinople]. De 634 à 644 Omar ibn al-Khattab succède en tant que deuxième Calife à Abu Bakr. Il s’attribue le titre de Commandeur des Croyants. C’est sous son règne que commence réellement l’épopée de l’islam avec les premières grandes conquêtes et la conversion de peuples entiers à la nouvelle religion. Il conquiert sur les Byzantins l’Égypte, la Palestine et la Syrie, sur les Perses la Mésopotamie et une large partie Est de la Perse. Omar va interdire l’Arabie aux non-musulmans. Les Hébreux doivent partir d’Arabie notamment la colonie juive de Khaybar. Mais il permet aux Juifs de revenir à Jérusalem (qu’il conquiert en 637-638) et il installera d’autres Juifs expulsés dans l’ancienne région de Babylone. Il va institutionnaliser la pratique de la dhimma. Moyennant le paiement de l’impôt les Juifs (et toutes les minorités non musulmanes) appelés les dhimmi peuvent garder leurs terres et pratiquer leur culte dans tous les territoires conquis par les Arabes (hors Arabie d’où tous les non-musulmans sont expulsés). Les deux Califes qui suivent, Othman ibn Affan (644-656) puis Ali ibn Abou Taleb (656-661) continuent la politique de conquêtes avec la prise de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Perse orientale, de la Tripolitaine, de Chypre et de Rhodes. En 661 le nouveau Calife Mu’awiya fonde la dynastie des Omeyyades qui régnera juqu’en 750. Il transporte le siège du pouvoir de Médine à Damas. En moins d’un siècle les Omeyyades vont édifier un pouvoir sans précédent dans l’Histoire. A l’Est ils vont conquérir tous les territoires jusqu’à la vallée de l’Indus et décident de s’arrêter aux confins de la Chine. A l’Ouest ils partent à l’assaut du Maghreb. En 670 le chef de guerre Uqba ibn Nafi part de l’oasis de Ghadamès en Libye. A la tête de 10 000 cavaliers il prend la Tunisie et fonde la ville de Kairouan. Puis il atteint l’Atlantique traversant l’Algérie et le Maroc actuels. Mais les Berbères qui habitent ces pays, menés par la reine des Aurès, Cahina (surnommée la Juive) résistent. Puis ils cèdent. Les Arabes les traitent avec tact et les assimilent. Tant et si bien que c’est un berbère, Tariq ibn Ziyad qui est chargé, en 709, d’organiser l’expédition d’Espagne. Il traverse le détroit en 711, débarque à Gibraltar et en octobre il occupe Tolède. En 714 il s’empare de Saragosse. Puis il occupe l’Andalousie et remonte vers la France. Charles Martel arrête sa progression à Poitiers en 732. A cette date l’Empire omeyyade s’étend des Pyrénées aux rives de l’Indus, du Sahara à la mer d’Aral. Jamais un empire aussi vaste n’avait encore été constitué. Toute la rive sud de la Méditerranée est désormais occupée par les Arabes musulmans. Ils ont un pied en Europe avec l’occupation de l’Espagne. Leur territoire s’étend largement à l’Est jusqu’aux confins de la Chine. En revanche ils ne parviennent pas à prendre Constantinople. Le noyau de l’Empire romain d’Orient résistera. La rive nord de la Méditerranée, l’Europe, ne sera pas non plus occupée.
-

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Kierkegaard insiste beaucoup sur le fait que contrairement à ce que l'on pense, l'esthète ne choisit pas. L'esthète n'est pas l'être du choix. Dans le stade esthétique on refuse le choix, ce qui en même temps, comme le dira Sartre, est un choix. Choisir de ne pas choisir est encore une façon de choisir. Mais ce n'est pas l'analyse de Kierkegaard. Au premier degré l'esthète refuse de choisir car il sait très bien spontanément que tout choix nous enferme. La dynamique du désir veut qu'il ne se ferme rien et que ne pas choisir c'est embrasser les possibles qu'offrent la vie, se confronter à la multiplicité des expériences possibles. L'esthète dit : je veux jouir de la vie. Mais qu'y-a-t-il dans cette expression se demande Kierkegaard, est-ce que cela va être une posture existentielle que nous allons pouvoir conserver ? Mais méfions-nous de cette expression car celui qui veut jouir de la vie fait de la vie une instance qui lui demeure extérieure. Tout se passe comme si la vie était une sorte d'objet à l'extérieur de moi que je veux m'approprier, posséder. Et bien entendu j'attends que cette position m'apporte du plaisir et de la satisfaction. Or je fais dépendre mon être et son devenir de quelque chose que moi je pense et je vis et me représente comme étant, non pas moi, mais quelque chose qui est extérieur à moi, c'est-à-dire la vie. Autrement dit l'esthète est celui qui n'a pas encore sa propre vie. Il n'imprime pas à la vie son propre sceau. Car s'il pouvait imprimer à la vie son propre sceau cela supposerait qu'il ait fait un choix. Or il ne peut et il ne veut pas choisir. Le choix constituera la marque privilégiée de l'autre stade, celui vers lequel lentement on s'achemine, c'est-à-dire le choix de l'éthique. Kierkegaard formule cela en disant que l'esthète ignore le « ou bien ou bien » c'est-à-dire la nécessité du choix. Dans le stade esthétique un plaisir en remplace un autre, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'alternative. L'esthète est prisonnier de sa jouissance dont il suit les exigences et les formes capricieuses. La seule activité qui lui soit possible c'est celle de la réflexion. Il pourra réfléchir peu à peu à la forme que pourra prendre son plaisir, c'est ce que fera le narrateur de la troisième figure de l'esthète, héros du « Journal du séducteur » Johannes qui représente la figure la plus accomplie du stade esthétique.