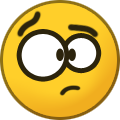-
Compteur de contenus
3 006 -
Inscription
-
Jours gagnés
1
Type de contenu
Profils
Forums
Blogs
Calendrier
Vidéos
Quiz
Movies
Tout ce qui a été posté par satinvelours
-

La philosophie. N'est-il pas urgent de redéfinir la philosophie?
satinvelours a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Le sujet est de redéfinir la philosophie. Et nous ne sommes qu’aux tout premiers philosophes. Annalevine le dit, le philosophe n’a encore pas de rôle social. La philosophie n’est pas apparue du jour au lendemain. Il y a une recherche progressive. Mais ce qu’il y a surtout c’est une manière de regarder les objets d’étude. Thalès (ou n’importe quel autre scientifique de l’époque Anaximandre, Anaximène,) possède déjà une connaissance de certains objets. Il est habitué à regarder certains objets. A un moment donné il regarde ces mêmes objets à partir d’une perspective différente. C’est le noyau de la question. L’origine de la philosophie c’est un regard nouveau sur des objets que les scientifiques sont habitués à regarder en fonction de leur métier. Un jour ils sont regardé d’une autre manière. C’est Aristote qui souligne cette notion de regard, et il forge une formule pour l’objet d’étude des premiers philosophes, il forge la formule : « philosophie première ». Philosophie première parce que c’est la philosophie qui, dans un ordre hiérarchique, s’occupe de l’essentiel des choses. L’origine des choses, la réalité des choses arrivent en premier. Ensuite il y aura des études secondaires, mais la philosophie première est celle qu’Aristote appelle métaphysique et commence avant. « Il y a une science qui théorise de l´être en tant qu’être ». C’est la théorie de l'étant en tant qu’étant. Être, étant est le même mot en grec. Il y a une science, la philosophie première, qui fait la théorie de l’être en tant qu’être. Ce qui est intéressant c’est le verbe « theorein », théoriser. En grec c’est traduit par contempler. À ce moment-là on regarde d’une manière différente les choses. Ce qu’un philosophe voit ce n’est pas évident comme sur une photo, il va aller au-delà de ce que l’on voit pour saisir l'être des choses. Pour saisir ce qu’il y a derrière les apparences des choses. À ce moment-là il y a une connaissance qui arrive seule. -

La philosophie. N'est-il pas urgent de redéfinir la philosophie?
satinvelours a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Le dire en une phrase ? Le philosophe apporte une manière nouvelle et différente de regarder les choses. Il y a un sujet, un verbe, un complément. -

La philosophie. N'est-il pas urgent de redéfinir la philosophie?
satinvelours a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Il me semble que je vous ai répondu. Je suis désolée si vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez. Je ne peux faire mieux. -

La philosophie. N'est-il pas urgent de redéfinir la philosophie?
satinvelours a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Si on regarde ces trois mots : philosophe, philosophie, philosopher, il y a quelque chose de curieux en ce qui concerne l’histoire. Deux substantifs : le philosophe, la philosophie est le verbe philosopher. Il y a quelque chose de curieux car le mot philosopher, le substantif philosophe, apparemment sont intérieurs dans le temps au mot philosophie. C’est le mot philosophe qui est attribué à Pythagore. Pythagore était aussi un mathématicien et se place dans le temps une cinquantaine d’années après Thalès, cela montre que peut-être il a fallu du temps pour trouver un mot qui s’appliquerait à ce que Thalès faisait. Diogène Laërce écrit que Pythagore reçu par le tyran Léon de Phlionte, admiratif de sa sagesse, lui pose la question de savoir comment est-il devenu sage. Pythagore aurait répondu selon cette anecdote « je ne suis pas sage parce que personne n’est sage mis à part la divinité. Je ne suis qu’un philosophe ». C’est le témoignage le plus ancien concernant le mot philosophe. Dans un autre passage il est raconté la même anecdote mais d’une façon différente. Pythagore aurait dit que « sur la place publique des gens cherchent la figuration, les richesses, moi je ne cherche que la vérité comme tous les philosophes. ». Le mot philosophie a mis du temps à être recueilli dans un document. Parce que le document le plus ancien qui recueille le mot philosophie est daté de la moitié du cinquième siècle, c’est-à-dire un siècle après. Cela ne veut pas dire que l’on a mis un siècle pour trouver un mot pour caractériser une discipline, la discipline qui consiste à philosopher. Peut-être que le mot se trouvait dans d’autres documents qui se sont perdus. C’était peut-être aussi un mot de la définition orale qui n’a pas été consacré dans un document. -

La philosophie. N'est-il pas urgent de redéfinir la philosophie?
satinvelours a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
La philosophie va se présenter comme un certain savoir. Avant de savoir agir, il faut savoir ce que sont les choses. C’est le rôle de la philosophie. Pourquoi les hommes désirent il naturellement savoir ? Aristote s’appuie sur le sens de la vue. La philosophie s’est constituée comme un nouveau regard sur la réalité. « Ceci est évident par le plaisir causé notamment par la sensation de la vue. Car même lorsque nous n’envisageons aucune action nous préférons la vue à tout le reste. La vue nous découvre une foule de différences ». Aristote fait un lien entre savoir et savoir. Le point de départ du savoir est une certaine manière de voir, de regarder la réalité, avec des yeux de l’esprit. Tous les hommes désirent regarder la réalité à partir d’une perspective différente. Les premiers philosophes étaient considérés comme des sages, des savants : astronome, physicien, médecin. Un astronome à regardé la planète autrement, d’abord comme des boules de feu, mais aussi comme des choses existantes, des « étants ». C’est un nouveau regard sur la réalité qui est appelé philosophie. Avant de présenter cette manière de regarder des choses qui est la philosophie, il a fallu placer cette sorte de connaissance à l’intérieur d’un désir naturel de connaître. C’est le rôle du philosophe, apporter une manière différente de regarder les choses. -

La philosophie. N'est-il pas urgent de redéfinir la philosophie?
satinvelours a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Pour en revenir à Thalès. Les réponses trouvées dans les mythes n’étaient pas satisfaisante pour une certaine culture grecque. Il a fallu attendre d’autres conditions historiques, sociales, culturelles pour ce que l’on appelle philosophie puisse voir le jour. Il faut se reporter 26 siècles en arrière, à Milet cité prospère de l’Ionnie, aujourd’hui côte occidentale de la Turquie. Au septième siècle avant notre ère Milet est un port avec des monuments, théâtre, une place publique, l’agora, où parfois se tient le marché. Sur cette place se trouve un personnage très connu qui savait qu’à un moment donné le soleil se cacherait derrière la lune. Il est témoin d’une « anomalie », une éclipse totale de soleil. Cette éclipse on peut la situer aujourd’hui le 28 mai de l’année 585 avant notre ère. C’est une date historique. Une éclipse totale de soleil vient de se produire. Ce personnage était tout d’abord inquiet parce qu’il avait prévu cette éclipse, il l’avait annoncée, peut-être ne savait-il pas que cela allait se produire ce jour. Ce personnage c’est Thalès. Dans toute l’histoire des philosophies on dit que Thalès fut le premier à philosopher. Cela n’a rien à voir bien sûr avec le fait d’avoir prévu une éclipse, s’il a philosophé c’est pour d’autres raisons. C’est un personnage connu dans sa cité comme astronome, mathématicien, ingénieur. C’est Aristote qui nous a transmis le nom de Thalès en rapport avec la philosophie. D’autres sources ont transmis le nom de Thalès par rapport à d’autres activités. Au début de son ouvrage « La métaphysique », Aristote, qui a vécu un siècle et demi après Thalès, fait une sorte de bilan des recherches que d’autres avaient menées avant lui dans ce domaine de la philosophie. Il dit qu’il y avait des penseurs qui s’étaient intéressés aux principes des choses, aux éléments qui composent les choses. C’était une manière de philosopher. Parmi les premiers qui vont philosopher dit Aristote il y avait de Thalès. Il me dis pas que Thalès a été le premier philosophe, mais il dit parmi les premiers se trouvait Thalès. Comme on ne trouve pas d’autres noms propres que celui de Thalès, c’est son nom qui est resté comme l’ancêtre de la philosophie . Dans un autre passage de la métaphysique Aristote dit que c’est dans cette manière de philosophie, cette manière qui consiste à se poser des questions sur le mouvement des choses, que la philosophie a commencé. À partir de ce témoignage d’Aristote il fallait placer Thalès dans le temps et dans l’espace . -

La philosophie. N'est-il pas urgent de redéfinir la philosophie?
satinvelours a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Pourquoi la Grèce ? On peut répondre parce que c’est cet ensemble de phénomènes, une conception spéciale des dieux, un pouvoir au-dessus des dieux, une structure sociale, qui a permis la naissance des individus. Tout cet ensemble de phénomènes a accompagné et déterminé les premiers pas de la philosophie. Ce qui ne veut pas dire que cette civilisation a été supérieure à d’autres civilisations, pas du tout, c’est une civilisation différente des autres, mais la spécificité grecque a produit de toutes pièces que l’on appelle philosophie. -

La philosophie. N'est-il pas urgent de redéfinir la philosophie?
satinvelours a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
C’est le surgissement des cités. On invente de toutes pièces la cité, en grec polis. La cité c’est une organisation sociale s’appuyant sur des organismes. Il n’y a pas de roi, pas de tyran, mais des organismes, des conseils, des tribunaux. Au début cela s’est produit d’une manière un peu improvisée. Petit à petit vont apparaître des lois, des lois écrites qui sont discutées dans des assemblées. Ce n’est pas le dictat d’un tyran, d’une classe d’aristocrates. On discute, c’est la discussion qui commence à entrer dans le jeu social. À ce moment-là, dans les cités, dans les poleis les plus prospère il y a des gens qui commencent à discuter. On dit que ces gens philosophent dans les cités, fin du septième début du sixième siècle. Les régions les plus prospères se situent dans l’Ionie, la côte occidentale de la Turquie au sud d’Izmir. C’est de là que viennent les Phocéens. -

La philosophie. N'est-il pas urgent de redéfinir la philosophie?
satinvelours a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Il y a une diversité d’explications, c’est comme si il n’y avait aucune explication. Il n’y a pas de textes révélés, il n’y a pas un textes sacrés. Si il y avait eu des textes sacrés, les choses aurait été plus facile, il y aurait eu une réponse. La mythologie est un ensemble disparate de récit, il n’y a rien du point de vue de la « connaissance ». Israël est une exception parce qu’il y a le mythe, là où dans la plupart des cultures il y a plusieurs dieux. Un Dieu unique, créateur à partir du néant est propre à la culture juive, dans d’autres civilisations on ne trouve pas cela. Je crois que c’est surtout la conception de la divinité des dieux, propre au peuple grec qui a marqué la distension par rapport à d’autres civilisations. -

La philosophie. N'est-il pas urgent de redéfinir la philosophie?
satinvelours a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Élément décisif qui va produire l’essor de la philosophie, c’est le changement vertigineux de structure de la société grecque entre la moitié du huitième siècle et tout au long du septième siècle. C’est un changement de structure dans la société, un changement que nous allons trouver en Grèce et nulle part ailleurs. Pourquoi ce délai ? Pourquoi tout se termine au huitième siècle, au moment où les Grecs adoptent l’écriture ? À ce moment-là il n’y a pas encore de philosophes. Ce n’est qu’au sixième siècle que les philosophes font leur apparition. Il nous reste cette période moitié du 8e et 7e. Que s’est-il produit à cette époque ? Des années 750 aux années 600 avant notre ère ? Il se produit un essor monumental du commerce dans les régions les plus prospères. Et la conséquence de cet essor du commerce, que l’on appelle la colonisation, c’est un phénomène qui se développe le long d’un siècle et demi, de la moitié du 8e et tout au long du 7e. Il y aura un essor économique favorisé par l’adoption de l’écriture (l’écriture est prise des phéniciens qui étaient les commerçants par excellence de l’époque). Commence alors cette extension des régions très prospères, à s’installer dans tout le monde connu, d’abord au nord de l’Afrique, puis le sud de l’Italie et un siècle après en Corse et à Marseille. C’est cet essor économique qui, petit à petit, a pour conséquence le changement de la structure de la société grecque. Parce que les Grecs étaient totalisés dans des royaumes à l’époque des poèmes homériques, tous les héros sont des petits rois : Ulysse roi d’Ithaque, Ménélas roi de Sparte, Agamemnon roi de Mycènes… Une fois qu’une « classe sociale » produit des richesses [la classe des commerçants qui surgit à cette époque], le pouvoir commence à être partagé d’abord entre le roi et l’aristocratie, puis la classe commerçante. Et nous arrivons au 7e siècle, à ce phénomène tout à fait spécifique de la culture grecque, le surgissement des cités : Milet, Éphèse et d’autres cités . -

La philosophie. N'est-il pas urgent de redéfinir la philosophie?
satinvelours a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Mais toujours : pourquoi la Grèce ? Les premières réponses ont lieu dans un univers mythique, dans les récits mythiques, cosmogonie, dans des mythologies. Il y a aussi une coïncidence en ce qui concerne les questions à propos desquelles on trouve des réponses dans presque toutes les civilisations. Ces questions tournent autour de l’origine du cosmos, de l’origine des choses et de la régularité que l’on trouve dans l’univers . Il n’y a pas de textes dans la tradition grecque qui recueillent des mythes cosmogoniques, qui sont antérieurs aux premier textes philosophiques. Il y a de nombreux récits mythologiques à propos de l’origine du cosmos, mais tous ces récits se trouvent dans des ouvrages, dans des textes qui sont postérieurs à la naissance de la philosophie. C’est déjà une spécificité propre à la civilisation grecque. Les Grecs adoptent l’écriture au début du huitième siècle. Avant ce moment-là il n’y a aucun récit, même oral, grec attesté sur l’origine des choses. Dans le même temps il y en a dans toutes les civilisations. C’est déjà une spécificité grecque qui petit à petit va déboucher directement sur la philosophie. « L’être humain désire naturellement savoir », vérité indéniable. Mais en ce qui concerne le peuple grec à l’époque, les récits mythiques sont insuffisants car ils sont multiples, ils sont contradictoires. Il faut trouver des arguments pour prouver des choses. Le fait de pouvoir admettre qu’il y avait un pouvoir anonyme au-dessus des dieux, c’était déjà un germe de la philosophie. Ensuite les philosophes vont appeler ces principes qui sont supérieurs aux dieux, la raison universelle, les stoïciens vont l’appeler le logis universel, d’autres la nécessité logique, Héraclite va l’appeler la loi du cosmos. C’est quelque chose qui s’impose même aux dieux. Il y a donc déjà le germe, c’est-à-dire que tout est prêt pour qu’une nouvelle étape commence. Il y a ce désir de savoir, il y a l’insuffisance d’une réponse -

La philosophie. N'est-il pas urgent de redéfinir la philosophie?
satinvelours a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Cela implique que l’on a pu, à partir de ces noms propres, situer l’origine de la philosophie en Grèce. -

La philosophie. N'est-il pas urgent de redéfinir la philosophie?
satinvelours a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Oui, c’est cela. Les réponses se trouvent dans les récits mythiques, la civilisation grecque comprise. Il y a des mythes qui ont raconté l’origine des choses, de l’homme, d’un certain ordre cosmique. Ces récits mythiques restent anonymes. Dès qu’il y a un auteur le mythe n’est plus admis. Depuis la nuit des temps jusqu’au septième ou huitième siècle avant notre ère, les récits mythiques sont anonymes, restent dans l’univers de l’oralité. Ils existent aussi en Grèce. Mais pourquoi en Grèce y a-t-il eu un glissement de cette pensée dite mythique vers la philosophie, pourquoi dans d’autres civilisations ce glissement n’a pas eu lieu ? Qui avait-il en Grèce pour permettre ce glissement ? Je ne pense pas qu’il y ait une coupure totale entre ce qu’on appelle la pensée mythique et la pensée rationnelle. On disait, avant les travaux de Jean-Pierre Vernant, que la philosophie consacre le passage du mythe à la raison. Ce n’est pas sûr. D’abord il y a des sujets principaux pour lesquelles les mythes proposent une réponse. Ce sont exactement les mêmes sujets auxquels vont répondre les tout premiers philosophes. Par exemple ce que l’on appelle les mythes fondateurs dans n’importe quelle culture, c’est l’origine du cosmos, c’est l’origine de l’ordre que l’on voit dans le cosmos. Il y a un glissement du mythe à la philosophie. Le premier glissement concerne les grands sujets, le deuxième consiste dans la méthode. Le cas de la philosophie est un peu spécial. Dans le cadre d’autres activités mais ne savons pas quand et à l’intérieur de quelle culture, de quelle civilisation il y a eu le premier pas de la musique, de la littérature. Il n’y a pas de témoins des premiers pas de la musique, de la littérature, de la sculpture… Il n’y a pas de témoins, pas de noms proposés. En revanche il y a des témoins des premiers pas de la philosophie. Il y a des textes anciens parmi lesquels nous trouvons des noms propres et nous savons qui étaient les premiers qui ont philosophé. Ceux qui ont philosophé pour la première fois l’on fait dans des cités grecques. Il y a un lien entre la philosophie, une culture et une civilisation que nous ne trouvons pas entre la musique et une certaine culture, entre la littérature et une certaine culture. La philosophie ne peut pas se dégager de ses racines. Il y a un lien entre la philosophie et la civilisation à l’intérieur de laquelle elle est née, a fait ses premiers pas. -

La philosophie. N'est-il pas urgent de redéfinir la philosophie?
satinvelours a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
C’est à partir de ce détournement du regard que la philosophie se met en marche. On invente alors un mot : philosophia, amour d’une sagesse. La philosophie est une question de regard. Ce regard qui aboutit à une connaissance appartient à la nature humaine. Les premiers pas de la philosophie, c’est la mise en place d’une potentialités propre à l’être humain. Il possède en germe cette possibilité de philosopher. Pourquoi ce germe a poussé en Grèce seulement ? Quelles étaient les circonstances historiques, économique, qui ont permis que ce désir naturel de philosophie fleurisse en Grèce et non pas dans d’autres civilisations ? Ce désir de connaître, de regarder la vérité différemment, du moment où il appartient naturellement à l’espèce humaine n’a pas attendu la naissance de la philosophie pour s’exprimer. Depuis la nuit des temps il existe chez l’être humain le désir de s’expliquer la réalité. Les grandes questions ont toujours été proposées par des civilisations lorsqu’elles sont arrivées à un certain niveau de culture : la mort après la vie, le jour après la nuit…. -

La philosophie. N'est-il pas urgent de redéfinir la philosophie?
satinvelours a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Il faudrait se demander d’abord pourquoi la Grèce ? La philosophie n’est pas grecque, mais c’est la philosophie qui fut pratiquée par des Grecs dans les temps de l’Antiquité. Philosophie dite ancienne, dite antique, « dite » parce qu’elle n’est ni ancienne, ni antique, mais fut appliquée par des gens de l’Antiquité. Les premiers pas de la philosophie : c’est-à-dire des origines, de l’avènement, de la naissance de la philosophie, de sa gestation. Il est admis par tout le monde que la philosophie a fait ses premiers pas dans les cités grecques, où des Grecs pensaient grec, parlaient en grec, écrivaient en grec. Et parmi ces gens là nous trouvons les tout premiers philosophes. La philosophie a fait ses premiers pas à l’intérieur d’une civilisation. Le fait que les tout premiers philosophes appartenaient à la civilisation grecque a créé une symbiose entre la philosophie et la Grèce. Cette origine grecque de la philosophie l’a marquée pour toujours. Ce n’est pas un accident. Nous sommes dans une période de crise. Il faut jeter un regard vers le passé pour essayer de comprendre pourquoi, à un moment donné qui était peut-être aussi un moment de crise, déjà on a inventé une nouvelle manière de regarder les choses. Pourquoi ? Pour trouver des solutions à des problèmes vitaux. Si la philosophie n’est pas bonne pour nous aider dans notre vie de tous les jours, elle ne sert à rien. Il s’agit de partager ce que les Grecs appelaient le « pathos », c’est-à-dire l’émotion. Un état d’âme qui les a poussés à trouver une autre façon de regarder les choses, une autre solution. La philosophie va se présenter comme un certain savoir. Chez les Grecs toute la philosophie a été orientée vers une certaine connaissance afin d’ établir des modèles de vie acceptable. Avant de savoir agir, il faut savoir ce que sont les choses. C’est le rôle de la philosophie. -
Lettre 60-1 15 décembre 2019, Samuel, XVII siècle Evolution générale en Europe A ) La guerre de Trente ans. 2) De 1635 à 1648 En France, après le règne de Henri IV, de 1589 à 1610, règne au cours duquel le Roi redressa la France grâce à l’aide de Sully (équilibre des finances, développement de l’agriculture) et à celle de Laffemas (développement de l’industrie) succéda Louis XIII son fils. Né en 1601 il n’avait que 9 ans à la mort de son père. Ce fut sa mère, Marie de Médicis qui assura le régence. En 1624 Louis XIII, après avoir pris le pouvoir en 1617, s’adjoignit comme conseiller Richelieu. Armand du Plessis de Richelieu, catholique, était un homme ambitieux pour son pays. Il voulait contrer la puissance des Habsbourg mais surtout celle de l’Espagne qui menaçait la France par les possessions qu’elle avait au Sud : le Roussillon (région de Perpignan), au Nord : l’Artois (région d’Arras) et à l’Est : la Franche Comté (région de Besançon). Voir carte. Il eut d’abord à faire face à la subversion des protestants qui essayaient toujours d’étendre leur influence et qui par surcroît s’insurgeaient contre le mariage du roi avec une catholique espagnole, Anne d’Autriche, fille du roi d’Espagne Philippe III et de l’archiduchesse Marguerite d’Autriche-Styrie, ces deux derniers appartenant à la maison des Habsbourg. Comme les protestants détenaient certaines places fortes le cardinal entreprit de les en déloger. Il fit ainsi le siège de la Rochelle, le principal centre de pouvoir des protestants. Le 29 octobre 1628 la ville tomba malgré le soutien que lui apportèrent les Anglais. La prise des places fortes continua jusqu’à la signature de l’édit de grâce d’Alès signé en 1629. Les protestants ou huguenots, comme ils étaient nommés à cette époque, perdirent leurs privilèges politiques.La liberté de pratiquer leur culte fut en revanche réaffirmée. Depuis le début de la guerre de Trente ans la France s’était contentée de soutenir les opposants à l’Empereur et au roi d’Espagne. Le cardinal de Richelieu soucieux d’affaiblir la puissance des Habsbourg offrit son alliance à Gustave-Adolphe en 1631 par le traité de Bärwalde. En effet malgré les différences de religion entre la France catholique et la Suède protestante les deux royaumes poursuivaient un même but : contenir la puissance militaire du Saint Empire. Le roi de Suède s’engageait à maintenir en Allemagne une armée de 36 000 hommes, à respecter le culte catholique en échange de quoi le cardinal finançait son effort de guerre. A la mort de Gustave-Adolphe en 1631 lors de la bataille de Lützen (lettre 60) cet accord fut reconduit par ses successeurs par un nouveau traité signé à Compiègne en 1635. En Espagne, après la mort de Philippe II (voir lettre 59-5) lui succéda son fils Philippe III né en 1578. C’était un homme effacé et sans caractère. Il laissa le pouvoir à ses hommes de confiance appelés : favoris. Sous son règne l’Espagne connut le début d’une crise économique sévère, conséquence de l’afflux des métaux précieux venus des colonies d’Amérique du sud (voir fin de la lettre 59-5). C’est lui qui signa avec les Provinces Unies une trêve de douze ans en 1609 (voir lettre 59-5). En 1618 quand éclata la guerre de Trente ans il prit partie pour les Habsbourg. Il décéda le 31 mars 1621. Son fils Philippe IV né en 1605 lui succéda. La trêve de Douze ans signée entre Philippe III et les Provinces Unies s'achevait en 1621. Philippe IV ne la reconduisit pas et reprit la guerre. Ce conflit fera l’objet d’une autre lettre. Devant l’activisme du roi d’Espagne, qui par surcroît occupait depuis 1621 le Palatinat en renfort des armées de l’Empereur Ferdinand II (voir lettre 60), État situé aux portes de la France (l’occupation du Palatinat permettait d’établir un relais entre les troupes du Roi d’Espagne stationnées dans le Duché de Milan (devenu possession espagnole en 1540) et le champ de bataille des Provinces Unies), Richelieu décida de faire la guerre à l’Espagne. Le 19 mai 1635 Louis XIII déclara la guerre. Le Roi de France et son conseiller portèrent leurs efforts sur quatre fronts : Vers le nord, c’est-à-dire vers les Pays Bas espagnols Vers l’est avec en vue le duché de Lorraine, l’Alsace et les pays rhénans appartenant au Saint Empire, avec aussi en vue la Franche Comté appartenant à l’Espagne Vers l’Italie du nord, dans le Piémont pour attaquer le duché de Milan Vers le sud pour attaquer directement l’Espagne La campagne de 1636 fut très difficile pour la France. Les opérations en Italie piétinèrent de même que les opérations lancées à l’Est. Dans le Nord les Espagnols pénétrèrent en France et prirent Corbie (sur la Somme) à 150 kilomètres de Paris menaçant ainsi la capitale. Les Français parvinrent à reprendre Corbie et à bloquer la menace espagnole. Au Sud, l'Espagne s'empara de Saint Jean de Luz et menaça le Sud-Ouest. En octobre 1636 les Suédois toujours stationnés dans le territoire du Saint Empire défirent les Impériaux à Wittstock (État de Brandebourg) ce qui soulagea les Français à l’Est. En 1637 l’Empereur Ferdinand II mourut, son fils et successeur l’Empereur Ferdinand III lui succéda. Jusqu’en 1639 les positions ne changèrent pas de manière significative. En 1640 l’Espagne dut affronter deux insurrections : celle du Portugal (qui fut suivie par une guerre d’indépendance qui dura 28 ans) et celle de la Catalogne. Ces deux sécessions affaiblirent l’Espagne et permirent à la France de lui prendre au nord l’Artois, en 1641, et au sud le Roussillon, en 1642, tandis que le front Sud, contre l’Espagne même, finit par être stabilisé. Tandis que le front en Italie restait incertain, sur le front de l’Est un prince allemand (Bernard de Saxe-Weimar) dont les troupes étaient stationnées en Alsace passa du côté de la France. Lorsqu’il mourut en 1639 Louis XIII prit son armée à son service et se trouva ainsi, de fait, maître d’une partie de l’Alsace. C’est alors que mourut Richelieu en 1642 puis Louis XIII en 1643. Anne d’Autriche, la femme de Louis XIII, assura la régence, Louis XIV son fils et celui de Louis XIII n’ayant alors que 5 ans. Elle s’adjoignit comme conseiller Jules Mazarin qui prit le titre de premier ministre. C’est lui qui dirigea les affaires de la France jusqu’ à sa mort en 1661. Profitant du trouble engendré par la mort de Louis XIII les Espagnols s’avancèrent en Ardenne. Ils y furent défaits à la célèbre bataille de Rocroi, le 18 mai 1643, par un général de 22 ans, Louis de Bourbon, duc d’Enghien, surnommé plus tard « le grand Condé ». Aidé par Turenne, opérant en accord avec les Suédois menés par Torstenson qui volait de succès en succès à l’intérieur même de l’Empire, Condé remporta la grande victoire de Zusmarshausen (17 mai 1648) en Bavière contre les Impériaux ce qui conduisit Ferdinand III à déposer les armes et à signer la paix de Westphalie le 24 octobre 1648. Je t’embrasse, Bonnes vacances à New York et bonnes fêtes de fin d’année. Je t’aime, mes pensées toujours t’accompagnent
-
-
Lettre 60 13 décembre 2019, Samuel, XVII siècle Evolution générale en Europe A ) La guerre de Trente ans. 1) De 1618 à 1635 Cette guerre commença en 1618 en Europe centrale, puis elle s’étendit à toute l’Europe occidentale. Elle fit suite aux guerres de religion du XVI siècle, aux guerres entre la Réforme et la Contre-réforme (voir lettre 59-3 et 59-4). En Allemagne appelée alors le Saint Empire romain germanique, la paix d’Augsbourg de 1555 (lettre 59-3) maintenait un équilibre fragile entre catholiques et protestants. Les princes, ou Électeurs, imposaient leur religion à leurs sujets. Le Saint Empire était dirigé depuis 1452 par la maison de Habsbourg (ou maison d’Autriche) deconfession catholique (elle régna jusqu’en 1740). L’empereur était élu à la tête d’une mosaïque de 350 États regroupés en partie (l’autre partie restait autonome mais soumise à l’Empereur) sous sept Électorats (territoires) gouvernés chacun par un Électeur : les archichanceliers de Mayence, de Cologne et de Trèves, le roi de Bohème, le comte palatin du Rhin, le duc de Saxe, le margrave de Brandebourg. Ce sont ces sept Électeurs qui élisaient l’Empereur. En 1617 Ferdinand de Styrie, un Habsbourg, catholique donc, devint souverain de Bohème (composante de la République tchèque actuelle). C’était un territoire à majorité protestante qui devenait gouverné par un souverain catholique résolu à faire triompher sa religion dans son Électorat. Le 23 mai 1618 une délégation de protestants du royaume se rendit à Prague, la capitale, pour exiger des explications au gouvernement à propos des mesures de plus en plus rigoureuses prises à leur encontre. Le ton monta, les délégués réformés précipitèrent par une fenêtre dans les fossés du château deux conseillers catholiques (Martinic et Slavata) ainsi que Fabricius un secrétaire impérial (ils tombèrent sur un tas de fumier ce qui les sauva). Cet événement resta dans l’Histoire sous le nom de : Défenestration de Prague. Puis les révoltés protestants formèrent un gouvernement insurrectionnel provisoire composé de 36 membres. Le 31 juillet 1619 ils proclamèrent la fédération de Bohème. Ils recrutèrent une petite armée. Ils déclarèrent ne plus reconnaître Ferdinand comme roi et ils offrirent la couronne à un prince protestant, l’Électeur Palatin Ferdinand V qui accepta et devint roi de Bohème le 26 août 1619. L’Empire dans un premier temps ne réagit pas. Les forces en présence étaient les suivantes : « L’Union évangélique » constituée en 1608 regroupait les États protestants dirigés par l’Électeur du Palatinat Frédéric V. Cette Union se rapprocha de Henri IV, le roi de France (voir lettre 59-4), ce qui exaspéra les catholiques français. Un exalté, Ravaillac, décidé à défendre la catholicisme, assassina le roi de deux coups de couteau en 1610. « La Sainte Ligue allemande » constituée en 1609 regroupait les États catholiques dirigée par Maximilien, le duc de Bavière.Cette Ligue se rapprocha de l’Espagne. Elle était en outre protégée par les Empereurs catholiques. Le 28 août 1619 Ferdinand de Styrie succéda à Matthias 1er comme Empereur du Saint Empire sous le nom de Ferdinand II (il régna jusqu’en 1637). Cette élection déclencha la réaction de l’Empire. L’armée catholique, dirigée par le comte de Tilly, sous l’autorité de Maximilien le bavarois, soutenue par l’Espagne et par le Pape, attaqua l’armée des insurgés près de Prague, le 8 novembre 1620. Cette bataille resta dans l’Histoire sous le nom de bataille de la Montagne Blanche. Les protestants furent écrasés. Frédéric V dut s’enfuir, son Électorat fut occupé par des troupes bavaroises et espagnoles et Maximilien reçut la dignité électorale jusque là détenue par l’Électeur Palatin. La couronne de Bohème revint à la famille Habsbourg qui en fut déclarée régnante héréditaire (alors qu’auparavant le roi était élu). L’Empereur Ferdinand II administra donc le pays. Il entreprit une sanglante répression et une campagne de conversions forcées au catholicisme. La langue allemande remplaça la langue tchèque. Ce fut une grande victoire pour le catholicisme car il n’ y avait plus désormais en Allemagne que deux Électorats protestants ceux de Saxe et de Brandebourg. Le roi du Danemark (qui à l’époque comprenait le Danemark actuel, la Norvège, l’Islande et le Groenland, voir carte), Christian IV, protestant, craignant une hégémonie catholique en Allemagne qui aurait pu menacer ses possessions dans ce pays, (il y possédait le duché de Holstein), rentra dans la guerre. Ferdinand II fit appel à un chef de guerre Wallenstein. Ce chef de guerre s’était considérablement enrichi et s’était constitué une armée privée en sous-traitant avec l’Empereur : contre la liberté de lever le tribut dans les territoires protestants occupés, Wallenstein offrait les services de son armée à l’Empire. L’armée du roi du Danemark fut vaincue par les mercenaires de Wallenstein, Christian IV se retira après avoir signé la paix de Lübeck en 1629. Alors Ferdinand II n’ayant plus d’adversaire sérieux contraignit les protestants de son Empire, par l’édit de restitution (1629) à rendre toutes les terres catholiques que certains princes régnants s’étaient appropriées depuis 1555 en faisant valoir leur appartenance protestante. Toujours allié avec l’Espagne catholique il se rapprocha de la Pologne pour monopoliser le commerce dans la mer Baltique. Il s’attaquait ainsi aux intérêts économiques de la Suède qui contrôlait largement le commerce de cette mer. Les monarchies bordant la Baltique formaient alors un ensemble de territoires de première importance pour l’Europe. Elles fournissaient du blé en quantité (ce qui permettait de faire face aux disettes), des fourrures, du miel, du bois, des métaux, du goudron (essentiel pour la calfatage des bateaux) du poisson (harengs notamment). De leur côté elles avaient besoin de produits tels que l’huile, l’alun, les épices, le sel, le vin qu’elles trouvaient surtout en Europe du sud. Aussi la mer Baltique était-elle un lieu de commerce intense et vital qu’il était important de contrôler. L’espace géopolitique de la région était complexe. Son unité s’était brisée lorsque le système des trois couronnes qui maintenait toute la Scandinavie sous l’hégémonie danoise fut démantelé. Ce système appelé Union de Kalmar dura de 1397 à 1523. La Suède se retira de la confédération en 1523 tandis que le Danemark et la Norvège restèrent unis dans une entité politique nommée Danemark-Norvège jusqu’en 1814. Le contrôle de la Baltique faisait périodiquement l’objet de guerres entre les pays limitrophes de cette mer, Danemark, Suède, Pologne, Russie. Les lieux stratégiques convoités étaient la Scanie et le détroit de Sund pour le contrôle de l’accès à la mer du Nord et le golfe de Finlande pour l’accès à la Baltique (carte). Entre toutes ces puissances la Suède se distingua par ses succès et sa croissance territoriale. Depuis 1611 Gustave-Adolphe, protestant, régnait sur un royaume qui comprenait la majeure partie de la Suède actuelle, la Finlande et l’Estonie. Voyant la défaite du Danemark il décida de profiter de la situation pour renforcer sa puissance. Il s’empara de Stettin en Poméranie en 1630 puis il tenta de se présenter comme le champion des libertés germaniques c’est-à-dire des libertés protestantes allemandes. Mais il n’obtint le ralliement des Électeurs protestants de Saxe et de Brandebourg qu’après le terrible sac de Magdebourg en Saxe par le comte de Tilly. En mai 1631 celui-ci attaqua la ville peuplée de 30 000 habitants. Pratiquement tous furent tués. Cet événement provoqua l’indignation dans toute l’Europe. Les protestants en appelèrent à la vengeance divine. Du coup Gustave-Adolphe fut considéré comme le guerrier de Dieu chargé de foudroyer l’armée de Tilly. Gustave Adolphe affronta Tilly le 17 septembre 1631 à Breitenfeld, il écrasa son armée. Puis il poursuivit son avancée vers le sud, combattant à plusieurs reprises l’armée impériale reconstituée. Les pays sillonnés furent dévastés, les Suédois atteignirent l’Alsace et les pays rhénans puis ils se dirigèrent vers Munich en Bavière. Ferdinand II rappela Wallenstein. Ce dernier affronta les Suédois à Lützen au sud-ouest de Leipzig. Les Suédois gagnèrent la bataille mais Gustave Adolphe fut tué. Sa mort désorganisa le commandement de l’armée suédoise. L'héritière du royaume, Christine de Suède, âgée de six ans, laissa gouverner le régent Axel Oxenstierna qui poursuivit la politique allemande de Gustave Adolphe De son côté, Wallenstein commença à travailler pour son propre compte dans le but de se constituer son propre royaume. Ferdinand II, informé de sa trahison, le fit assassiner le 25 février 1634. Les catholiques menés désormais par l'archiduc Ferdinand, le fils de Ferdinand II, aidés par les Espagnols commandés par Ferdinand d’Autriche, l’un des fils de Philippe III d’Espagne (dont l’épouse était la sœur de Ferdinand II) en route quant à eux vers les Pays-Bas, battirent les Suédois à Nördlingen le 6 septembre 1634. Les Suédois subirent ainsi un revers mais ils ne furent pas anéantis pour autant et ils continuèrent à intervenir en Allemagne jusqu’à la signature des traités de Westphalie de 1648. Samuel, Du 22 décembre au 30 décembre 2019 ce sera la fête de Hanouka ou Fête des Lumières dont je t’ai parlé dans la lettre 1 et dans la lettre 28. Je suis fier que tu saches incarner l’âme russe comme te l’a confirmé ton maître de danse du Bolchoï. Félicitations aussi pour ta rapidité à apprendre à jouer de la balalaïka et savoir monter un cheval au galop. Tu apprends vite. Maintenant tu sais incarner l’âme des Cosaques. Dans ce restaurant, ce vieil homme ému par les chansons du patrimoine russe que tu lui a jouées, t’a rendu hommage. En te serrant contre lui, en te confiant comment sa mère l’éleva quand son père mourut au front, il t’a communiqué toute la douleur russe. Tu as su gagner la confiance de ce grand peuple. Je t’aime, Je pense chaque jour à toi
-
-
Pas de réponses à la question, pas de conseils. Simplement une histoire qui n’est, sans doute, aucunement en rapport avec ce que vous cherchez, juste un témoignage. Cette non envie de vivre avec impossibilité de mourir, cette souffrance, c’était la désespérance. La désespérance davantage dans la non envie de vivre. Alors on végète, jour après jour, on décide, mais est-ce vraiment une décision car on est au fond d’un gouffre, dans l’incapacité de penser ! on « décide » de ne plus se nourrir, ce n’est pas compliqué puisque l’impression est que la vie n’est plus en soi, jusqu’à ce que l’on tombe dans la rue et, là, direction l’hôpital, car on est en état d’urgence. Plusieurs mois à l’hôpital avec séances de psychothérapie. Eh oui il y avait aussi un travail psychique ! Et puis on ressort, mais avec une béquille. Et là, détermination : retrouver la vie, évidemment une autre vie, décider, car maintenant c’est une volonté, décider que la vie, après tout, est digne d’être vécue. Alors jeter sa béquille et vivre la vie comme elle se présente, pas toujours facile, essayer de ne plus se concentrer sur soi, pas évident, mais sur les autres. Ce fut la meilleure des thérapies. La mienne.
-
Lettre 59-11-5 17 novembre 2019, Samuel, XVI siècle La saga des Juifs 10) Les Juifs au Maghreb Les Juifs de la péninsule Ibérique commencèrent à émigrer au Maghreb dès 1391, essentiellement au Maroc et dans l’ouest algérien (Oran). Appelés megorashim ils furent bien accueillis par les autorités musulmanes, moins bien accueillis par les Juifs autochtones, appelés toshavim, qu’ils finirent par dominer socialement. En août 1415 les Portugais débarquèrent à Ceuta puis ils installèrent leurs comptoirs le long de la façade atlantique du Maroc (voir lettre 59-7). L’arrivée des Portugais créa des tensions et des conflits avec la population musulmane, conflits qui rejaillirent sur les Juifs, notamment ceux de Fès qui, sous le pouvoir des dynasties des Mérinides puis des Idrissides, furent confinés à partir de 1438 dans un quartier spécial, le mellah, avant d’être massacrés en 1465. Pourtant en 1492, lors de l’expulsion des Juifs d’Espagne le nouveau souverain du Maroc, Mohammed al-Shaykh (1471-1505) de la dynastie des Wattassides, dynastie qui régna de 1471 à 1554, leur accorda l’ hospitalité. Pendant tout le XVI siècle les marranes émigrèrent au Maroc et dans l’ouest algérien où ils purent reprendre leur religion d’origine. A partir de la deuxième moitié du XVI siècle la nouvelle dynastie régnante, celle des Saadiens (lettre 59-7) reprit progressivement aux Portugais leurs comptoirs.Le Portugal perdit même son indépendance lorsque Philippe II l’annexa au royaume d’Espagne. L’émigration en provenance de la péninsule Ibérique alors s’atténua puis s’arrêta. A la fin du XVI siècle puis lors du siècle suivant cette émigration fut remplacée par une émigration venue de Livourne (Italie, port de la côte Tyrrhénienne). Les megorashim s’imposèrent rapidement et réunirent sous leur autorité les toshavim en raison de leur haut niveau culturel mais aussi en raison de leur nombre. Ils occupèrent des fonctions économiques de haut vol : gros commerçants, exploitants du sucre de canne, activité que les Saadiens développèrent dans le sud marocain, orfèvres, interprètes, diplomates…) 11) Les Juifs dans l’Empire ottoman L’attitude des Juifs resta empreinte de chaleur à l’égard de la Turquie pendant tout le XVI siècle (voir lettre 58-4). Les émigrés en provenance de la péninsule Ibérique s’installèrent en premier lieu, dès 1492, à Constantinople. Ils y retrouvèrent des communautés juives issues de l’ancien empire byzantin : les Romaniotes, mais aussi des communautés venues des Balkans (après la conquête de cette région par Mehmet II) et d’Égypte (après la conquête de ce pays par Sélim Ier). Puis Soliman le Magnifique (voir lettre 59-6) conquit l’Île de Rhodes en 1522. Il y envoya les Juifs de Salonique (Grèce) afin qu’ils la développent. Après sa victoire militaire à Mohacs en 1526 (lettre 59-6) il transféra une partie des Juifs de Hongrie dans plusieurs villes ottomanes dont Safed en Palestine. Appréciés par les Ottomans les réfugiés ibériques s’imposèrent à toutes les communautés juives de Constantinople. En 1535 la communauté juive de la ville comptait 40 000 habitants soit 10 pour cent de la population totale. A la même époque Salonique comptait environ 18 000 Juifs ce qui en faisait la seconde métropole juive de l’Empire. D’autres réfugiés auxquels s’associèrent des ashkénazes fuyant les persécutions en Europe (notamment en Allemagne) s’établirent dans des villes périphériques de Turquie, mais aussi en Syrie, en Palestine et en Égypte. Exerçant librement toutes les professions, parlant plusieurs langues, dont les langues européennes, ces réfugiés se taillèrent rapidement une place privilégiée dans le commerce maritime de l’Empire. Salonique par exemple devint l’une des cités marchandes les plus dynamiques des Balkans ottomans.Elle commerçait avec l’Égypte, le golfe Persique, avec Venise et Ancône. C’est à Ancône, appartenant alors aux États pontificaux, que le Pape Paul IV brûla 25 marranes et en emprisonna une trentaine d’autres (lettre 59-11-3). La conséquence fut un bras de fer entre les commerçants juifs de l’Empire épaulés par le Sultan et Paul IV. Le Sultan adressa une lettre de protestation injurieuse au pape exigeant la libération immédiate des marranes sous menace d’arrêter toutes relations commerciales avec Ancône. Le Pape céda, les marranes furent relâchés et le Pontife mit un terme à ses menées exterminatrices. Les réfugiés juifs ne devinrent pas seulement commerçants mais aussi orfèvres, tailleurs de diamants, tisserands, parfumiers, marbriers, menuisiers, chaudronniers, potiers, cordonniers tailleurs, etc. Ils exercèrent aussi dans le métier de médecin. La Palestine, après sa conquête par Sélim Ier (lettre 59-6, la Palestine est entendue dans cette lettre comme partie de la Syrie) reçut à son tour des expulsés d’Espagne. Soliman y encouragea le développement du commerce et de l’artisanat. Les Juifs s’installèrent surtout à Safed (ville de Galilée) tandis que les musulmans s’installèrent surtout à Jérusalem. Safed qui comptait près de 5000 juifs à la fin du XVI siècle, riche de l’apport culturel des séfarades (les Juifs d’Espagne et du Portugal), s’imposa comme l’un des plus grands centres d’érudition juive du monde. Réunissant l’étude et la contemplation, les écoles de mystique de Safed donnèrent naissance à quelques-uns des plus grands noms de la kabbale tels Shlomo Elkabetz (1505-1584), Moshé Cordovero (1522-1570) et surtout Itshaq Louria (1534-1572). Ce dernier redéfinit certaines notions centrales de la pensée juive relatives à la « fin de l’exil », au messianisme, à la rédemption d’Eretz Israël conférant ainsi une signification plus terrestre, plus temporelle à l’attachement des Juifs à la Terre sainte. Enfin le rabbin Jospeh Caro (1488-1575) termina en 1555 son ouvrage Choulhan Aroukh (La Table dressée) recueil succinct de toutes les lois juives. Ce livre devint un ouvrage de référence dans toute la diaspora juive mondiale. L’Égypte, conquise en même temps que la Syrie-Palestine par Sélim Ier reçut également des réfugiés séfarades qui s’installèrent surtout au Caire et à Alexandrie mais aussi dans quelques villes du littoral et de l’intérieur. Occupant des fonctions identiques à celles des autres communautés juives de l’Empire (commerce international notamment), ils furent en outre employés dans la frappe de monnaie ce qui les conduisit à se spécialiser dans les opérations de change. 12) Les Juifs en Perse La Perse ne fut pratiquement pas affectée par les bouleversements démographiques et culturels provoqués par l’expulsion des Juifs de la péninsule ibérique. Tout se passa comme si l’aire d’expansion séfarade en Méditerranée (à laquelle s’associa une minorité d’ashkénazes) s’était arrêtée le long de la ligne de partage séparant l’islam sunnite de l’islam chiite. Je t’embrasse, Je t’aime
-
Lettre 59-11-4 14 novembre 2019, Samuel, XVI siècle La saga des Juifs 8) Les Juifs en Pologne Nous avons vu (lettre 59-8) que la Pologne et la Lituanie sous l’impulsion d’abord des Jagellons puis d’Étienne 1er Bathory, réunies en 1569 sous le nom de République des Deux Nations étaient devenues un grand État, à l’apogée de sa puissance au XVI siècle, prospère, célébré par Érasme et les humanistes pour son modèle de tolérance et de liberté religieuse. C’était un pays multi-ethnique comprenant des Polonais, des Lituaniens, des Biélorusses, des Russes, des Cosaques, des Lettons, des Allemands des Arméniens, des Italiens, et multi-confessionnel avec des catholiques, des orthodoxes, des juifs, des protestants (voir lettre 59-3), des calvinistes (voir lettre 59-3), des ariens et des musulmans (rappel : les ariens sont des chrétiens qui pensent que Jésus n’est pas Dieu, ils ne croient pas à la Trinité, ils pensent que Jésus est un simple prophète). Dans cet ensemble chaque groupe, chaque « nation » gérait ses affaires elle-même, préservait son identité, et parlait même sa propre langue, pour les Juifs, le yiddish. Les Juifs étaient répartis en communautés locales administrées par une direction, le kahal, un syndic d’une vingtaine de dirigeants élus, des laïcs en majorité. Le kahal nommait le grand rabbin, le président du tribunal, les juges, les officiants, ainsi que les shtadlan intercesseurs chargés de plaider la cause des membres de la communauté auprès des administrations locales de l’État. Le kahal avait aussi pour fonction de lever les impôts dus par les Juifs auprès des pouvoirs publics. La loi en vigueur était la halakha. Un Conseil central dit Conseil central des Quatre Pays regroupait l’ensemble des kehalim (pluriel de kahal). Les quatre pays étaient la Pologne, la Lituanie, la partie russe de l’État et la Volhynie (nord-ouest de l’Ukraine actuelle). Ce conseil représentait l’ensemble de la « nation » juive. Il était composé d’une trentaine de membres élus (dont six rabbins) choisis parmi les notables (riches commerçants et gros fermiers). Il se réunissait deux fois l’an et traitait tous les grands sujets : lois, rapports sociaux, discipline, répression des fraudes, instruction des enfants, gestion des yeshivot. Il gérait également les relations entre la « nation » d’un côté et les pouvoirs publics et la société non juive de l’autre. Comme les Juifs constituaient la source principale de financement de l’État les souverains s’appuyaient sur ce Conseil pour la collecte de l’impôt, l’organisation juive étant nettement plus efficace que l’organisation étatique de perception de l’impôt. Vers la fin du XVI siècle, en butte à l’hostilité croissante des corporations de métiers et à la bourgeoisie urbaine qui leur reprochaient un comportement commercial hyperactif, en butte aussi aux menées des Jésuites qui étaient devenus les conseils de Sigismond III Vasa (1586-1632) le successeur de Bathory ( voir lettre 14 sur la Russie, le Temps des troubles, 4) le désordre final) lesquels Jésuites, catholiques militants (voir lettre 59-4 ) entretenaient un certain antijudaïsme dans les villes, les Juifs se transplantèrent en grand nombre dans les vastes latifundia (propriétés agricoles de grande superficie) nobiliaires dont ils devinrent les régisseurs. Les nobles se déchargèrent ainsi de la gestion de leurs terres pendant qu’ils s’adonnaient à leurs loisirs ou à leurs guerres. Notons que ce système quasi-féodal (les nobles dirigeaient en fait l’État, tandis que le souverain ne disposait que d’une autorité réduite sur eux) peu centralisé, allait affaiblir plus tard la Pologne-Lituanie dans ses rapports avec des États voisins beaucoup mieux structurés. 9) Les Juifs en Russie En 1471 à Novgorod, province encore indépendante du pouvoir moscovite, une hérésie religieuse prit forme et se répandit. Novgorod était à l’époque en rapports commerciaux étroits avec l’Europe occidentale et ouverte aux influences humanistes qui tendaient à réformer le christianisme (voir lettre 59-2). Cette hérésie fut appelée hérésie des Judaïsants car elle aurait été lancée par un marchand Juif, Zakhar. Nul ne put confirmer que ce fut bien un Juif qui lança cette hérésie mais cette hypothèse fut finalement retenue par les Russes. Cette hérésie consistait en ceci : rejet de la vie monastique et de la hiérarchie ecclésiastique, refus de se prosterner devant les icônes, négation de la Trinité et du caractère divin de Jésus. Ivan III (1462-1505) qui régnait à l’époque sur la Moscovie ne s’opposa pas à cette hérésie si bien qu’elle se développa à Moscou. Les autorités orthodoxes s’y opposèrent alors en la personne de Joseph de Volok (1439-1515) dont nous avons parlé dans la lettre 12 sur la Russie, première partie : l’œuvre d’Ivan III, 2) la troisième Rome. Un moine s’opposa à Volok : Nil de la Sora (1433-1508). Ce dernier alla dans le sens de l’hérésie estimant que les monastères avaient pris trop d’importance, qu’ils s’étaient trop attachés aux biens matériels ce qui corrompait leur spiritualité. Il voulait que les moines fassent vœu de pauvreté et se séparent de leurs biens. Cela ne déplaisait pas à Ivan III qui espérait ainsi mettre la main sur les terres des monastères. Mais Volok qui, lui, défendait le pouvoir foncier des monastères (ils géraient le tiers du territoire russe) parvint à rallier derrière lui l’Église orthodoxe et le Tsar. L’hérésie fut stoppée, ses tenants furent persécutés et exécutés. Du coup une certaine suspicion retomba sur les Juifs en général. Ceux-ci furent désormais tenus à l’écart du territoire russe. Ivan le terrible et ses successeurs reconduisirent cette interdiction de séjour. Je t’embrasse, Je t’aime
-
Lettre 59-11-3 13 novembre 2019, Samuel, XVI siècle La saga des Juifs 6) Les Juifs aux Pays-Bas Après la mise en place de l’Inquisition au Portugal en 1536 des marranes partirent pour Anvers devenu un entrepôt du trafic maritime entre la péninsule Ibérique et les Indes occidentales et orientales. Les frères Francisco et Diogo Mendes s’y rendirent entraînant avec eux des centaines de marranes dont ils organisèrent l’évasion. Les 17 Provinces des Pays-Bas alors sous domination espagnole se révoltèrent contre Philippe II en 1576 (lettre 59-5). Mais les Provinces ne s’entendirent pas entre elles et leur opposition tourna en guerre de religion (catholiques contre calvinistes). Cette guerre insécurisa les Juifs d’Anvers qui partirent progressivement de la ville portuaire pour rejoindre Hambourg puis Amsterdam. En 1581 les dix Provinces du Nord proclamèrent leur indépendance sous le nom de République des Provinces-Unies. Leur capitale, Amsterdam, s’engagea à respecter la liberté d’opinion de ses habitants ce qui provoqua un afflux d’étrangers. Une communauté juive s’y implanta entre 1595 et 1600. Elle prit un essor important au XVII siècle. 7) Les Juifs en Italie Certains marranes, toujours après l’établissement de l’Inquisition au Portugal choisirent d’atteindre les Balkans et la Turquie en passant par l’Italie. Certains voulurent s’y établir mais l’atmosphère s’alourdit considérablement lorsque la Contre-Réforme prit son essor (lettre 59-4). Dès 1541 les Juifs furent expulsés de l’Italie méridionale alors sous domination espagnole. En 1553 le pape Jules III (pontificat :1550-1555) ordonna que le Talmud soit brûlé à Rome et partout ailleurs en Italie. En 1555 Paul IV ( pontificat : 1555-1559) ordonna la ghettoïsation des juifs romains. Il les força à vivre reclus dans une rue unique fermée la nuit, à ne plus posséder de biens immobiliers et à réduire le nombre de synagogues. Obligés de porter un chapeau jaune pour les hommes et un voile jaune pour les femmes, il leur fut interdit de travailler les jours de fêtes chrétiennes et de vendre tout produit alimentaire à des chrétiens. Ces dispositions furent étendues à la plupart des villes italiennes. En 1556 Ancône condamna au bûcher des marranes. En 1569 Pie V (1566-1572) expulsa les Juifs des États pontificaux à l’exception des communautés de Rome et d’Ancône. Mais il autorisa l’impression des livres hébraïques à condition qu’ils ne contiennent pas de références blessantes à l’égard de la foi chrétienne ; par prudence les communautés juives d’Italie imposèrent d’elles-mêmes la censure sur leurs livres. La création des monts de piété permit aux Italiens de se passer des prêteurs juifs. Pourtant en 1533 le duc de Milan demanda au Pape l’autorisation d’accueillir à nouveau des Juifs sur ses terres pour faire concurrence aux chrétiens, qui, ayant désormais le monopole de prêteurs, s’étaient mis à pratiquer des taux usuraires excessifs. Mais Philippe II d’Espagne ordonna en 1597 l’expulsion des Juifs du duché de Milan. Cet appel aux Juifs fut aussi lancé dans les ports italiens de l’Adriatique afin de dynamiser le commerce avec la Turquie et les Balkans. Le cas de Venise à cet égard est intéressant. La ville envisagea plusieurs fois d’expulser les Juifs mais le projet soumis au sénat vénitien par le marrane Daniel Rodriga, préconisant l’ouverture d’un port franc à Split (aujourd’hui en Croatie), en Dalmatie, face à Venise, permit de sauver le commerce de la ville et convainquit les autorités de garder leurs marranes. En 1589 une charte autorisa les « nouveaux chrétiens » appelés là-bas ponentini (occidentaux) à habiter librement avec leurs familles dans la ville et à y pratiquer leur religion d’origine. Ils furent toutefois tenus de vivre dans le ghetto nuovissimo et de porter un chapeau jaune. Les marranes revinrent ouvertement au judaïsme et fondèrent leur propre communauté appelée Talmud Torah. En l’espace de quelques années ils acquirent une place prépondérante dans la vie économique de la cité concentrant entre leurs mains la majeure partie du commerce italien avec Salonique, Constantinople et la mer Noire. Ils construisirent leur synagogue, la très belle Scuola Spagnola, ou Ponentina édifiée en 1584 (puis agrandie en 1635). En 1593 à l’invitation de Ferdinand Ier de Toscane des marranes portugais fondèrent la communauté juive de Livourne ( la côte de la mer Tyrrhénienne) qui deviendra plus tard la première communauté d’Italie. Grâce à eux la cité portuaire bénéficia d’un essor remarquable. Je suis de près ton approche du cheval du Don. Je sais que sauras l’apprivoiser et bientôt, lui et toi, ne formerez plus qu’un lorsque vous courrez ensemble. Tels les Mongols ou les Cosaques mais aussi tels les Arabes à la conquête de la Méditerranée tu connaîtras ainsi le sentiment de liberté que connurent jadis les nomades. Sentiment incomparable, inconnu des sédentaires. Tu ajouteras ainsi à ta connaissance du monde une expérience inestimable. Je t’embrasse, Je t’aime
-
Lettre 59-11-2 10 novembre 2019, Samuel, XVI siècle La saga des Juifs 3) les Juifs en France Nous avons vu (lettre 57-Chapitre 1) que les Juifs furent définitivement expulsés de France en 1394 (le 17 septembre sur décision de Charles VI). Lorsque la Provence fut rattachée au royaume de France en 1481 ils furent d’abord expulsés d’Arles en 1493 puis de Tarascon en 1496. Enfin en 1500-1501 ils furent expulsés de toute la Provence. Il y eut tout de même une exception. Louis XI, en 1472, permit à des marranes ibériques de s’établir à Bordeaux dévasté par la guerre de Cent ans afin de contribuer au redressement de la ville. Ils furent ensuite rejoints par de «nouveaux chrétiens» portugais après l’établissement de l’Inquisition au Portugal. A partir de la moitié du XVI siècle l’attitude des autorités françaises vis-à-vis des Juifs changea. Ainsi en août 1550 les lettres patentes de Henri II accordèrent aux « nouveaux chrétiens » portugais le droit de s’installer en France. Henri III renouvela ces lettres en1574 autorisant les conversos à exercer librement leurs « trafics » et toutes autres « manufactures ». Néanmoins les conversos étaient toujours officiellement convertis au catholicisme . Aussi par prudence ils continuèrent de faire baptiser leurs enfants, de célébrer leurs mariages à l’église et de faire bénir leurs enterrements par les curés (qui parfois étaient eux-mêmes des conversos). Nombre de ces conversos, comme en Espagne et en Italie, finirent par assumer leur identité chrétienne sans pour autant couper leurs liens avec leurs parents et amis revenus au judaïsme. Ce fut le cas de la mère de Montaigne Antoinette de Lopez. Les marranes (ou conversos ou « nouveaux chrétiens », tous ces mots sont synonymes) utilisèrent aussi la France comme escale provisoire avant leur installation définitive à Amsterdam, Anvers ou Hambourg. Ainsi ils s’installèrent dans plusieurs localités du sud-ouest : Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Labastide-Clarence, Peyrehorade, Bidache, Bayonne, ou des localités portuaires telles La Rochelle, Nantes, Le Havre, Rouen, Marseille mais aussi dans des villes telles Paris ou Toulouse. Parfois certains firent souche dans ces villes. Ainsi Élie de Montalto (1567-1616), médecin de la reine Marie de Médicis s’installa à Paris où il eut même la possibilité de revenir à la pratique officielle du judaïsme (il fut considéré comme le seul Juif autorisé de la cour royale). Alfred de Vigny dans sa " Maréchale d'Ancre " mit en scène son histoire sous le nom de Samuel Montalto. 4) Les Juifs en Angleterre Les Juifs étaient bannis d’Angleterre depuis 1290 et les rares marranes qui s’y installèrent au début du XVI siècle ne manifestèrent pas leur identité juive. Henri VIII s’appuya sur des érudits juifs pour justifier son divorce d’avec Catherine d’Aragon et son mariage avec Anne Boleyn (voir lettre 29-3). Une centaine de marranes s’installèrent à la cour d’Élisabeth I. Hector Nunes médecin et commerçant qui informa la cour d’Angleterre de la concentration à Lisbonne de l’invincible armada (voir lettre 59-5) sut bien s’intégrer. En revanche Roderigo Lopes médecin de la reine (c’était un marrane portugais) parvint à déchaîner contre lui une violente campagne anti-juive à cause de ses sympathies espagnoles (il est vrai que les relations entre l’Angleterre et l’Espagne étaient à l’époque plutôt houleuses (lettre 59-5)). C’est lui qui aurait inspiré à Shakespeare le personnage de Shylock dans le Marchand de Venise. Il finit par être accusé de complot contre la reine en 1594 avant d’être exécuté. Du coup la petite communauté fut dispersée et ses membres allèrent se réfugier aux Pays-Bas déguisés en sujets catholiques romains de la péninsule ibérique. Il faudra attendre le siècle prochain pour que les Juifs puissent revenir en Angleterre. 5) les Juifs dans le Saint-Empire romain germanique Nous avons vu qu’en Allemagne après la fin de la période de la Peste noire quantité de villes allemandes procédèrent à des expulsions des Juifs (lettre 58-3). Il en fut de même en Suisse. Ces expulsions se poursuivirent tout le long du XV siècle et au début du XVI siècle. Beaucoup de Juifs se réfugièrent dans de petites localités rurales. Quelques villes gardèrent leurs communautés mais elles les cantonnèrent dans des ghettos notamment à Francfort-sur-le-Main et à Worms. En revanche en Bohème et en Moravie (république tchèque) les communautés juives se maintinrent. Le ghetto de Prague doubla sa population entre 1520 et 1540 atteignant 6000 âmes. L’apparition de Luther (lettre 59-3) laissa envisager un retour en grâce des Juifs. Ainsi en 1523 il publia un pamphlet « Jésus est né Juif » dans lequel il s’attaqua à tous ceux (surtout les papistes) qui persécutaient les Juifs. Il écrit : « si j’avais été Juif j’aurais préféré me faire porc plutôt que chrétien. Les Juifs sont les parents de sang...de Notre Seigneur [Jésus]. Ils appartiennent à Jésus-Christ bien plus que nous. Je prie donc mes chers papistes (ceux qui obéissent au pape et contre lesquels Luther va développer sa nouvelle foi) de me traiter de Juif » Changement de ton dès 1526 quand Luther se rendit compte qu’il ne parviendrait pas à convertir les Juifs à sa réforme religieuse. Il écrivit « le Christ n’a pas d’ennemis plus venimeux que les Juifs ». Du coup il voulut faire disparaître le judaïsme et mettre le feu aux synagogues. Après la victoire des protestants en Basse-Saxe, dans le duché de Brunswick, à Hanovre Luxembourg et à Berlin les Juifs furent expulsés en 1560 puis en 1573. Même comportement dans le duché de Silésie en 1589. Dans d’autres régions gagnées par les protestants (duché de Hesse notamment) ils ne furent pas expulsés mais ils furent soumis à l’interdiction d’édifier des synagogues et à l’interdiction d’étudier le Talmud. Ils durent aller à l’église écouter des prêches de conversion. Seules les communautés situées dans des villes dominées par les catholiques furent épargnées, elles furent même protégées. Après la signature en 1555 de la paix d’Augsbourg établissant le principe cujus regio, eius religio, tel prince telle religion, chaque région devant prendre la religion de son prince, les Juifs se retrouvèrent soumis à l’arbitraire du régnant. Un homme remarquable, le rabbin alsacien Joselmann de Rosheim, né vers 1480, parvint à défendre sa communauté en réussissant par la persuasion à obtenir des arbitrages favorables près des Empereurs. En 1507 lors de l'expulsion des Juifs de Colmar, il fit appel avec succès à Maximilien qui annula cette décision. Il obtint le même succès pour empêcher l’expulsion des Juifs d’Augsbourg, de Nassau, de Worms, de Francfort. Sa communauté le choisit pour chef et guide. Devenant progressivement connu comme défenseur des communautés juives pour les matières religieuses et légales, Joselmann acquit le statut de chef de tous les Juifs de l'Empire allemand. Peu après l'ascension sur le trône de l'empereur Charles Quint, à Aix la Chapelle, en 1520, il obtint une lettre de protection (charte) de l'Empereur pour tous les Juifs d'Allemagne. A plusieurs reprises, il intercéda avec succès auprès du roi Ferdinand, frère de l'Empereur, en faveur des Juifs de Bohème et de Moravie. Une action importante de Joselmann fut l'établissement de règles pour les prêts effectués par ses coreligionnaires : il leur fut désormais interdit d'exiger un taux d’intérêt trop élevé. Il défendit les Juifs contre les attaques de Luther. Ainsi il réfuta les affirmations du prédicateur dans une pétition volumineuse qu'il fit parvenir au bourgmestre de Strasbourg, et ce dernier, à la suite, interdit une nouvelle réédition des écrits haineux de Luther. Autant qu’il put le faire Joselmann défendit sa communauté obtenant dans les cas les plus cruciaux l’aide impériale. Il mourut en 1554. Si aucun successeur n’atteignit son envergure il faut noter l’action du rabbin Juda Löew Bezalel plus connu sous le nom de Maharal de Prague (1525-1609). Talmudiste, moraliste, cabaliste, mathématicien, astronome et alchimiste il devint le chef de la communauté juive de Bohème-Moravie. Bien que resté fidèle à la Torah il eut recours à la science profane dans son enseignement et il fit appel à la philosophie occidentale dans son interprétation de la Aggadah (lettre 44). Son nom est lié au golem de Prague, la créature d’argile à laquelle il avait insufflé la vie à l’aide d’inscriptions cabalistiques. Selon la légende le Maharal aurait décidé de le détruire après qu’un vendredi soir il eut échappé à son contrôle (voir correspondance 1). Je t’embrasse, Je t’aime
-
Lettre 59-11-1 8 novembre 2019, Samuel, XVI siècle La saga des Juifs 1) Introduction Lisons ce qu’écrit Michel Abitbol dans son livre « Histoire des Juifs », page 271 : « A l’heure de l’absolutisme et du mercantilisme triomphants, tous séfarades et ashkénazes prennent une part active dans les nouveaux circuits d’échanges qui relient l’Europe à l’Afrique, à l’Asie et aux Amériques, et qui enjambent l’Atlantique, la mer du Nord, la Baltique, la Méditerranée, l’Adriatique, le golfe Persique et l’océan Indien. Au hasard des migrations et des expulsions, leurs chemins se croisent à Istanbul, Salonique, Smyrne, Alep, Safed et Jérusalem ou à Venise, Pise, Livourne, Amsterdam, Hambourg, Londres et même à Cracovie, Vienne et Budapest. S’enflammant pour les mêmes utopies messianiques et s’efforçant de mettre en harmonie leurs codes rituels ils accourent les uns au secours des autres pour sauver de la captivité leurs coreligionnaires faits prisonniers ou vendus en esclavage loin de leur pays. Ils veillent ensemble au bien-être des Juifs de Terre Sainte et à l’entretien des yeshivot de Jérusalem, Hébron, Safed et Tibériade. Ne cessant d’échanger entre eux hommes, livres et idées, ils ont le sentiment de partager la même histoire et le même vécu.» 2) Les Juifs dans la péninsule ibérique Nous avons vu, lettre 58-2, qu’au cours de l’été 1492 après l’édit d’expulsion pris par les Rois catholiques d’Espagne le 1 mai 1492, entre 50 000 à 80 000 juifs partirent d’Espagne pour gagner le Portugal. Ils y furent d’abord bien accueillis mais le roi du Portugal arrivé au pouvoir en octobre 1495, Manuel Ier, du fait de la clause de son contrat de mariage avec Isabelle d’Aragon, l’héritière du trône d’Espagne, qui stipulait que le pays de son époux ne devait être peuplé que de catholiques, publia un arrêté d’expulsion en 1496. Puis se ravisant, désireux d’intégrer une population d’immigrés juifs dont les savoirs pouvaient dynamiser l’administration de son pays, en 1497 il commua cet édit d’expulsion en conversion forcée et interdit dans la foulée aux Juifs de quitter le pays (fermeture des ports). Il ordonna le baptême forcé des enfants âgés de moins de 14 ans puis il fit baptisé les moins de 25 ans et enfin il baptisa la communauté toute entière. Afin de permettre aux nouveaux chrétiens (cristaos novos) de s’habituer progressivement à leur nouvelle condition il leur accorda une période de transition de 20 ans pendant laquelle il les laissait libres de leurs pratiques religieuses. Ce qui produisit finalement de nouveaux conversos, ou marranes, les Juifs continuant de pratiquer le judaïsme dans leur vie privée. La population vit d’un mauvais œil arriver ces exilés. Lors d’une épidémie de peste, en 1506, ces derniers furent pris comme boucs émissaires : deux milliers d’entre eux furent massacrés. Manuel Ier réagit en donnant sa protection aux Juifs en 1507. Mais au fur et à mesure que ces derniers prenaient des places de choix dans la société (banques, commerce extérieur, marchés du sucre, des esclaves et des épices) les anciens chrétiens (les Portugais) s’en prirent à eux. Quand Jean III succéda à son père Manuel en 1521 il demanda au pape Paul III l’établissement d’une Inquisition au Portugal. Le pape accéda à cette demande en 1536. Il s’agissait de traquer les Juifs qui, bien que convertis, continuaient de pratiquer leur culte. Les «nouveaux chrétiens» quittèrent alors par milliers le Portugal pour chercher refuge ailleurs. Beaucoup émigrèrent dans le sud-ouest de la France, dans les Flandres et en Italie, ou encore dans l’empire ottoman ou dans les communautés du sud de la Méditerranée. D’autres allèrent s’établir dans l’archipel de Madère ainsi qu’ à Sao Tomé puis au Brésil où ils développèrent la culture de la canne à sucre grâce à des techniques apprises à Sao Tomé et à Madère. Mais d’autres choisirent de retourner en Espagne. En principe plus un seul Juif n’habitait en Espagne depuis l’expulsion de 1492 les derniers conversos s’étant en principe totalement assimilés. Mais l’afflux massif des « cristaos novos » ranima la fibre juive chez ces assimilés tout en ranimant aussi l’Inquisition espagnole et les débats sur la « pureté de sang » (la limpezia de sangre). En juillet 1547 l’Église catholique de Tolède promulgua un statut de pureté de sang en interdisant les mariages entres vieux chrétiens (les Espagnols) et les nouveaux venus du Portugal, les « nouveaux chrétiens ». Certaines professions leur furent en outre interdites (médecine, chirurgie, pharmacie). Certaines provinces leur interdirent leurs territoires ou ils furent confinés dans des quartiers spéciaux. Après l’union du Portugal et de l’Espagne réalisée par Philippe II en 1580 (voir lettre 59-5) nombre de marranes (nouveaux chrétiens) partirent au Brésil, au Mexique, à Cuba, au Pérou. D’autres formèrent une nouvelle communauté à Amsterdam. C’est ainsi qu’en expulsant les Juifs et les marranes de la péninsule ibérique les gouvernants et l’Inquisition contribuèrent à l’expansion du judaïsme dans le monde entier et à son renforcement dans les communautés moribondes du sud de la Méditerranée. Ils permirent aussi le retour des Juifs dans les pays européens comme la France et l’Angleterre. Le sort des marranes durant les siècles suivants (jusqu’au XVIII siècle) resta incertain dans la péninsule. Les souverains, lorsque la situation économique se dégradait, se rendant compte de l’apport précieux d’une communauté au dynamisme commercial incomparable, cherchaient à les garder ou à les rapatrier. Mais sans cesse, d’une manière erratique, l’Inquisition intervenait pour les persécuter. J’espère que la rentrée s’est bien passée, Je t’embrasse, Je t’aime