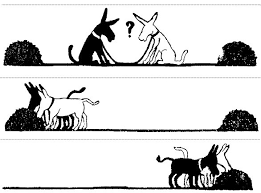-
Compteur de contenus
670 -
Inscription
-
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Blogs
Calendrier
Vidéos
Quiz
Movies
Tout ce qui a été posté par zeugma
-
Zenalpha vous dites : "L'idée de la séparation du "comment" pour la science et du "pourquoi" pour la religion est "traditionnelle" mais fausse. " vous êtes terriblement prévisible, tous les scientifiques en viennent à bloquer comme vous le faites le comment avec la raison et le pourquoi avec le sens spirituel de l'humain, t'en que l'on en sera là pas d'avance dans notre débat... de plus vous vous enfoncer dans une justification à postériori de la science qui ne fait que révéler l'optique dominante de la recherche scientifique... mais pas grave... par contre si vous voulez ouvrir un débat de théologie naturelle sur la question de la présence divine, pourquoi pas... ce que je cherche, c'est à redonner à la pensé humaine son autonomie naturelle et pour cela il est nécessaire de la distinguer de la pensée scientifique...pas de la séparer, juste de la distinguer...
-
sponzy, vous dites: "j'essaye de ne rien sous entendre. Par principe, j'estime que la clarté est un plus dans un débat. L'entretien d'un flou est synonyme, pour moi, de volonté de fuir le débat." c'est à cette forme de clarté pourtant que nous aurions tous à contribuer si nous cherchions au delà de la forme critique une connaissance commune, mais vous gardez ce spasme de la critique quoi qu'il vous coûte et en l'occurrence la compréhension de la phrase : "pourtant elle est en droit de juger de ce qui est valide dans l'effectuation des modes d'implications de ces découvertes pour la conscience humaine..." Je ne sais pas ce qu'est l'effectuation des modes d'implications de ces découvertes. Qu'est ce que l'effectuation ? qu'est ce que vous appelez mode d'implication ? cela veut simplement dire que même si la science, comme méthodologie est limitée, elle valide ses résultats non seulement par une cohérence interne, mais pas l'assentiment de la conscience humaine via ses applications technologiques, ce que j'appelle la fascination des sciences... puis vous dites : "je vois beaucoup de blessures, mais peu de relations avec la science. C'est pour cela que je vous pose la question. Vous faites une non réponse." 1/si pour vous le développement de la marchandisation des savoirs scientifiques dans des projets impliquant l'irréversibilité d'une destruction massive de la nature n'est pas une de ses blessures...alors d'accord vous ne voyez pas... 2/si pour vous l'enseignement unilatérale des sciences modernes ne contient pas une forme de totalitarisme et donc une blessure...alors d'accord vous ne voyez pas... 3/si pour vous le mode de coopération citoyenne n'est pas conditionnée par une forme de scientisme béat en tous domaines, économique, politique, industriel, éducatif, artistique même parfois n'est pas une blessure..alors d'accord vous ne voyez pas... 4/si pour vous l'espérance de vie et la reproduction devient par des médecine scientifique de pointe une des formes d'injustice géo-localisé ou socio-discriminante, n'est pas une blessure...alors d'accord vous ne voyez pas... 5/si pour vous la qualité de l'eau ou de l'air devient une des causes de maladie et de mal être telle que les autorités scientifiques qui ont avalisé pendant des décennies certains polluant n'est pas une blessure...alors d'accord vous ne voyez pas... et j'en passe beaucoup... mais je vous le demande Sponzy Est-ce un aveuglement volontaire ou une cécité de circonstance, dû à votre sens critique trop lumineux pour voir le réel moderne tel qu'il est ? bien à vous ...
-
avant de vous répondre, je me permet de reprendre une faute de frape de votre texte : "Je ne sais pas ce qu'est la transcendance de la science ni une acné symptomatique... " je n'ai pas écris acné mais acmé ce qui voulais dire dans la phrase : "la transcendance de la science dans sa recherche, sa théorisation, son expérimentation, sa technicité devient alors la mesure du destin de l'humanité comme son acmé symptomatique..." à savoir son "sommet", intensité maximale, symptomatique... bon voyons maintenant la première de vos affirmations...je vous cite: "Il ne s'agit pas d'un "redimensionnement quantitatif" car on ne redimensionne surtout rien..., à l'inverse, il s'agit de préserver précisément les relations qui existent dans la nature... " vous les préserver en les conceptualisant mathématiquement, ce qui revient à quantifier... et puis vous dites :"On appelle cette relation un isomorphisme." je préfère penser le réel avec l'analogie et l'induction car elle permettent toutes deux de ne pas perdre de vue la cause principale qui maintient ma réflexion dans une recherche naturelle, à savoir la cause finale...ce que l'isomorphisme ne peut faire... et enfin vous dites : "Non... votre vision grand mécano des mathématiques réduite au comment et réduite au formalisme ne tient pas la route et est un peu naïve." si vous ne voyez pas que l'outre-passement de l'intelligibilité scientifique face à l'intelligibilité naturelle est une forme d'hyper-logicisme, et qu'elle conduit à présenter le réel comme une suite de comment sans pourquoi, alors nous n'allons pas pourvoir coopérer... en concluant vous dites : "Si vous ne constatez aucun mystère dans les lois naturelles vous êtes bien le seul..." ai-je dis cela ? "C'est justement parce que les sciences séparent les inconnues au lieu de les ranger dans un énorme sac du "Dieu des lacunes" qui serait la cause de tout ce qu'on ne connaît pas que je peux constater qu'on ne sait pas tout et loin de là..." oui les sciences séparent vous l'admettez, mais elle gardent séparées des réalités qui n'ont de sens que si elles sont connues dans une unité, de l'intelligence et de la volonté, du vrai et du bien, sans quoi comme je vous l'ai déjà dit dans une autre discussion, elles provoquent une mutilation de la personne humaine... "La science, c'est acter de qu'on connait, les limites de ce qu'on connait et aussi ce qu'on ne connait pas..." en effet la science acte une connaissance jusqu'à une efficience telle qu'elle ne sait plus le pourquoi de sa question de départ... était-ce pour répondre à une question circonstanciée, ou à partir d'une interrogation sur l'existence d'un problème humain ? ce que j'essaye de vous donner dans tout mes messages, c'est que la cohérence interne d'une théorisation ne suffit pas à en valider l'universalité humaine, sauf en ramenant l'humanité au destin que la science théorique et pratique permet... pour illustrer cette dernière affirmation de ma part je vous cite de nouveau : "La vérité mathématique va au dela du pur formalisme. Les concepts mathematiques semblent posséder une realité profonde qui vont au dela de tel ou tel mathematicien. C'est comme si la pensée humaine était guidée vers une realité extérieure, une verité qui a sa realité propre et qui n'est que partiellement révélée à chacun d'entre nous" oui cette réalité extérieure c'est la cohésion naturelle de la matière et des énergies qui la structure et qui l'amine jusque dans les phénomènes vitaux, et de là à dire que cette vérité partiellement révélée à chaque scientifique est moteur d'un savoir théorique et pratique incontournable, il n'y a qu'un pas, que je ne franchis pas contrairement à vous... P.S je ne vous tiendrais pas rigueur si vous ne vouliez plus perdre votre temps à me répondre, je sais que nos approches du réel sont différentes, contraires même, mais pas opposées, c'est ce qui je fais entretenir encore un temps ce dialogue avec vous et Sponzy...pour autant, ne percevant pas une possible coopération, je ne pourrais continuer cet échange qui ne m'apprend rien sur l'intelligibilité scientifique, et qui pourtant mériterait d'être approfondie... bien à vous...
-
Sponzy, je n'oublie pas notre discussion première et ce qui en à provoqué sa rupture, et si je vous réponds maintenant c'est avant tout dans le cadre d'un nouvel échange d'opinion... ainsi vous dites : "Je suis 100% d'accord avec vous. Je crois qu'un scientifique qui dirait tout connaitre définitivement ne serait pas crédible." mais je pense que vous ajouteriez : "pourtant elle est en droit de juger de ce qui est valide dans l'effectuation des modes d'implications de ces découvertes pour la conscience humaine..." ce que je réfute pour ma part, car comme je l'ai dis plus haut, l'intelligibilité scientifique sépare le comment et le pourquoi par le fait même de son abstraction... puis vous dites : "Pouvez vous détailler en quoi la science inflige des blessures ? " si vous aviez cité toute la phrase, vous auriez surement mieux évaluez par vous même ce que je sous-entendais... car j'ai dis : " l'irréversibilité aura été la dernière blessure de la science sur le corps/destin de l'humanité... " demandez vous qu'elles sont les blessures du destin de l'humanité que l'on vois aujourd'hui et vous aurez la réponse "détaillée" à votre question... enfin vous demandez : "Vous adressez vous à Zenalpha en ta" oui je m'adressais en particulier à Zenalpha, car je ne désire pas m'opposer aux scientifiques, bien qu'ils aient une intelligibilité contraire à la mienne, mais juste rechercher avec eux une solution théorique et pratique à la situation de l'intelligence contemporaine face au monde en devenir...encore cette distinction entre contraire et opposé me direz-vous, oui, mais j'y vois une des portes de sortie de cette errance que j'évoquais plus haut...
-
bonjours à tous et bonne année, si cette invocation à encore court ici ... je reprendrais juste les trois phrases de Zenalpha pour reconditionner le thème de départ en suivant ses glissement sémantiques, conceptuels et transcendantaux et je garderais sa dernière phrase pour bien marquer le point d'errance qui se profil à suivre volontairement les trois glissements précédents... glissement sémantique: La "réalité objective" semble en tout cas différente de nos "réalités humaines". je pense que tout le monde y compris l'auteur, auront perçu le glissement sémantique du mot "réalité" par le mode d'abstraction propre au raisonnement scientifique... car l'objectivité issue de cette abstraction est un redimensionnement quantitatif du réel, et de fait les scientifiques (Descartes inclus) préconisent une forme d'intelligibilité scientifique réduisant le réel sensibles à ce que les propositions et théorèmes lui permettent de prouver... les réalités humaines à la fin de ce glissement, deviennent "différentes" car l'a priori scientifique est une symbolisation qui ne peut admettre plusieurs forme de "réalité" puisqu'il part et reste dans un comment et ne peut inclure un pourquoi... hors la sémantique constitutive de l'intelligence évolutive avait avant la théorisation mathématique, une double fonction, celle de poser un comment et de se diriger vers un pourquoi...cela n'est plus possible par l'intelligibilité scientifique qui ne peut en t'en que telle ouvrir à un pourquoi, qui serait une forme conclusive antinomique avec sa dynamique fondamentale... glissement conceptuel: Et la science est suffisamment source d'étonnement pour prendre beaucoup de recul sur le mot réalité parce que l'objectivité de quelques une de ses équations est loin de notre intuition commune... là encore le glissement est net, au plan conceptuel, dire que l'abstraction propre à la science est source d'étonnement par sa lecture objective du réel, devient pour l'auteur un garde fou à l'intuition commune, comme si l'esprit scientifique était le sommet de toutes les intelligibilités du réel, et se devait donc d'organiser le sens et la pratique du jugement humain face à ce réel... par les techniques issues de ces recherches scientifiques, nous voyons ce par quoi ce glissement intervient dans l'appréhension des utilisateurs de ces techniques, la réalité médiatisé par le champs d'applications est une nouvelle forme d'objectivité au delà de ses liens corporels avec le réel, qui eux sont les seuls à mesurer les nuances de la présence réel de l'individu au monde... car si vous supprimez l'acte premier conceptuel de l'intelligence, à savoir le jugement d'existence issu de l'appréhension sensible du corps, vous ouvrez la porte à tout les possibles adjuvants technicistes, voir à un trans-humanisme qui n'aura de limite que dans la consommation de son propre substrat, à savoir la nature... je laisse à chacun le temps de mesurer de quel type d'enfermement il s'agit là... glissement transcendantal : En revanche, ils sont suffisamment humain pour être le fruit de notre condition humaine... "la preuve par trois" s'applique ici de façon magistral, puisqu'après avoir glissé sémantiquement, puis conceptuellement, le glissement de la transcendance du vrai et du bien sont ramener à "une suffisance" c'est à dire à ce que la recherche scientifique en t'en qu'elle est institutionnalisé par l'humain est une conséquence de la condition humaine...si on accepte ce raisonnement, on pourrait alors en dire autant de la guerre ou de la pollution... Est-ce-à dire que l'humanisation est source de la recherche scientifique ? il semble bien pour l'auteur, que la recherche scientifique est bien la continuité et même l'inévitable nécessité de notre condition humaine, puisqu'il y voit un lien de cause à effet suffisant... la transcendance de la science dans sa recherche, sa théorisation, son expérimentation, sa technicité devient alors la mesure du destin de l'humanité comme son acmé symptomatique... je laisse une nouvelle fois l'auteur et les lecteurs prendre la mesure de cette "vision" scientifique du réel, mais je ne doute pas que pour l'auteur au moins, une réplique viendra et cherchera à invalider ces trois glissements, car rien n'est plus stimulant que la controverses pour ceux qui n'ont plus que cette dynamique réflexive... pour conclure il dit : Je me réjouis de notre qualité d'homme et d'une dose de mystère sans laquelle je me demande quelle beauté nous donnerions aux choses éphémères de la vie. cette phrase marquant bien la dichotomie que l'esprit scientifique insinue dans la condition humaine, d'un coté la rationalisation scientifique, de l'autre le flou artistique du mystère, marquant le point d'errance qui est le lot de nos sociétés technoscientifiques, ne sachant plus comment imaginer l'avenir autrement que de continuer jusqu'à ce que mort s'en suive le glissement vers la raison du plus fort... oubliant de fait l'intelligence contemplative qui elle garde unis savoir et beauté -je conclurais que la seule vérité éphémère est celle d'une science qui ne restitue pas la totalité de la nature de l'humain et de la nature tout court, et qu'à la vitesse de dégradation de la vie sur terre, l'irréversibilité aura été la dernière blessure de la science sur le corps/destin de l'humanité... P.S j'ai été très modéré dans ce commentaire, car je sais que votre lecture est conditionnée par un humanisme bon teint et se serait offusqué si j'avais désigné plus directement les responsabilités de cette errance scientifique...
-
heu...non je voulais juste m'assurer de faire un partage des eaux (référence sans inférence) entre ce qui est dit et ce qui est perçu...le beau n'est pas un transcendantal mais participe à l'harmonisation du tout...c'est pourquoi il a cours dans le monnayage poétique... et par la même occasion je rend grâce à Zenalpha de ne pas avoir osé des rimes sur la : Tension artérielle pour corps caverneux et + selon affinités dont les enfants ne pouvaient être que conceptuels. il y a des mots qui se pensent sans se dire et qui, si ils se disent, méritent qu'on les pansent... comme des maux...
-
je viens de sélectionner quelques phrases de votre message en rouge dans mon post, et vu leurs convergences je ne pense pas que vous vouliez vraiment entrer dans une analyse du fait scientifique, j'avais quand même bien souligné que ce mode d'abstraction est le propre une forme d'intelligibilité du réel, mais n'est pas la seule et vous dites : Nous ne savons pas si le "réel" est intelligible. si il ne l'est pas que touche la science dans son processus de conceptualisation théorique ? Le "réel" est inintelligible dans sa totalité sinon nous aurions la capacité de tout prévoir voire de tout orienter... je pense au contraire que le réel est intelligible dans sa totalité, mais pas de manière quantitative mais qualitative , par un acte singulier, un acte contemplatif... l'intelligibilité scientifique fait passer la quantité avant la qualité, ou ne distingue pas les deux mais sépare leurs relations naturelles, ce qui rend la "lecture" du réel parcellaire et coupée de la cohérence du Tout...c'est une première mutilation de l'intelligence humaine.....j'y reviendrais dans d'autres posts on en arrive à une conceptualisation du monde, voire à des découvertes ontologiques sur le monde et il n'est pas rare que nos systèmes formels aient prévu des réalités physique découvertes par la suite, conformément aux théories ce qui en montre la pertinence comme outil qui "touche le réel" en devenant parfois un treuil ontologique qui prédit des réalités physiques avant qu'on ne les ait même observées. mettre en perspective des lois ne vous fait pas atteindre le réel en ce qu'il est, juste à le décrire mathématiquement... la vraie question est de savoir si le réel est intelligible dans son organisation ou uniquement dans les rapports que vous provoquer par cette conceptualisation théorique... "les découvertes ontologiques" dont vous parlez sont assez loin de la connaissance humaine sensible en contact avec le réel, et sont donc de nouveaux objets mathématiques, si des observations ultérieurs en confirment l'existence, là ce seraient des découvertes ontologique, mais la mise en évidence de nouvelles relations ou de nouveaux plans ne se situ en science qu'au niveau de la forme pas au niveau de l'être...conceptualiser et modéliser le monde sous forme mathématique ne vous donne qu'une occurrence mathématique... dans ces théorisations, la forme de rationalisation est celle qui pose une complémentarité entre plusieurs lois et ne font que donner de manière univoque la retranscription mathématique du réel, une sorte de "comment " de plus en plus complexe, mais ne touche jamais le pourquoi... c'est d'ailleurs encore une des mutilations de l'intelligence humaine que j'aurais à développer plus tard... le plus terrible si je puis dire c'est que vous mettiez la théorisation sur le même plan pratiquement que le jugement d'existence, et "votre treuil ontologique" n'est qu'une conséquence complexe de votre abstraction logique : théorie-preuve-théorie nouvelle, cette suite binaire ne vous donne qu'une connaissance bidimensionnelle du réel... en posant le résultat de sa recherche, le scientifique opte pour une réorientation de sa conscience même sans le vouloir, vous me direz qu'il en va de même pour le philosophe ou le poète, c'est vrai, mais les vérités issues des sciences ne sont pas comme telles assimilables à la conscience humaine...j'y reviendrais dans d'autres posts... La science est ce qui rend intelligible pour l'homme une réalité dont nous ne percevons qu'une partie et qui fait écho à notre capacité de conceptualisation. je ne suis pas d'accord, la science dans son abstraction formelle, donne une transcription du réel dans une traduction inhérente à sa méthode et que laisse l'intelligence humaine de ceux qui l'utilise (cette abstraction) sans autre but que de poursuivre dans la même voie, pour cela je la dis captative de l'intelligence, par révélatrice du réel... il faudrait bien voir ce que seraient les "découvertes scientifiques" si elles n'étaient relégués en objets technologiques, qui eux influx réellement sur le quotidien des personnes qui use de l'intelligibilité scientifiques ou pas... le rayonnement de la science telle que vous la décrivez ne serait pas grand chose sans ses applications, mais je préfèrerais de loin savoir qu'il existe une vérité scientifique, si elle ne devenait pas technologiquement une menace sur le vivant... Par ailleurs, il est tout sauf un conditionnement mental... il est justement un conditionnement mental, puisque je parlais de la structure réflexive interne au chercheur scientifique qui pose une option positive sur la possibilité d'atteindre un résultat, une preuve de son expérimentation, c'est là que le conditionnement moral commence dans cette performation dont je parlais tout à l'heure... Quand on modélise la relation qui met en scène l'orbite de la lune autour de la terre, il n'y a aucun conditionnement mental qui ne vient perturber l'application des principes mis en évidence par la théorie... si vous ne percevez pas qu'il y a un "climat de recherche" quant vous réfléchissez scientifiquement, c'est que votre expérience a besoin comme vous dites ailleurs d'un "retour d'expérience" extérieur à la votre... (ce que je vous propose d'ailleurs) ce climat de recherche est bien une immersion dans la singularité de l'intelligence scientifique puisqu'il opère dans la nécessité de réussir une modification du jugement morale du chercheur, cela me réjouis peu de le dire, mais toutes les recherches qui sont faites dans un but de destructions et de soumission de la nature proviennent de cet isolement, de ce conditionnement mental du chercheur qui n'a plus en son intelligence la volonté de faire le bien, mais juste de bien faire... c'est encore une des mutilations que produit la science sur la conscience humaine... si la théorie conceptualisée ne rencontre pas la réalité par l'expérience, sa théorie est fausse... là sans doute je suis d'accord, mais si vous parlez de la réalité qui est mise à jour par l'expérience qui est elle même issue d'une recherche scientifique, alors c'est une dilution de la notion de vrai ! et qui n'est pas comme dans le principe homéopathique, la mémoire de l'eau, mais l'étagement de plus en plus théorique du contact de l'humain avec les réalités naturelles... et parce que je vous aime bien malgré nos désaccords, je conclurais en vous donnant une charade: mon premier est un outil ou un chiffre ou une conjonction de conditionnalité ? mon deuxième une tige à greffer ? mon troisième est un suffixe commun ? mon tout est la certitude d'une relativisation ? bonne fête de fin d'année... P.S je ne serais pas connecté à ce site pendant les fêtes...
-
oui je vous rejoins sur ce point, vu que je l'ai basse aussi, la vue...je compatie de tout cœur je reprendrais donc en vous disant que l'intelligibilité scientifique n'est pas une inintelligibilité du réel, ni en théorisant, ni en appliquant technologiquement ses "découvertes", mais un conditionnement mental, qu'il est nécessaire d'analyser comme telle... c'est à dire comme dynamique et comme structuration de l'actualisation opératif de l'humain dans la nature... la méthodologie scientifique à une irréductible tendance au performatif, et donc, dans l'abstraction propre à cette méthode, l'intelligence du scientifique recherche toujours une logique qui intègre: 1/ la preuve, 2/ la reproductibilité, et la cohérence avec le champs de délimitation de sa discipline...(bien qu'il y ai des voies transversales utilisées par certains scientifiques) ce que je voudrais faire ici, c'est mettre en lumière ce mode d'abstraction propre aux intelligences scientifiques et en suivre toutes les accoutumances et les conséquences sur la pensée humaine en générale... P.S nous reparlerons du Viennois une autre fois car là aussi ma position différe forcément de la votre...
-
nul part je n'ai parlé d'in-intelligibilité des sciences ? serait-ce que vous ayez lu intelligibilité et déduit sa forme négative par les inférences du reste de mon propos ? je ne puis aller plus avant si je ne suis pas sûr que ce glissement sémantique est voulu ou "un acte manqué" comme disent certains...
-
réponse à vous déjà utilisé et précisions complémentaires de mes propos... 1 / comme vous tenez à être cohérent avec vos autres posts, et c'est tout à votre honneur, vous me répondez en me proposant une analyse de l'acte poétique émit et reçu, comme une occasion de manifester notre émotion, et par là même de communiquer entre nous, cette notion du beau si délicat qu'il risque toujours, comme un flocon de neige, de fondre dès qu'on le touche... 2 / et comme vous me répondez ceci : "Je crois au contraire que toute activité humaine est tournée vers une forme de communication, de mise en relation entre individus, de partage ou de reconnaissance, voire de monstration, bref du besoin du regard de l'autre à un moment ou à un autre du processus comportemental. " j'en déduis que le passage que je vous ai livré ne vous à rien suggérer d'autre, et que si nous n'avons pas la même type d'analyse de la poésie, c'est que sans doute non plus, nous n'en n'avons pas la même expérience... je cite un autre passage de vous dans une réponse à Zenalpha sur le sujet "la philosophie une affaire de tous ?" :"Effectivement, je l'ai eu également à l'esprit en t'écrivant, tu as raison, le commentateur sportif ou la critique littéraire sont justement à l'extérieur de l'ensemble dénommé footballeur pour le premier et romancier, par exemple, pour le second. " et comme vous poursuivez en disant : "Toutefois mon interrogation porte sur la substance du sujet en question, non de la qualité intrinsèque de celui qui se questionne..." j'en déduis également que pour vous la substance de la poésie est uniquement d'ordre de la communication émotionnelle... ce qui me fait avancer une première précision sur mes posts précédents... la singularité de notre expérience ouvre effectivement à une communication, mais elle nous donne aussi d'être unique et unifié par notre contemplation, qui ne se limite pas dans l'acte de poésie à un arrêt sur image du beau, mais à la recherche du vrai et du bien par cet acte d'écriture ou de lecture poétique... je sais que vous dites vrai en parlant de la poésie comme forme de communication, mais pour moi elle est premièrement ce par quoi la communication d'une expérience personnelle du réel est enfin partagée, de manière universel... si vous en restez, en analysant la poésie, à la versification que l'imaginaire produit d'un donné sémantique évolutif, je comprend que vous disiez : "La poésie m'apparait donc comme une porte d'entrée parmi tant d'autres vers ce genre d'objectifs sociaux innés, pour ma part la poésie n'a pas le monopole de la notion de beau, ni de plaire, ni de nous transporter au-delà des apparences crues." pour conclure, je vous donne un poème de mon cru, car au delà "des apparences crues" , la poésie est pour moi une disponibilité à partager plus ou moins notre dimensionnalité spirituelle, et si cela est la cause de notre divergence, elle l'est aussi de notre complémentarité... L'attention et le désir Un jour une attention rencontra un désir sans être préparer elle en fût retournée et de vouloir son bien, se préparait au pire car sa prudence tient au fait d'être bien née, Le désir la séduit par ses tours de passe-passe subtilisant la haine au profit de l'amour conduisant sa conquête sur ses terres de chasse lui fît perdre le mors par abus de détours L'attention essaya de reprendre ses esprits de repousser son hôte par sa force passive mais le désir l'emporte car il l'avait surpris ! c'est l'unique point faible qui la rendait lascive... Depuis ce jour ils vivent ensemble leur passion leurs enfants se nomment: joie, présence, fidélité, l'attention organise la vie de la raison et le désir contemple l'unique vérité. bien à vous
-
je reviendrais plus tard sur la qualité propre de l'intelligibilité scientifique, en analysant au delà de ce que Nietzsche en dit, le caractère salutaire de son objectivation du réel... Ce qui me semble utile pour le moment c'est de prendre comme point de départ votre phrase Zenalpha : "Et je pense qu'en faisant cela,[ nécessite un regard sur la manière de traiter ce sujet par la philosophie.] en démontrant une chose comme son contraire en fonction de sa sensibilité personnelle, seul un regard extérieur à ces mécanismes donc une méta philosophie peut en marquer les limites." cette méta philosophie ( que l'on trouve parfois chez Alfred North Whitehead) c'est ce point de dépassement pour moi qu'apporte la sagesse, comme participation à l'organisation du cosmos, en vue de sa perfection...car si nous "philosophons" juste au plan de la cohérence logique et efficient de notre jugement synthétique, (Kant) nous sommes, on peut le dire condamner à errer de manière encore moins déterminée que la matière, qui elle dans le temps et l'espace porte la vie, qui elle même porte l'esprit (mais pas dans le sens de la dialectique Hégélienne, j'y reviendrait)... pour conclure je reprendrais la fin de votre phrase "peut en marquer les limites" c'est en effet une "supposition" que nous ayons des limites au plan de la connaissance comme nous en avons sur les plans physiques et psychiques, mais si cette démarcation est une frontière, de quelle nature elle est constituée? serait-ce une planification à posteriori de la notion de raisonnable issu de la connaissance scientifique parfaite de la nature ? Est-ce une mise à disposition d'un type de bonheur universel, déduit d'une justice et d'une prudence civilisatrice aboutie ? ou bien la sécurisation des avoirs positifs produit par l'humain en vu d'une gestion écologiquement viable de son environnement ?
-
pas de problème déjà utilisé, l'attente est une maison confortable pour celui qui y vit en paix avec de bonnes lectures comme ton dernier post...
-
merci à déjà utilisé pour son micro cours de belle lettre... si le but était de nous rappeler la différence qu'il y a entre un professeur et un poète c'est une affaire conclue... j'utiliserais néanmoins un passage de ce post pour continuer à aller dans un sens qui me semble important de dégager des vision psycho-chaotique des autres intervenants je cite : " La fonction poétique, c’est l’accent mis sur le message en tant que tel, la visée du message pour lui-même. Et notons bien que message ici signifie texte, énoncé, oeuvre… et non contenu, thème ou idée. Cette visée du message fait que l’oeuvre poétique est un texte qui s’impose à l’esprit et à la mémoire. Le message plaît pour lui-même quand bien même sa mission informative est faible " quel curieux contre sens...est-il possible qu'un texte soit sans contenu, un énoncé sans thème, une œuvre sans idées ? oui c'est la plus curieuse réduction que j'ai lu depuis longtemps... je préfère dire que le poème est ce témoin transmissible, et tout l'enjeu c'est de trouver soi-même l'angle par lequel ce lien de dépassement du sens des mots ouvre à une saisie de l'universel, pas au plan conceptuel, mais au niveau de l'implication de notre conscience, de notre présence au monde, ce donné brut des mots en sa forme poétique fait que notre intelligence et notre volonté se trouve unifiés dans une vision/connaissance intérieure, là où mémoire et imaginaire deviennent docile et peuvent parfaire de manière quasi infini la qualité de notre présence... mais c'est uniquement une lecture extatique qui peut-être suivie d'une instase...
-
déjà-utilise, cette explicitation de l'acte poétique est assez complexe, non pas en son analyse, mais par la torsion qu'elle suggère de l'inspiration, de l'émotion et de la communication poétique... c'est une vision psycho-réductrice qui établirait, selon vous, la capacité du poète à voir le réel et à le retranscrire pour d'autres, car vous dites : "La lumière qui excite l'esprit.........le charme ou le subjugue égoïstement". cette option, en fin de compte est l'antithèse de l'acte poétique, qui par principe est une invitation gratuite et aimante du choix libre de communiquer... la poésie n'est pas nécessaire, comme le sont toutes les autres formes de communications, elle ne tend pas à capturer l'attention du lecteur, mais à en lui offrir une ouverture de plus sur le réel... bref, puisque il y a selon vous une fascination : "vers un tiers objet subjectivement affublé de beauté". c'est sans doute votre grille de lecture "de la poésie" mais surtout celle d'un esprit convexe qui tient à rester seul dans ses émotions, et reflète ce qu'il perçoit en n'en dispersant les points d'unité réels : "ils ne se regardent pas immédiatement". pour conclure, je reprendrais justement votre dernière phrase : "deux observateurs de l'astre lunaire dans un moment de poésie visuelle..." c'est une option "scientifique" de l'acte poétique, cette expérience/expérimentation d'un moment, n'a rien de la contemplation du beau, car vous dites "observateur" et "astre lunaire", qui d'autre sinon un esprit scientifique réduirait la poésie à ce mode descriptif et userait de l'adjectif "visuelle"pour en marquer l'objectivité... Rimbaud se dit visionnaire, mais justement en recherche de sa présence dans le réel, et de la notre si nous lui accordons un moment de lecture... ce que vous faites de la poésie c'est un isolement égocentrique vécu par une juxtaposition de spectateurs, la poésie est l'occasion unique de nous avouer les uns aux autres, notre sentiment d'appartenance au "tout", qui ne se rend présent que dans l'émotion et la gratuité...deux qualités de l'acte contemplatif... P.S ne voyez pas dans cette réponse un méprit pour votre choix de voir la poésie telle que vous la voyez, c'est qu'il est si loin du mien, que m'en approchant pour le comprendre, j'y ai ressenti un terrible effroi...
-
j'ai lu tous vos posts, et...pour cette phrase de Rimbaud un seul semble pour moi se diriger vers le sens qu'a voulu donner le poète, c'est Pheldwyn, car il situ très bien la tension qui existe en poésie, dans la recherche du dire par son intelligence et sa sensibilité, ce que d'autre ne sauraient faire, cette disponibilité à l'inspiration, comme une plaie que l'on garderait ouverte pour rassasier ceux qui voudraient se nourrir de sang, c'est à dire du flux de vécu du poète... l'expérience de la poésie est une des plus naturelle parmi les arts, car elle se suffit de sa conscience expérimentale du réel, en poésie nous sommes au contact de la frontière la plus fine entre le réel sensible commun à tous et le "je"dis de ce réel "ceci"... la phrase de Rimbaud est comme un constat de l'universalisation possible du message poétique, comme une supplique pour unir les consciences, cet "autre" est le nom de l'autre rive, et la poésie en est le pont...
-
n'aillant lu que la dernière page de ce forum, je m'exprimerais comme nouveau venu découvrant le sujet qui est raccord avec un autre débat... aparté: premièrement je trouve très pertinente votre réflexion Zenalpha au sujet de la construction logique à plusieurs niveaux d'inférence de l'idéologie...moins sur le mélange opératif nécessaire à la validation d'un système, je vous cite :"Aucun individu n'a le pouvoir de faire une analyse complète de ce qu'il pense même en s'interrogeant sur lui en miroir s'il n'a pas un retour extérieur lui montrant la rigidité du cadre dans lequel son raisonnement s'inscrit pour une thématique qui dépasse ce cadre et dont il ne pouvait avoir même conscience." cette nécessité devait bien avoir une fin de partage, alors au bout de combien de "retour extérieur" il conviendrait d'y apposer une certification ? peut-être jamais ? car elle n'est peut-être même pas envisageable ! même si ce point de vue est très intéressant, on le sent soutenu par une lecture psychologique de la personne, et disons le mot "relatif" par l'état conscient/inconscient de son intelligence... c'est pourquoi je reprendrais la question initiale de façon très candide... la philosophie une affaire de tous ? ce que nous nommons philosophie est au delà de la virtuosité intellectuelle dans la manipulation des concepts, une recherche de sagesse, c'est pourquoi elle est l'affaire de tous dans le rapport "heureux" qu'elle admet entre notre intelligence et notre recherche de vérité... ce qui semble une constance dans le continuum du développement des civilisations, c'est l'acceptation que l'intelligence partagée(et là je rejoins en partie Zenalpha ) porte un bienfait nécessaire, jusque dans les recherches scientifiques, que je critique par ailleurs pour d'autres raisons... ne serait-ce pas cela le bien commun qui cherche à investir notre quotidien ? en ce sens la philosophie est l'affaire de tous, parce qu'elle est le plan attractif du vrai, car dès notre organisation en communauté,(il y a bien longtemps) nous avons composé une conscience collective du vrai (voir l'exposé de Paul Jorion "comment la vérité et la réalité furent inventées ) et cette acceptation d'une mise en commun nous dispose aussi à en chercher toutes les entrées, malgré la disparité de nos positions sociales, je cite de nouveau Zenalpha : "Il n'empêche que, certains faits dans un cadre précis s'imposent comme des réalités "objectives" donc disctinct de la subjectivité de l'un ou de l'autre malgré nos tergiversations à les trouver relatives de par nos limites conceptuelles." ces faits semblent être le ciment de notre cohésion en tant qu'espèce et en singularité qu'en aux autres espèces animales, la discontinuité apparente des savoirs, selon l'objet étudié ou la modalité des différentes études, pose quand même la question de l'unité du vrai au travers de ces différences... c'est à cette recherche que doit tendre pour moi l'esprit philosophique, sans confondre, sans syncrétisme, sans opposition de principes, admettant les contraires dans une harmonisation des savoirs...utopie fantasmatique, rêve éculé ? pas si sûr... la connaissance contemplative à déjà dans le passé recherché cette unité des savoirs, reste à chaque époque et à tous le monde le choix de réactivé cette recherche...
-
bien le bonjour à vous... et surtout à Sponzy avec qui nous partageons nos controverses respectives tout d'abord de quoi s'agit-il, l'intelligence organisationnelle à une longue histoire, du chantier de la grande pyramide à la systématisation des occurrences big data, elle est systématisé entre autre par la recherche de Paul Smolensky avec le principe du meilleur ajustement ( best fit principle) *... ce que cette version organisationnelle du savoir apporte, serait la gestion fonctionnelle de la masse informative, et si cette option se trouve normative au niveau de la complexité tel que le dit Nolibar : "j’observe la complexité effarante de l’organisation de notre Société" , car cette gestion génère de plus en plus de complexité dans la durées de l'interconnexion des réseaux...(je me réfère aux derniers travaux de Gilbert Simondon ) Maintenant nous devons reprendre ce que dit Foraveur : "Mais la gestion des informations internes et externes c'est un élément essentiel de performance pour les organisations qui évoluent dans un environnement concurrentiel..." Surement en partie la phrase de Talon 1 : « L'intelligence est un ensemble d'aptitudes permettant à un individu d'expérimenter, de penser, d'apprendre et de s'adapter au monde. » Cet « environnement concurrentiel » que nous avons à expérimenter aujourd’hui est la résultante de notre choix organisationnel des savoirs... car au contact sensible de l’environnement naturel, concurrentiel aussi, mais sous des modes évolutifs différents en temps, lieux, efficience et finalité, la connaissance ne devrait pas devenir plus complexe, mais plus révélatrice de notre place dans l'univers... c'est à dire une contemplation, c'est en tout cas le but de mon intelligence et de ma volonté actuelle... C’est ici que se trouve utile de citer le passage de Spinoza relégué par Nolibar : “Est bon ce que je désire : ce n’est parce que nous jugeons qu’une chose est bonne que nous la désirons, mais c’est parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne” ou selon une autre source : « Nous ne désirons aucune chose parce que nous la trouvons bonne mais, au contraire, nous jugeons qu’une chose est bonne parce que nous la désirons. » L’affirmation de Baruch : « est bon ce que je désire » part - elle du principe que la volonté désire un bien connu ? non bien sûr et là est son erreur de raisonnement, il dit ensuite : « ce n’est pas parce que nous jugeons qu’une chose est bonne que nous la désirons, mais c’est parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne” Sa prémisse inversée lui fait donc affirmer que le désir est premier sur le jugement d’existence, sans se rendre compte que l’on ne désir une chose que dans la mesure où elle nous est connue… C’est cette inversion qui est causée d’après moi, (référence : Les Pensées métaphysiques de Spinoza Chantal Jaquet publication de la Sorbone) à partir de la logique cartésienne, de la centralité du cogito...car René nous dit dans sa quatrième méditation métaphysique : « D’où est-ce donc que naissent mes erreurs ? C’est à savoir de cela seul que, la volonté étant beaucoup plus ample et étendu que l’entendement, je ne la contiens pas dans les mêmes limites, mais que je l’étends aussi aux choses que je n’entends pas » Il me semble que Blaise lui répond dans cette phrase qui est devenu un adage : « le cœur a ses raisons que la raison ne connait point »… A savoir que c’est une réalité saisie dans un acte d'identification qui est "un" par l'intelligence et la volonté, ce qui défini en partie l'acte contemplatif... Est-il besoin d’expliciter plus avant, que l’inversion de Baruch ouvre sur une indétermination de l’acte propre de la volonté au profit d’une saisie informative des « possibles » issue de l’entendement…(il serait intéressant d'ailleurs de voir si cela recoupe ce que nous nommons « raisonnement ») … ou dit autrement « le bien objectif désirable » devient relatif non pas à la connaissance sensible que j’en ai, mais au jugement nécessaire d’en avoir besoin…ceci réduisant de fait les réalités désirables à une quantité gérée et plus à une qualité de vie…c’est toute notre époque cela… corolaire : Et enfin la question : puis-je avoir une connaissance vraie en dehors du fait que ce soit une connaissance humaine ? tout le paradigme scientifique et religieux est là dans des directions différentes bien sûr… Pour les sciences le risque étant d’appeler poissons ce que prend leurs filets, pour les religions de tenir pour vraies toutes affirmations cohérentes à « une révélation »... mais j’y reviendrais… * introduction aux sciences cognitives