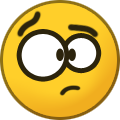mary.shostakov
Membre-
Compteur de contenus
760 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
1
Type de contenu
Profils
Forums
Blogs
Calendrier
Vidéos
Quiz
Movies
Tout ce qui a été posté par mary.shostakov
-
... ... ... j'adore la musique de ce film ... ... ... ...
-

Qui a encore envie de voyager aux États-Unis?
mary.shostakov a répondu à un(e) sujet de Gouderien dans International
... ... ... Tu as raison, y faut pas exagérer, les États-Unis ont toujours été un pays pas plus raciste que n'importe quel pays. Tu ne risqueras jamais rien aux États-Unis par ce que tu sais parfaitement que ce pays n'est certainement pas depuis un ou deux mois le pays raciste par la loi et les règlements décidés à la Maison Blanche sans aucune des consultations auprès du Congrès et du Sénat. LA LOI, C'EST MOI ! ! ! hurle le fasciste en place aujourd'hui à la tête des USA en engueulant comme un dément sous l'effet d'une crise aigüe même la cours suprême de l'État fédéral qui n'est pas d'accord avec lui malgré la majorité de Républicains qu'il a lui-même nommés à ce poste ! Tu as oublié ce qu'était exactement les choses du temps d'un Berlin régnant sur l'Europe. Elles étaient les même qu'aux USA depuis deux mois. Les point Godwin permettent de remettre en place les idées de quiconque en comprend la teneur. ... ... ... -

Qui a encore envie de voyager aux États-Unis?
mary.shostakov a répondu à un(e) sujet de Gouderien dans International
... ... ... D'une part à cause d'une réaction patriotique contre tout de que disent et font Trump et la bande de gangsters de son administration ... D'autre part parce qui il est aujourd'hui très dangereux pour un étranger d'avoir ses pieds sur le sol des États-Unis, même en respectant les règlements et lois de ce pays sur l'immigration. ... ... ... ... ... ... Pour mémoire, une petite actrice mexicaine qui s'est présentée à la frontière séparant le Mexique et les États-Unis avec tout les papiers et les visas nécessaires a été arrêtée alors qu'elle était encore sur le sol mexicain et a été incarcérée pendant 12 jours dans la pire prison de Californie. ... ... ... -

Qui a encore envie de voyager aux États-Unis?
mary.shostakov a répondu à un(e) sujet de Gouderien dans International
... ... ... Pourquoi se priver de tout ça ? Parce que si tu as un visage, un accent, un nom suspect aux yeux ou aux oreilles des flics américains, tu risques d'être envoyé à la prison-poubelle de Guantanamo, pour toujours, sans discussions, sans procès. ... ... ... -

Qui a encore envie de voyager aux États-Unis?
mary.shostakov a répondu à un(e) sujet de Gouderien dans International
. Pour mémoire, des millions de Canadiens, qu'on appelait les «Snowbirds», quittaient depuis des dizaines et des dizaines d'années le Canada pour passer loin de la neige et du froid six mois entiers chaque année au soleil du Texas, de la Louisiane, de la Virginie, de la Californie ou de la Floride. Ces millions de Canadiens ont TOUS annulé le mois dernier leur séjour habituel aux États-Unis ! TOUS ! ... . -

La philosophie se moque de la philosophie
mary.shostakov a répondu à un(e) sujet de mary.shostakov dans Philosophie
. Je m'efforce de ne retenir dans le matérialisme et l'idéalisme que ce qui peut constituer de solides passerelles entre ces deux secteurs de la pensée. Mon moyen, mon système, ma grille, ma trame de considération des passerelles de communication entre ce qui fait l'homme que je crois être et devenir, cela s'exprime ainsi depuis ma naissance, ou presque : ART, SCIENCE, PHILOSOPHIE. (j'allais dire un point c'est tout, mais je me contenterai d'un AINSI SOIT-IL pour aujourd'hui... ) . -
... ... ... Appartenant à l'une des familles nobles les plus influentes d'Athènes, Platon reçoit l'éducation soignée consentie aux jeunes gens des familles aristocratiques. Lorsqu'il rencontre Socrate, il n'a que vingt ans alors que le maître en a soixante-trois. Il suivra les leçons et l'enseignement de Socrate pendant huit ans, huit années d'apprentissage qui le convaincront de la supériorité de la parole vivante et de la discussion sur le discours et l'exposé doctrinal. La mort de Socrate, accusé d'impiété et de corruption de la jeunesse, et condamné à boire la ciguë, c'est pour lui un drame et un cataclysme dont toute son œuvre porte la marque. Sa vision caricaturale des sophistes (ces ennemis de la sagesse), sa haine de la démocratie (laquelle donne le pouvoir aux faibles et aux ignorants), ses tentatives répétées auprès des tyrans de Syracuse (Denys l'Ancien, puis Denys le Jeune qui lui succéda) témoignent de sa déception et de son hostilité envers le gouvernement de la cité qu'il accuse d'être responsable de la mort de Socrate. La philosophie de Platon est un long plaidoyer en hommage à Socrate, cet homme a la personnalité attachante qui fut à la fois un maître et la victime d'une scandaleuse injustice. Dans la plupart des dialogues de Platon, Socrate tient le rôle principal et en est le héros. La tradition vivante, Platon l'a fixée sans retour en traçant la figure légendaire du philosophe, « le premier, disait Cicéron, qui fit descendre la philosophie du ciel ». La fabrication de la légende et du personnage, sur lequel nous savons en fait peu de chose, édifiée et construire par son illustre disciple, génie littéraire et philosophique devenu son témoin et son évangéliste, nous rappelle une autre légende qu'on peut mettre en parallèle. Le saint laïque et le dieu chrétien : deux hommes dont l'évocation de la vie et de la mort est celle de deux héros. L'Académie Qu'enseignait-on à l'Académie, l'école que fonda Platon en son temps près d'Athènes ? Un savoir exotérique, que nous connaissons grâce aux nombreux écrits de Platon faits du bricolage des idées de Socrate et des idées philosophiques et politiques de Platon. Le premier groupe de dialogues de Platon (les « dialogues socratiques » ou « dialogues de jeunesse ») renferment l'enseignement de Socrate dirigé essentiellement contre les sophistes et la puissante influence qu'ils exerçaient sur la jeunesse athénienne. Les dialogues de Platon se présentent à la fois comme des drames et des comédies et offrent à peu près toujours le même aspect : Socrate prétendant « ne rien savoir » questionne son interlocuteur, passe sa réponse au crible de l'analyse et l'examine avec soin pour démêler le vrai du faux. Socrate cherche le sens profond des choses, ce qu'elles ont d'universel et de commun et qui nous permet d'en parler : qu'est ce que la beauté ([/i]Hippias majeur[/i]), la piété (Euthyphron), le courage (Lachès), l'amitié(Lysis), la justice (La République) ? Il essaie de cerner le concept qui se cache derrière les apparences, l'unité que masquent la diversité et la multiplicité des signes du langage. L'ironie socratique bat son plein. L'interrogation sème le doute. La plupart du temps l'interlocuteur se voit pris en flagrant délit de contradiction. Et le dialogue, mené de main de maître par Socrate, c'est-à-dire par Platon, sans aboutir, en arrive pourtant à cette importante conclusion : nous ne savons peut-être pas ce qu'est la beauté, la piété, le courage, l'amitié, la justice, mais nous savons désormais ce qu'elles ne sont pas ! Le dialogue nous a permis d'éliminer leurs dangereuses caricatures, savoir apparent qui se prenait pour le savoir véritable, et délivrer les esprits des eaux troubles du mobilisme et du relativisme dans lequel pêchent les sophistes ! … Le second groupe de dialogues (les « dialogues de vieillesse » ou « dialogues de la maturité ») n'a plus grand choses avec les premiers entretiens, dont le bénéfice est moins de faire avancer la discussion en vue d'une conclusion que de passer en examen un certain nombre de thèses ou d'opinion en s'efforçant de mener à bien un travail d'épuration. À partir du Cratyle apparaît pour la première fois et avec une parfaite clarté la séparation des idées qui, suivant le Phédon, introduit une nouvelle conception de la science et de la dialectique. L'entretien se déplace de la discussion elle-même vers les réalités qui la sous-tendent. Platon expose sa théorie des idées dans les grands dialogues constitutifs de cette période. D'un abord beaucoup plus difficile (voir le Parménide, le Thééthète et le Sophiste), il est légitime de croire que ces dialogues donnent accès à la véritable pensée de Platon, ce qui, au delà des préoccupations plus immédiates de Socrate, fut le rêve de Platon qui deviendra pour des siècles l'archétype total et parfait du rêve le plus élevé de tous les rêves philosophiques : Embrasser le Tout pour son temps et une fois pour toutes dans un ensemble de pures spéculations métaphysiques, éthiques, politiques et cosmologiques ! Rien que ça ! … Le Socrate historique Sur Socrate, les témoignages dignes de foi sont peu nombreux et contradictoires. Si on confronte les témoignages anciens qui nous sont parvenus, ceux qui se recommandent de lui ou ceux qui l'ont combattu, il est impossible de démêler la légende de la réalité. Platon et Xénophon dressent de Socrate un portrait différent. Aristote ne l'a pas connu, et quand il s'y rapporte, c'est pour l'opposer à Platon. Aristophane de dépeint comme un sophiste, un faiseur de mots et un affabulateur. Socrate se plaisait à dire qu'il était l'élève de Prodicos, un sophiste de qui il aurait appris le sens des mots. Il aurait été l'auditeur de Damon, un sophiste lui aussi, et le disciple d'Archélaos de Milet, qui succéda à Anaxagore à Athènes. Des écoles divergentes se réclament de Socrate. L'école mégarique (qui pratiquait la dispute et la controverse), l'école cynique, l'école cyrénaïque, qui se sont le plus souvent opposées ou combattues. De ces écoles, il ne nous est parvenu que très peu de chose et elles ont vite été relayées par les grandes écoles dogmatiques apparues après la mort d'Alexandre. On considère habituellement la tradition platonicienne comme authentiquement socratique. Comment prêter foi à cette affirmation ? La rareté des documents, l'absence d'exactitude, les échos et les témoignages discordants et contradictoires, les conflits doctrinaux entre écoles diverses qui s'en réclament, tout nous porte à en douter et même à croire le contraire ! La personnalité de Socrate nous est mal connue. Nous disposons de très peu de renseignements sur la période de sa vie qui précède sa rencontre avec Platon. La légende de cet ex-tailleur de pierre, fils de sage-femme, qui le place dans la position d'un véritable initiateur et géniteur spirituel est d'origine essentiellement platonicienne. Se pourrait-il que celui sous le patronage duquel s'est édifiée toute la philosophie officielle et dominante, le meilleur des hommes et le plus sage, Socrate, cet homme extraordinaire, n'ait été qu'un habile dialecticien ? Un habile dialecticien méprisant la multitude, ses opinions et ses croyances ? Polycrate voit en lui un ennemi de la démocratie, un dangereux fanatique qui fut un conservateur en politique comme en matière de mœurs où il fait preuve de misogynie. Aristophane en parle comme d'un sophiste qui se plaisait à prendre le contre-pied des idées reçues sur lesquels il débitait les plus subtils radotages. Certains le disait arrogant, prétentieux, fier d'un savoir dont il n'usait que pour contredire et ridiculiser autrui. Nous savons tous que son ignorance est feinte et que la modestie qu'il affiche est pure hypocrisie ! Pourquoi le mythe, la fabrication et la construction du personnage conceptuel qu'est devenu Socrate ne relèveraient-ils pas de la littérature et de la fiction platonicienne ? Comme ce sont toujours les gagnants qui écrivent l'histoire, la philosophie dominante a tout intérêt à faire l'impasse sur l'enseignement de l'historiographie. L'histoire de la philosophie telle qu'elle apparaît dans les manuels et les encyclopédies, telle qu'on l'enseigne et la pratique à l'université, elle continue de raconter la même légende que délivre l'historiographie officielle qui ne connaît qu'une seule et unique narration. Impossible d'aller voir de l'autre côté du miroir platonicien qu'il existe des points de vue alternatifs. La coutume des vainqueurs, qui est de tout raser, oblige au massacre intégral. Bénédiction est accordée aux héritiers de Socrate, qui peuvent continuer en toute liberté à s'adonner benoîtement à la légende en s'adonnant aux diverses formes de l'onirisme ! … Le Socrate de Platon Avec Platon, son disciple et hagiographe, la légende de Socrate se personnifie et se singularise. Pour pouvoir distiller son enseignement, Socrate a hérité de sa mère, qui était sage-femme, l'art d'accoucher, la maïeutique (voir leThééthète). L'une accouche les corps, l'autre accouche les esprits ! Cet art qui n'arrive pas à des réponses toutes faites est un art du questionnement et de l'interrogation qui requiert la pratique de l'ironie. Il s'agit donc pour Socrate d'interroger en feignant l'ignorance. Socrate « avoue » que son savoir n'est rien et qu'il ne sait en réalité qu'une chose, à savoir qu'il ne sait rien (Apologie). Le dialogue est menée de main de maître par Socrate. L'interlocuteur, criblé de questions et pris au piège de la discussion, est aussitôt mis dans l'embarras. Ce qu'il croyait connaître, il se voit obligé d'admettre qu'il l'ignore. Le voilà pris en flagrant délit d'ignorance. Pire : il est victime d'une ignorance crasse car c'est une ignorance qui s'ignore. Une double ignorance. Qu'importe ! Car pour Socrate le but est atteint : l'objectif de la discussion étant moins d'en tirer un savoir particulier que d'apprendre à chacun à bien se connaître, selon le célèbre Connais-toi toi-même inscrit sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes. On devine à quel point un tel personnage pouvait déranger. La plupart des interlocuteurs de Socrate étaient des sophistes, des poètes, des gens de lettre, des hommes de loi qui passaient aux yeux de la multitude et à leurs propres yeux pour des sages. Le procès qu'on fit à Socrate, raconté dans l'Apologie, portait sur deux chefs d'accusation : « Socrate est coupable de ne pas croire aux Dieux reconnus par la cité »; « Socrate est coupable de corrompre la jeunesse ». Peine demandée : la mort. La poursuite est engagée. Derrière les motifs d'accusation, il y a peut-être des raisons politiques : une sorte de revanche contre Socrate pour les liens qu'il aurait entretenus avec des membres de l'oligarchie des Tyrans, dont la chute venait de laisser place à la restauration de la démocratie athénienne. Verdict : 281 voix contre 221. Sentence : Socrate coupable et condamné à boire la ciguë. Socrate était-il devenu un personnage gênant ? S'agissait-il de se débarrasser de quelqu'un qui mettait en péril les institutions ? De quoi Socrate était-il coupable ? Platon va s'attacher à montrer qu'il s'agit d'une affaire montée de toute pièce par des ennemis de Socrate ayant profité de l'instabilité politique, l'état où Athènes était parvenue à la suite des désordres de la démocratie, pour s'en prendre à lui et le traduire en justice. Poètes, politiciens, sophistes et rhéteurs vont devenir les cibles de prédilections et les sujet de moquerie de Platon. Ils sont devenus responsables de la mort de Socrate et des ravages que peut provoquer, toujours selon Platon, la parole quand elle est détournée de sa fin véritable : la Justice ou la Fin Morale à laquelle elle doit être assignée. L'ennemi des sophistes Sous la plume de Platon, qui sait habilement jouer de la métaphore, les sophistes ont droit à toutes les épithètes : « artisans de l'illusion », « marchands de philosophie », « professeurs de vraisemblance », « fabricateurs de thèses et d'antithèses », « chasseurs intéressés de jeunes gens riches », « négociants de connaissances à l'usage de l'âme », « athlètes dans les combats de paroles », « purificateurs des opinions qui font obstacle à la science » (Sophiste). Lui qui aime le pastiche se plaît à les caricaturer et à caricaturer leurs discours : il nous montre Hippias, fier de lui et arrogant, qui se vante d'enseigner et de pratiquer tous les arts (Hippias majeur), Gorgias, qui est un excellent rhéteur, mais qui est incapable de donner une fin morale à son art (Gorgias), Protagoras, qui discute sur la justice, sur la possibilité de l'enseigner et de la transmettre, et qui conclut son exposé par un mythe (Protagoras), Calliclès, le violent, l'impétueux, qui fait l'apologie de la force brute et de l'instinct en politique (Gorgias). Les sophistes, qui sont l'objet des sarcasmes de Socrate et auxquels Platon attribue une doctrine bien définie, le relativisme, n'ont peut-être de commun que le nom. Ils sont accusés de vendre leur savoir et de mettre la vérité au service de leurs intérêts personnels en rabaissant la connaissance au rang de simples techniques. Ils sont accusés de prodiguer leurs leçons aux jeunes gens avides de pouvoir et de richesse mus par l'appât du succès et du gain, par un enseignement substituant au débat rationnel la recherche de conviction et de persuasion. Ils sont accusés de réduire la connaissance à la sensation, « faisant de l'humain la connaissance de toutes choses », selon la formule attribuée à Protagoras « de toutes choses, c'est-à-dire de celles qui sont et de leur existence et de celle qui ne sont pas et de leur non existence ». L'époque se prêtait merveilleusement bien à l'arrivée de ces singuliers personnages, professeurs d'éloquence, maîtres du discours, spécialistes et virtuoses du langage capables de convaincre et de persuader par le seul pouvoir de la parole. Le commerce, les guerres, l'instabilité politique, l'ébranlement moral qui s'empare des esprits à la suite de la défaite contre Sparte et qui se traduit par l'écrasement d'Athènes, le jeu de bascule entre la démocratie et une tyrannie oligarchique, tout ça finit par instaurer un gouvernement démocratique. (Celui-là même qui devait condamner Socrate.) La démocratie donne le pouvoir au peuple, lequel pouvoir peut maintenant être acquis par la parole accordant désormais la prééminence aux qualités du citoyen et non plus au privilège de l'ascendance noble. Volontairement gauchie et déformée par Platon, parodiée plus ou moins cruellement dans ses dialogues, la doctrine des sophistes est tournée en ridicule. Leur scepticisme à l'égard de la connaissance se mue en subjectivisme philosophique : si l'homme est la mesure de toutes choses, s'il n'y a pas de vérité supérieure à l'opinion, alors toutes les opinions se valent. Si toutes les opinions se valent, autant dire qu'aucune n'a de valeur, qu'il nous est impossible de distinguer le vrai du faux, et si tout est vrai, rien n'est vrai, toutes choses étant d'égales force et se réduisant à l'équivalence ou à la simple vraisemblance. Sur cette pente, on aboutit forcément à une conclusion désastreuse : le nihilisme, qui est l'envers et le revers du relativisme, sa conséquence logique et inévitable. C'est la négation de l'être, qui conduirait Gorgias, le père de la rhétorique, à affirmer : 1 . « Rien n'existe. » 2. « Si quelque chose existe, il est inconnaissable à l'humain. » 3. « S'il est inconnaissable, il est incommunicable aux autres. » De fait, en est-il bien ainsi ? Au-delà des clichés et des formules éculées qui sont le pain et le beurre des historiens, par-delà la caricature et le mépris qui leur sont restés attachés jusqu'à nos jours et depuis Platon, qu'étaient véritablement les sophistes qu'en fait nous connaissons si peu et si mal ? Les plus connus ont vécu aux cinquième et quatrième siècles avant J.C. : ce sont Protagoras, Gorgias, Hippias, Prodicos, Thasimaque et Antiphon. La plupart figurent dans les Dialogues de Platon. Venus des contrées grecques, ils s'installèrent à Athènes ou y séjournèrent, selon le cas. La ville, capitale du monde grec alors en pleine mutation, attirait par son prestige grandissant ces nouveaux fabricants de savoir rompus à l'art oratoire. Ils vendaient effectivement leur leçons et répondaient à un besoin que requéraient le contexte et les institutions de l'époque : former des jeunes gens à une carrière politique à occuper un poste dans l'administration de la cité comme magistrats, juristes ou stratèges. Leurs connaissances étaient étendues, dit-on, quasi encyclopédiques : grammaire, poésie, musique, mathématiques, astronomie, art militaire, tout ce dont la parole rend capable, et ce dont avait besoin celui qui aspirait à une haute fonction ou à un poste de commandement dans la société. Des sophistes, il ne nous reste que des fragments ou de courts extraits, des phrases, des paroles qui nous ont été transmises par des commentateurs souvent hostiles à leur pensée, au premier chef Platon, peu soucieux d'objectivité, on le sait, et ennemi des sophistes. On dit des sophistes qu'ils ramènent tout à la sensation. Contrairement à Socrate et à Platon, ils ne croient pas en une vérité une et universelle, toujours la même, supérieure aux êtres qui tireraient d'elle leur intelligibilité. Ils ne croient pas aux idées générales, mais soutiennent que les concepts n'ont aucune réalité, que ce sont des mots ou des étiquettes que nous accolons aux choses par pure commodité. Selon eux ce qui est seul réel, c'est ce que nous percevons, qui n'existent pas en soi, mais relativement à l'acte par lequel les choses nous apparaissent : « Ce que l'homme appelle vérité, c'est toujours sa vérité, c'est-à-dire l'aspect sous lequel les choses lui apparaissent. » (Protagoras). Les sophistes se refusent à tout discours de l'ontologique, qui, pour eux, est un discours vide. Ils ne cherchent pas comme Parménide à départager l'opinion et la vérité : toute césure ou toute tentative de cassure est encore discours sur l'être. Ils s'en tiennent à ce que nous pouvons voir et affirmer et sur quoi nous pouvons nous entendre : non pas la Vérité (le vrai absolu), mais « la vérité » (un vrai non absolu) telle qu'elle se montre aux humains dans son pouvoir d'apparaître, qui est pure phénoménalité. Les sophistes (en tout cas Gorgias et Protagoras) sont nominalistes et perspectivistes. Nominalistes, puisque selon eux les idées générales sont une illusion de l'esprit. Perspectivistes, puisque la connaissance que nous avons des choses dépend toujours du contexte, de la situation, du point de vue, selon lesquels les choses nous apparaissent. C'est la signification de la formule de Protagoras disant « l'humain est la mesure de toutes choses » et non la caricature que Platon en a faite ! Les sophistes sont capables de penser un monde pluriel et polycentrique où le temps et le lieux n'ont plus le caractère homogène de la petite cité grecque. Voyageant de ville en ville, ils ont pu observer la relativité des jugements que les humains portent sur les mêmes choses, les humains n'utilisant pour ainsi dire jamais les mêmes critères pour les mesurer. Fidèle à sa doctrine, Protagoras ne reconnaît de lois que celles de la cité : non que les lois de la cité sont les « meilleures », mais parce qu'il n'existe pas de lois universelles ou de lois antérieures aux lois écrites. Une loi n'est « meilleure » que dans la mesure où elle obtient l'adhésion du plus grand nombre et par là favorise l'harmonie et la cohésion sociale. « Meilleure » est la loi, mais pas plus vraie : « Moi, je conviens que les lois sont meilleurs que les autres, mais plus vraies, non pas. » (Thééthère). Il y a un certain pragmatisme se rattachant à cette idéologie mis au service de l'utilité. Ce pragmatisme se retrouve dans ce qui devient pour Protagoras le « discours fort », c'est-à-dire un discours librement partagé capable de rassembler et unir les humain dans une entreprise collective. Le « conventionalisme » de Protagoras, à tout prendre, est beaucoup plus stimulant que l'universalisme de Platon (et de Socrate), qui aboutit au refus du changement ! Les sophistes sont de vrais démocrates. Ils travaillent à l'extension et à l'égalisation de la condition de citoyen à tous. Face à Platon, qui condamne les humains à une inégalité naturelle d'aptitude et de talent créant une véritable ségrégation au sein de la société, les sophistes prônent l'égalité des chances pour tous. Tous les humains sont égaux en droit : la place qui revient à chacun n'est pas fixée d'avance, mais c'est à chacun d'y accéder en fonction de sa compétence en politique. De sa compétence acquise comment ? Grâce au nouveau rôle attribué au langage qui vise à élever le citoyen vers un état meilleur. D'inégaux chez Platon, pour qui la « bonne délibération » est l'apanage de quelques citoyens, à savoir les philosophes qui forment l'élite des hommes sages et compétents (La République), d'inégaux, donc, et grâce au logos (la parole), les humains deviennent politiquement égaux avec Protagoras. Ce qui donne au discours sa force, c'est le consensus qu'il provoque. La vérité de la personne privée est alors le citoyen. Dans l'égalité démocratique, on ne pèse pas les voix ... On les compte ! ... L'ancien système hiérarchique et inégalitaire, l'idéal aristocratique à consonance héroïque éclate en mille morceaux sous les critiques et coups répétés des sophistes. C'est là le véritable enjeu au fondement même de la démocratie : l'acquisition de cette compétence délibérative que doit recevoir tout citoyen et qui lui permet de jouer un rôle actif dans la société. D'où l'importance du rôle et de la place de l'éducation en démocratie, et c'est bien ce que Protagoras professe. L'action du sophiste est primordiale. Dans le dessein qui est le sien en tant qu'éducateur, il a pour tâche de permettre à chacun « de passer d'un état moins bon à un état meilleur ». Et Protagoras de conclure : « Le médecin produit ce changement par des drogues, le sophiste par des discours ». La hargne de Platon et son acharnement contre les sophistes et leur enseignement montrent qu'il a bien saisi le véritable enjeu de la démocratie ! Comment en dire plus, sinon s'insurger contre les propos malveillants de Platon et contre la malhonnêteté et le manque d'objectivité dont il a fait preuve dans sa façon de traiter les sophistes, qu'il s'est évertué à démoniser, à diaboliser, sans vergogne, et du mieux qu'il a pu ? Platon développe toute une machine de guerre contre les sophistes. En commençant par la démence et le délire de sa théorie des idées … La théorie des idées Si tout est en perpétuel changement, si tout ce qui existe est soumis à un flux incessant et évanescent, apparences sensibles qui ne sont que de vaines images de la réalité et qui ne peuvent être objet de connaissance, comment expliquer les choses et comment expliquer ce qui, dans les choses, persiste à travers le devenir et le changement et demeure permanent ? Réponse (il fallait y penser) : en conciliant les deux, l'immobilité et le changement, l'être et l'apparence, l'universel et le singulier, l'ontologie statique de Parménide et le mobilisme d'Héraclite ! 1 ) Le monde sensible est fait d'instabilité et de changement. Il n'est pas fait de concepts, mais des choses que nous voyons, touchons, etc. Le monde sensible est le monde que nous habitons, fait d'opinions et de fausses croyances sur la réalité, d'ombres au sujet desquelles nous nous disputons sans cesse en nous disputant sur les apparences du vrai, du beau, du bien, etc. 2 ) Le vrai monde, ou le monde vrai, le monde intelligible échappe au devenir et au changement. Il contient les modèles exemplaires des choses ici-bas, qui ne sont que des imitations ou de pâles copies des choses intelligibles. Le monde vrai, le monde intelligible est formé des Essences véritables, Formes immuables et éternelles que Platon appelle Idées (avec une belle majuscule pour marquer leur transcendance). Il y a donc selon Platon une idée de toutes choses, une idée du lit, une idée de la feuille, une idée de l'humain, une idée de ce qui est beau, bon, juste, etc. Chaque chose en soi qui lui préexiste et qui est son double éternel, qui lui confère son être, son essence, et qui nous permet de la désigner par son nom. Parménide (dans le dialogue du même nom) demande à Socrate « s'il y a une idée du poil, de la boue, de la saleté ou de toute autre chose insignifiante et sans valeur ». Socrate hésite, mais il est bien obligé d'accorder à Parménide que s'il y a une idée du beau, du bon et du vrai, il doit bien y avoir une idée du poux, de la boue et de la crasse ! Ne comportant rien de sensible, le monde intelligible est seul objet de connaissance, de science, et nous ne pouvons nous y élever qu'à l'aide des mathématiques et d'une dialectique ascendante. Chez Platon, les mathématiques servent d'auxiliaire à la dialectique en tant que propédeutique et science de la mesure. Elles donnent son premier mouvement à l'âme dans son élévation vers la région supérieure des Idées. Sur la porte d'entrée de l'Académie de Platon figurait la formule devenue légendaire : « Que nul n'entre ici s'il n'est pas géomètre ». Le Timée nous renseigne aussi sur la dialectique ascendante comme effort du Logos dans sa participation aux Idées, c'est-à-dire la participation des Idées entre elles et avec l'Idée du bien, la plus grande de toutes, celle par laquelle toutes les autres Idées nous sont connues. La participation des idées aux choses sensibles, et qui explique le mélange des deux mondes, est présentée dans La République et le Philèbe. Dans le Timée, et cette fois à partir d'une dialectique descendante, Platon montre que la génération des choses trouve sa cause et son explication dans la génération des essences, des Idées, qui s'achemine vers un terme ultime sur lequel le démiurge a les yeux fixés en modelant le monde sur l'Idée du Bien. Le passage du monde sensible au monde intelligible est illustré dans l'allégorie de la caverne, qui explique comment se fait la conversion de l'âme vers les réalités supérieures. Empruntant au pythagorisme et aux anciennes traditions orphiques, Platon bricole sa théorie : Pour lui, connaître, c'est reconnaître, c'est se souvenir. Plus précisément se ressouvenir de ce que l'âme a contemplé dans sa pré-vie, alors qu'elle séjournait dans le monde des Idées : « S'il est vrai, comme tu le dis souvent, que, pour nous, apprendre n'est pas autre chose que se ressouvenir, c'est une nouvelle preuve que, forcément, nous devons avoir appris dans un temps antérieur ce que nous nous rappelons à présent. » (Phédon) Mais si « connaître, c'est reconnaître », cela présuppose que l'âme, qui habite le corps, préexiste au corps. Si l'âme préexiste au corps c'est convenir que l'âme est immortelle, c'est en conclure que, pour elle, habiter un corps, c'est participer au cycle des générations où tout ce qui vit meurt, puis renaît en quelque sorte de ce qui est mort, mais sous une autre forme. La théorie de la réminiscence est exposée pour la première fois dans le Ménon, où un jeune esclave est amené par lui-même (c'est-à-dire par Socrate, qui le met sur la voie par le questionnement, son art, qui est la maïeutique) à redécouvrir des vérités mathématiques dont il peut se rappeler parce qu'il porte en lui des opinions droites qui, réveillées pas le questionnement, deviennent des connaissances. Cette théorie de la réminiscence est reprise dans le Phédon à titre d'hypothèse servant à résoudre le problème de l'immortalité de l'âme. La théorie de la réincarnation est illustrée dans le Phèdre, qui assimile l'âme à un attelage ailé emporté dans un mouvement circulaire autour du ciel, où les âmes sont amenées à contempler les vraies réalités. Les âmes nourries d'intelligence qui se sont habituées à l'éclat éblouissant de ces réalités deviendront des âmes de philosophe ! Une existence antérieure, une âme immortelle, une incarnation de l'âme dans un corps … Nous voilà déjà conduits très loin! … Les âmes vagabondes En toute bonne logique, celui qui « rêve éveillé », comme le disait Voltaire, poursuit : Notre âme comprend trois parties, ou trois principes d'actions, comme l'État lui-même, qui est divisé en trois classes. Ces trois principes actifs sont : 1 ) La partie raisonnante (« la tête »). 2 ) La partie ardente (« le cœur »), reliée aux passions irascibles. 3 ) La partie désirante (« le bas-ventre »), celle des passions concupiscibles. Seule la partie raisonnante de l'âme (l'intellect) est immortelle. Les deux autres, enchaînées et prisonnières du corps, disparaissent avec la mort du corps. Dans le Phèdre, Platon compare l'âme à un « attelage ailé » attaché à deux coursiers, l'un docile, l'autre rétif aux ordres du cocher. Le cheval rétif est entraîné par les passions concupiscibles (les désirs et les appétits inférieurs). Il est mal bâti et indiscipliné. Le cheval docile, bon et généreux, est l'allié de la raison. Le cocher doit maintenir l'équilibre en dirigeant et guidant le bon cheval pour amener les deux chevaux sur le droit chemin. Par la raison, il doit détourner les désirs irascibles et concupiscibles pour les tourner vers la contemplation des idées. Les âmes pures peuvent s'élever à la connaissance des vraies réalités. Escortées par les dieux qui les accompagnent dans leur course, elles peuvent contempler la Beauté en soi, la Justice en soi, le Bien en soi. Les âmes impures, lourdes des désirs et des exigences de leur vie ici-bas, peinent à faire obéir leurs chevaux. N'ayant pu être initiées à la connaissance des vraies réalités, elles perdent leurs ailes et retombent sur terre, où elles viennent s'incarner dans un corps. Le méchant, chez Platon, c'est donc celui qui a misé sur le mauvais cheval. Quelle rigolade ! ... Morale du mythe, chez Platon (pour qui tous les mythes ont leur morale) : La rétribution des âmes est fonction de leur vie ici-bas : « Ceux qui ont vécu en pratiquant la justice obtiennent en échange une bonne destinée; ceux qui l'ont violée, une destinée mauvaise » Phèdre. La carotte et le bâton ! … : Seront récompensées les âmes des sages, des hommes vertueux, des philosophes. Seront punies les âmes des déraisonnables, des concupiscents. Punies, c'est-à-dire à migrer et à subir des réincarnations successives ! Parfois en devant séjourner dans un corps d'animal : « Ceux qui sont abandonnés à la gloutonnerie et à l'ivrognerie sans retenue entrent naturellement dans des corps d'ânes et de bêtes analogues. Ceux qui ont choisi l'injustice, la tyrannie, la rapine entrent dans des corps de loup, de faucon, de milan. En quelle autre place, à notre avis, pourraient aller des âmes de telle nature ? » (Phédon) Platon croit à l'immortalité de l'âme et à sa réincarnation (métempsychose). Il croit à la chute et au rachat des âmes selon le mode de vie auquel elles se sont abandonnées ici-bas dans leur combat contre l'élément charnel qui les rive et les enchaîne au corps. Cette conception qui préfigure déjà le christianisme et dans laquelle se trouve tous les éléments à mettre en œuvre dans une doctrine chrétienne, les premiers chrétiens parviendront à l'acclimater à leur mystique de l'âme et à leur eschatologie. « Platon pour disposer au christianisme », disait Pascal ... Grâce à Platon et à son disciple Aristote, celui qui a fourni à la religion chrétienne sa puissante armature, la filiation spirituelle qui assure à l'humanité le règne pérenne de l'esprit sur le corps ne peut être plus clairement et plus nettement affirmée. L'opération est lancée qui conduira à la floraison des doctrines idéalistes aux formes les plus vertigineuses qui vont s'épandre jusqu'à nous. La Cité idéale Il existe dans la Cité idéale de Platon la même hiérarchie que dans les âmes des individus. Trois classes dans la société qui correspondent aux trois parties de l'âme : 1 ) Les magistrats pour la partie raisonnante. 2 ) Les soldats pour la partie impulsive. 3 ) Les paysans et les artisans pour la partie désirante. Prudence (Sagesse), Courage, Tempérance sont les vertus essentielles qui doivent assurer l'harmonie de la société, la justice étant réalisée dans la société comme dans l'âme quand chaque classe joue son rôle et s'acquitte convenablement de sa fonction : « Une cité est juste quand chacune de ses trois classes s'occupe de ses propres tâches » (République). Comme la société est hiérarchisée selon un ordre de subordination des parties et des facultés les unes aux autres, et comme c'est la tête qui doit commander, le plus apte à gouverner, celui qui doit devenir son premier magistrat, ce serait le plus excellent de ses hommes, le modèle du sage et du juste, l'adversaire impitoyable des sophistes et le seul possesseur du savoir philosophique, celui qui pourrait éduquer les autres hommes et faire régner l'ordre dans leur âme comme dans la cité. Quand Platon nous parle d'un « gouvernement des philosophes », ou d'un « philosophe-roi », c'est toujours à son maître bien-aimé, Socrate, qu'il songe. N'est-il pas celui qui, au péril de sa vie, s'oppose au tyran Critias et contrevient à ses ordres pour éviter que ne se commette une injustice ? Celui qui tient son rang au siège de Potidée et qui se distingue par son courage en sauvant la vie d'Alcibiade ? Celui qui dans le Banquet, préfère l'amour des belles âmes à l'amour des beaux corps ? Celui qui, refusant de s'évader de sa prison malgré l'insistance de Criton, préfère mourir que d'enfreindre et de désobéir aux lois de la cité ? Socrate, le meilleur, le plus sage, le plus excellent des hommes, que la démocratie, le pire des régimes selon Platon, a mis injustement à mort, elle dont le mot d'ordre est la liberté qui conduit à la dissolution des mœurs et finalement à l'anarchie qui cause la perte de la cité. « Tant que les philosophes ne seront pas rois dans la cité, ou que ceux qu'on appelle aujourd'hui rois et souverains ne seront pas vraiment et sérieusement philosophes, il n'y aura de cesse, mon cher Glaucon, aux maux des cités, ni, ce me semble, à ceux du genre humain, et jamais la cité que nous avons décrite ne sera réalisée, autant qu'elle peut l'être, et ne verra la lumière du jour » (République) La comparaison est intéressante avec le passage suivant de la Lettre VII : « Les races humaines ne verront pas leurs maux cesser avant que, soit ait accédé aux charges de l'État la race de ceux qui pratiquent la philosophie de façon droite et authentique, soit que, en vertu de quelque dispensation divine la philosophie soit réellement pratiquée par ceux qui ont le pouvoir dans les États » Pour préserver l'ordre dans la cité et éviter sa décadence, ce qu'il craint le plus au monde, Platon imposera à la classe des soldats un communisme intégral : Les biens et les femmes devront être mis en commun, leurs enfants seront nourris et élevés par l'État. Des règles d'eugénisme seront appliquées : « Il faut selon nos principes rendre les rapports très fréquents entre les hommes et les femmes d'élite et au contraire très rares entre les sujets inférieurs de l'un et de l'autre sexe » (République) Les enfants handicapés et nés avec une déficience, la Cité devra s'en débarrasser : « Pour les enfants des sujets inférieurs, et même ceux des autres qui auraient quelque difformité, ils les cacheront dans un lieu interdit et secret, comme il convient » (République) Dans la cité idéale, écrivains et poètes seront surveillés de près : Il faudra se méfier tout particulièrement des « poètes imitateurs », qui seront chassés. « Si donc un homme en apparence capable par son habileté de prendre toutes les formes et de tout imiter venait dans notre ville pour s'y produire lui et ses poèmes, nous lui dirions qu'il n'y a point d'homme comme lui dans notre cité et qu'il ne peut y en avoir, puis nous l'enverrions dans une autre ville » Nul doute ici que Platon a toujours présent à l'esprit le poète comique Aristophane, qui, dans Les nuées, raillant Socrate, colportait une image plutôt négative du philosophe. Platon parle aussi dans les Lois de l'expulsion des poètes et des musiciens hors de la Cité idéale. Cela dit, mentir ou tromper est interdit, certes, mais pas entre les mains des gouvernants, pour qui le mensonge et la tromperie peuvent être aussi utile qu'un médicament : « Il y a chance pour que nos gouvernants soient obligés d'user largement de mensonges et de tromperies pour le bien des gouvernés et nous avons déjà dit que de pareilles pratiques étaient utiles sous formes de remèdes » (République) . Chaque classe enfermée dans son rôle naturel, qui correspond à son profil psychologique (la race « d'or », la race d'« argent » et la race de « bronze ») ! Un communisme intégral pour la race des gardiens ! Des règles d'eugénisme visant à maintenir la pureté des caractères ! La psychosociologie de Platon est franchement et proprement démentielle … Même si dans les Lois Platon abandonne son communisme intégral, il est tout à fait légitime de voir dans la Cité idéale de Platon le creuset du totalitarisme. . La politique, la morale et la philosophie sont inséparables chez Platon. La plupart de ses œuvres insistent sur la mission sociale du philosophe. Platon le réformateur, l'ennemi de la démocratie, celui qui caressait le rêve de devenir conseiller du prince, d'abord auprès de Denys l'ancien, puis auprès de son successeur, Denys le jeune, Platon n'a su imposer à sa cité ni sa morale, ni sa philosophie, ni sa politique. Les derniers mots de Platon nous font part de son pessimisme face à l'action des humains : « Nous sommes les marionnettes des dieux. Comme je l'ai dit à un moment antérieur de notre entretien, l'humain a été fabriqué comme un objet d'amusement pour la Divinité. Les choses humaines ne méritent pas d'être prises au sérieux » (Lois) C'est Philippe de Macédoine, qui, en s'emparant de la Grèce, mettra fin à l'aventure politique athénienne : la démocratie. Il faudra attendre plus de vingt siècles, pas moins, avant qu'un pays d'Occident ne se décide à tenter de nouveau l'aventure.
-
. Si tu ne vois pas trop d'inconvénient aux textes assez long pour décourager le premier lecteur venu, je vais placer sur ForumFr une note post-universitaire, une réflexion de jeunesse, sur Platon en personne, premier philosophie qui a réussi très tôt à me dégoûter profondément de la philosophie traditionnelle. .
-
. Oui, d'accord, Platon produit des dialogues, mais en réalité ces dialogues sont des monologues où les uns et les autre ont toujours tort lorsqu'ils le contredisent. Le système de Platon c'est l'art d'avoir raison face à ceux qui ont toujours tort grâce au système de Platon. À propos, connaît-on un seul paragraphe, une seule ligne de Platon où Démocrite apparaît dans ses «dialogues» ? Réponse : Platon ne mentionne jamais Démocrite dans ses dialogues, bien qu'ils aient été contemporains. Ce silence est d'autant plus frappant que Démocrite était l'un des penseurs les plus influents de son époque, notamment en physique et en éthique. En réalité, Platon manquait de couilles pour affronter Démocrite ! Platon et sa carrure ou son intellect de lutteur de pancrace, il ne savait terrasser que les absents ! ... .
-
. Ça y est, ça commence à déraper ... . Cela dit, oui, je m'intéresse à l'eugénisme pratiqué aujourd'hui en toute légalité grâce au diagnostic préimplantatoire. ... ... ... Cette déclaration est une preuve relativement gentille sur une ignorance de la génétique comportementale, ce qui est excusable car ce secteur de la science est trop récent pour que chacun en ai aujourd'hui une idée claire. De plus, le comportement consistant à considérer comme faux ce qui est nouveau est très connu, très fréquent, très argumenté, mais pas forcément juste ... Cela dit, comme je suis loin d'être un mauvais cheval, je vais tenter une explication. Liste des maladies génétiques à gène identifié : Voir et lire attentivement la liste donnée par Wikipédia si on a le temps, car les maladies génétiques qui y sont données sont nombreuses, très nombreuses. https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_maladies_génétiques_à_gène_identifié Liste des comportements dictés par l'ADN : En général les arguments servis contre ce secteur de la génétique comportementale portent sur les premières premières années d'études et de recherches scientifiques sur les comportements dictés par l'ADN. La raison en est bien simple : le prix des analyses génomiques était si élevé que les finances ont manqué pour que des échantillons assez importants puisse servir à exprimer la moindre conclusion. C'est par le manque d'argent que la génétique comportementale a fait faillite il y bien longtemps. À noter. Dans le petit film que tu proposes pour appuyer tes arguments, on voit qu'avec le temps passé entre les choses dont parle la sympathique conférencière et aujourd'hui, il s'est passé au moins 20 ans. Et pendant 20 ans, la génétique comportementale s'est développée à un rythme difficile à imaginer si on ne s'y est jamais intéressé. Par exemple, le prix du séquençage du génome est aujourd'hui de moins de 100 $, ce qui a permis d'obtenir des échantilons non pas de dizaines ou centaines de sujet mais de millions. La taille de ces échantillons a permis de se rendre compte avec exactitude des diverses interactions polygéniques au sein de l'ADN. La taille de ces échantillon a permis d'étudier le comportement non pas de quelques dizaines de jumeaux monozygotes ou dizigotes, mais de quelques millions de ces jumeaux. Par ailleurs, notre sympathique conférencière commet une erreur phénoménale sur la soi-disant séparation de la génétique et de l'environnement. La vérité, c'est que la génétique commence par déterminer un comportement et que c'est ensuite que ce comportement détermine un environnement. Cela dit, les explorations de l'influence phénoménale de l'ADN sur les comportements concluent toujours par des probabilités et pas des certitudes absolue. Aujourd'hui, la probabilité d'une influence sur les comportements est d'environ 50 %, et à mesure que le temps passe cette probabilité se stabilise à un pourcentage de 70 à 80 %. Cela veux dire que l'influence de l'environnement sur les premières années de l'humain est de 50 %, mais qu'il passe à 30 % et 20 % à mesure que le temps passe. Il faudra lire la deuxième édition du livre de Robert Plomin, Pape consacré en génétique comportementale par moi et ma petite personne, car la première édition est déjà obsolète, et ne pas rater la troisième édition, qui rendra la deuxième obsolète aussi. Hé oui, la science est un sacerdoce. C'est un sacerdoce dont le dogmatisme ne se fixe jamais. C'est un sacerdoce dont, paradoxalement, le dogmatisme est en constante évolution. Salut, brave camarade ! ... ... ...
-
. La théories des idées de Platon se trouve en toutes lettres dans ses livres : La République, notamment à travers l’allégorie de la caverne. Le Phédon, où Platon décrit l’âme comme prisonnière du corps et aspirant à rejoindre le monde des Idées après la mort. Le Phèdre, où il évoque l’âme contemplant les Idées avant de s’incarner. Le Timée, qui propose une cosmologie où le monde sensible est une image imparfaite d’un modèle intelligible, celui des Idées. Nietzsche, l'antéchrite le plus parfait, disait que le christianisme, c'était Platon expliqué aux imbéciles. C'est de lui que je tiens le syntagme nominal «monde vrai». J'en ai déduit son contraire, le «monde faux». Il est toutefois vrai que les plus nombreux commentateurs de Platon (et d'Aristote) se sont les théologiens des deux monothéismes que sont le christianisme et l'Islam.
-
. Peut-être pourrait-on voir comme Platon le guide extrayant de leur cavernes les dupes de leurs illusions. Dans notre cas, ce guide dont parle Platon, ce serait celui qui maîtrise aujourd'hui la générique comportementale, ce ne serait certainement pas le philosophe d'un Platon ayant déclaré comme un imbécile que le monde des idées était le monde vrai, et que donc le monde des sensibilités était le monde faux ... Cela dit, l'idée de songer à ce qu'est un gène ne me colonise pas l'esprit tant que ça. Ce qui m'intéresse, ce sont les conclusions des études sur l'influence des gènes sur les comportements humains, et sur leurs maladies aussi. Ce qui m'intéresse, c'est la possibilité de comprendre que depuis qu'il est possible de lire dans les gènes comme dans un livre ouvert les comportements et les maladies d'un être humain dès sa naissance, alors il est possible de changer l'essence de la médecine actuelle et passer du diagnostic et de l'intervention palliative d'aujourd'hui à la médecine préventive de demain, qui d'ailleurs a commencé dans certain des plus grands hôpitaux du monde, ceux dans lequel on demande déjà aux patients s'ils consentent à une analyse génomique de leur carcasse pour voir l'avenir de leur santé et intervenir avant qu'elle ne se détériore sous l'influence dictatoriale de leur génétique. .
-

La philosophie se moque de la philosophie
mary.shostakov a répondu à un(e) sujet de mary.shostakov dans Philosophie
... ... ... Les charabias forment la raison d'être des arborescences propres à tous les forums de discussion de la planète et d'ailleurs. Le sujet c'est UNE philosophie, celle du secteur matérialiste de la pensée, qui se moque d'une AUTRE philosophie, celle du secteur idéaliste de la pensée. ... ... ... Diogène de Sinope se reposant un peu avec de continuer à chercher à la lanterne et en plein jour l'homme décrit par cet imbécile de divin Platon. ... ... ... -
... ... ... ... ... ... L'heure d'été est extrêmement agaçante. Existe-t-il une meilleure alternative ? Lorsque les horloges de la plupart des États-Unis ont « avancé » plus tôt ce mois-ci pour marquer le début de l'heure d'été, de nombreuses personnes se sont réveillées groggy, irritables et avec l'impression d'avoir perdu une précieuse heure de sommeil. Il n'est donc pas étonnant que 54 % des Américains souhaitent abolir cette pratique. Certains législateurs ont proposé de « figer l'heure » et de faire de l'heure d'été la norme nationale permanente grâce à des lois comme le Sunshine Protection Act ; les spécialistes du sommeil s'opposent fermement à cette idée, estimant que des matins trop sombres et des soirées trop lumineuses perturberaient dangereusement le sommeil des gens. De nombreuses organisations médicales et scientifiques plaident plutôt pour une heure standard permanente, qu'elles considèrent comme mieux alignée sur les rythmes naturels du corps. En réalité, il n'existe pas de consensus au sein des cercles académiques, mais dans un article provocateur publié la semaine dernière dans Royal Society Open Science, deux physiciens soutiennent que les problèmes du système actuel sont peut-être exagérés—et qu'il permet de concilier l'emploi du temps rigide dicté par l'horloge avec des heures de lever du soleil qui varient tout au long de l'année, offrant ainsi aux gens la possibilité de profiter pleinement de la précieuse lumière du matin. Cependant, de nombreux autres experts estiment que cette perspective minimise les risques associés au changement d'heure, notamment l'augmentation du risque de crises cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux, d’accidents de la route et de blessures sur le lieu de travail. L'heure standard permanente pourrait être une solution imparfaite, avancent-ils, mais elle pourrait aussi être la plus logique d’un point de vue de santé publique. ... ... ...
-
. Trump affirmait haut et fort qu'il ne supportait pas que des gens meurent à cause de la guerre. Encore un mensonge. Sur le journal relatant cette affaire, il y a l'ordre à plus de 500000 latino-américains de quitter les USA dans les jours qui viennent même s'ils vivent aux États-Unis dans la plus parfaite des légalités ! Ça rappelle l'ordre donné au juifs de quitter l'Espagne dans les plus brefs délais par la Reine de Castille et le Roi d'Aragon en 1492. Quel progressiste, ce Trump ! Quel intelligence ! Quel génie ! Cela dit, c'est peut-être trop gros pour être vrai, mais avec Trump, plus c'est gros, plus c'est vrai ! .
-
... ... ... Comme si la science la plus exigeante empêchait les scientifiques de s'attendrire par une larme devant un coucher de soleil au printemps des jours s'allongeant après la saison des pluies ou de la neige, ou devant un écureuil se cachant derrière un arbre à l'avancée d'un chat voulant lui faire son affaire main n'y parvenant jamais, ou même face à une nuit étoilée créée sur du bois ou de la toile par un fou nommé Van Gogh ou Gauguin, ou encore à l'écoute d'un stradivarius ou d'un guarneri produisant une suite de Paganini ou Vivaldi ! Depuis quand la science la plus exigeante a-t-elle empêché Einstein ou Barrau de nous sortir Bach ou Haiden ou bien la philosophie de Spinoza ou Démocrite ? Depuis quand la science la plus exigeante a-t-elle empêché Lehrer de lire Proust, Luminet d'écrire un roman sur Copernic, d'Isamov de produire une saga littéraire sur les robots et l'intelligence artificielle ? La philosophie des sciences n'a jamais empêché d'être heureux de vivre tous les nouveaux mondes que sont les galaxies possibles par l'essence d'un seul homme, d'une seule femme, d'un seul enfant. Soit heureuse, mon amie, soit heureuse grâce à la vérité et grâce aussi à l'art, mon amie ... ... ... ...
-
-
... ... ... Le matérialisme scientifique n’est autre que la philosophie logiquement appropriée à l’activité scientifique étant donné ses méthodes et ses résultats. Cette activité exige, en effet, une discipline dans la tenue des raisonnements, un comportement dans la mise en scène de l’expérimentation, une ascèse dans le choix des hypothèses et des concepts, une volonté ininterrompue dans le développement de la menée de l’ensemble de la procédure cognitive. Angèle Kremer-Marietti Cette dame, hé ben moi je l'aime. … … ...
-

Pensée maîtresse d'une maîtresse à penser
mary.shostakov a répondu à un(e) sujet de mary.shostakov dans Sciences
... ... ... -
... ... ... L’homme est un animal social, un animal politique et un animal moral. Est-ce à dire que la science, et plus particulièrement la biologie, peut nous éclairer sur la dimension éthique de l’existence humaine ? On a longtemps pensé que non. C'est peut-être à partir de cette « exceptionnalité » que peuvent s'expliquer les retards de la psychologie morale humaine, trop longtemps engluée dans un rationalisme quasi-mystique. Mais les progrès en primatologie, génétique, neurobiologie et autres disciplines « chapeautées » par la théorie de l’évolution ont bouleversé la donne, et ont provoqué des changements de perspective en philosophie des sciences et épistémologie. Non seulement la biologie peut expliquer l’émergence de la morale, mais certains pensent qu’elle a aussi son mot à dire sur le contenu de celle-ci. Une approche biologique de la morale est-elle légitime ? Tout un courant de pensée, déjà ancien, a répondu à cette question par la négative. Le raisonnement «antinaturaliste» peut se simplifier ainsi : l’originalité humaine procède de la culture, qui est un détachement progressif de la nature. L’homme trouve son humanité dans un processus d’arrachement au déterminisme biologique, dont le libre-arbitre est la plus pure expression. L’homme n’a donc pas d’autre nature que celle qu’il se donne par ses constructions individuelles et sociales : il naît vierge de toute préprogrammation. Tout n’est que convention, artifice – tout sauf quelques données élémentaires qui intéressent tout au plus la physiologie, l’anatomie ou la médecine. Cette idée jadis populaire est fausse. On a redécouvert l’importance de la composante biologique des traits et comportements humains. Sous l’égide de la science, et non plus de la philosophie. Dès lors, l’antinaturalisme se trouve de plus en plus contesté par les scientifiques eux-mêmes, secondés de philosophes, et ce mouvement s'est accéléré depuis le dernier quart du XXe siècle. Le coup d’envoi symbolique de l’assaut contre la forteresse «antinaturaliste» a été donné en 1975, lorsque Edward O. Wilson fait paraître une œuvre monumentale : «Sociobiology, the New Synthesis». Ce chercheur américain provoque alors l’une des plus importantes controverses scientifiques du siècle passé. Il se fait le porte-parole de tout un courant de recherche né dans les années 1960, notamment avec Desmond Morris, visant à comprendre les bases biologiques des comportements sociaux et incluant l’homme dans le champ légitime de ses travaux. Trois vagues successives vont remettre au goût du jour les explications naturalistes de la morale. Une première vague, née dans les années 1960, est un renouveau du darwinisme appelé néodarwinisme, dont les représentants les plus connus sont William Hamilton, George Williams, Richard Dawkins, Robert Trivers et Edward O. Wilson lui-même. Ces auteurs et d’autres opèrent trois révolutions intellectuelles. D’abord, ils postulent que le schéma darwinien de survie du plus apte (variation-sélection-adaptation) explique aussi bien les traits physiques que les comportements complexes (psychologiques notamment). Ensuite, ils considèrent que l’adaptation biologique (la «fitness» darwinienne) s’exerce au niveau de l’individu et non du groupe. Enfin, ils font l’hypothèse que la sélection différentielle se comprend quant à elle au niveau du gène, seule unité réellement transmise par l’hérédité. Appliqué (grossièrement) à notre sujet, le raisonnement néodarwinien donne ceci : la morale est un comportement codé par des gènes, qui a été sélectionné au cours de l’évolution car il favorisait la survie des individus qui en étaient porteurs. Une deuxième vague, se développant à partir des années 1970, est issue de l’étude du comportement des animaux (l’éthologie) et plus particulièrement de l’analyse de nos plus proches cousins, les singes (la primatologie). Un certain nombre de chercheurs, dont les plus connus sont Frans de Waal, Jane Goodall ou Christopher Boehmvdans le monde anglo-saxon, Jacques Vauclair ou Dominique Lestel dans la francophonie, ont souligné la présence chez les animaux de comportements moraux ou proto-moraux dépassant le simple cadre de l’anecdote. Chez les grands singes notamment, observés à l’état sauvage ou en captivité, les interactions individuelles laissent place à des logiques d’empathie, d’altruisme et de réciprocité qui évoquent fortement ce que les humains qualifient de «morale». Ces observations suggèrent logiquement que cette dernière est issue de l’évolution biologique plus que d’une création culturelle humaine sui generis. Une troisième vague scientifique a contesté la position antinaturaliste à partir des années 1980. Celle-là est venue de la psychologie et des sciences du cerveau. Elle retrouve le darwinisme de la première vague sur certains points, mais s’intéresse d’abord aux explications neurophysiologiques et développementales de la morale — comme de l’ensemble des traits complexes de la cognition humaine : mémoire, intelligence ou langage. Ses représentants les plus connus sont Jean-Pierre Changeux, Antonio Damasio, Joseph LeDoux, John Tooby, Leda Cosmides ou encore Michael Gazzaniga et Robert Plomin. La question posée ici est : quelles sont les zones fonctionnelles du cerveau impliquées dans le jugement moral ? Et subsidiairement : en quoi cette neuro-anatomie de l’éthique nous aide-t-elle à comprendre les fondements de l’activité morale ? Anthropologues, psychologues, généticiens, neurobiologistes, zoologistes… les travaux des auteurs que nous venons de citer sont de nature scientifique. Comment échappent-ils à la supposée «erreur naturaliste» de leurs prédécesseurs ? De plusieurs manières. D’abord, la critique de l’erreur naturaliste reposait elle-même sur un certain nombre d’erreurs, notamment une conception erronée de la nature humaine. À moins de défendre une position religieuse ou métaphysique, tous les faits à notre disposition laissent penser que l’homme procède de l’évolution biologique au même titre que toutes les autres espèces vivantes sur Terre. Tous les traits humains, sans exception, possèdent une base matérielle, moléculaire, cellulaire, qui influe sur leur expression. L’existence de cette influence n’est plus guère niée, même si sa nature exacte reste l’objet de l’investigation scientifique. Ensuite, les scientifiques ne prétendent pas émettre un jugement de valeur sur le contenu concret, prescriptif de la morale (et de la politique). ... ... ... Peggy Sastre est docteur en philosophie des sciences. Le sujet de sa thèse de doctorat a été le suivant : Généalogies de la morale : perspective nietzschéenne et darwinienne sur l'origine des comportement et des sentiments moraux Résumé de cette thèse : Nietzsche comme Darwin envisagent la morale de manière évolutive, comme l'héritage temporaire de diverses sédimentations successives. Nietzsche comme Darwin remettent à plat toute une tradition antérieure, philosophique pour l'un, biologique et naturaliste pour l'autre. Tous deux poussent à voir la morale, certes comme un ensemble de règles et d'interdits structurant une société, mais comme un ensemble relatif, déterminé par des contextes, des environnements, des physiologies extra-morales. Le philosophe, comme le scientifique, eux mêmes inscrits dans une histoire et une évolution toujours inachevée à l'heure actuelle, font exploser les normes et les catégories morales anciennes, qu'elles soient métaphysiques, révélées, éternelles, fixes et définitives. Et tous deux, en observant, expliquant et critiquant la morale, provoquent une interrogation sur ses marges et son dépassement, par-delà d'ailleurs la science et la philosophie : qu'est-ce que l'individu pour le troupeau, qu'est-ce que l'homme pour son espèce ? Elle a publié une douzaine de livres. Les plus remarquables sont Ex Utero, La Haine orpheline et Ce que je veux sauver, son dernier livre, qui fait un tabac en France et hors de France aussi. ... ... ... Par ailleurs, Peggy Sastre a quelque choses qui la rend exceptionnelle à mes yeux : C'est ma copine ! ... ... ...
-

La philosophie se moque de la philosophie
mary.shostakov a répondu à un(e) sujet de mary.shostakov dans Philosophie
. Inutile de croire que je reprends tes propos. . -

La philosophie se moque de la philosophie
mary.shostakov a répondu à un(e) sujet de mary.shostakov dans Philosophie
. Nul doute que ça a dû intéresser les chiens errant par ci par là. . Tu te trompes de sexe, mon vieux, tu te fie trop aux apparences, mon p'tit vieux, même lorsque tu t'exprimes sur Michel Onfray en imitant lamentablement Bernard Henri Lévy, qui traite Michel Onfray de nazi comme tous les demeurés se prenant pour «quel qu'un». Si la culture française me réjouit hors de tout propos, je l'assure absolument, la politique française me dégoûte carrément ! Ha, tiens, elle dégoûte aussi les auteurs des articles parus dans la revue Front Populaire, as-tu remarqué ? . -

Claudia Sheinbaum : la présidente du Mexique vs. Donald Trump
mary.shostakov a répondu à un(e) sujet de Black Dog dans International
. Tout en travaillant intelligemment pour le Mexique, Claudia Sheinbaum rejoint la coalition des pays ex-amis des États-Unis qui ont choisis de diminuer, voire abolir, tout commerce avec les Américains. Aujourd'hui les fruits et légumes que les canadiens achetaient à la Californie et à la Floride sont importés du Mexique dans le cadre de l'ex-Aléna, ex-marché de libre échange entre les trois pays nord-américains. Les produits minier dont le Canada regorgent sont de moins en moins vendus aux Américains et de plus en plus vendus aux Mexicains, toujours dans le cadre du même ex-libre échange. La volonté des Canadiens et Mexicains de commercer avec les pays d'Asie et d'Europe s'accentue de jour en jour. Les rencontres diplomatiques avec ces continents sont de plus en plus fréquentes et portent souvent sur des approvisionnements d'armes hors USA. . -

La philosophie se moque de la philosophie
mary.shostakov a répondu à un(e) sujet de mary.shostakov dans Philosophie
. Je reconnais le discours qui me fait affirmer que nul n'est prophète en son pays. . Pour mémoire, au sujet du Parraire dont tu parles. Michel Onfray avait été invité pour donner une conférence sur Albert Camus, par pour discuter avec le premier imbécile venu avec un livre intitulé «Michel Onfray, une imposture intellectuelle» qui en disait long sur son intention de démolir le discours d'Onfray. Michel Onfray, s'est alors tourné vers celui qui l'avait invité en vue de donner sa conférence sur Camus. Il lui a déclaré en substance «Soit vous renvoyez ce type, et je donne ma conférence comme prévu, soit vous acceptez ce type et donc je m'en vais et ne donne pas ma conférence.» C'est celui qui l'avait invité qui a renvoyé ce Paraire que je considère comme un imbécile fouilleur de poubelle pour se faire un peu de blé malgré toute la politesse dont je suis habituellement capable. . Mon pseudo, «Mary Shostakov», est un prétexte permettant de débusquer facilement ceux qui croient aux apparences pour faire les malins, mon p'tit vieux ... . -

Je me relance dans la construction d’avion en structure…
mary.shostakov a répondu à un(e) sujet de SpookyTheFirst dans Bricolage et Déco
. Pour la colle, je me suis laissé dire par des experts en modèle réduit du genre que tu entreprends que la colle cyanocrilate était aujourd'hui employée à cause de sa légèreté phénoménale. Il suffit de monter la structure à sec en la maintenant bien immobile aux aiguilles habituelles et de placer une goutte de cyanocrilate à chaque joint. Cette colle s'introduit par capillarité. Mais il faut faire attention au grade de dureté et de séchage des diverses colles proposées dans le commerce, avec certains durcisseurs adaptés à ce qu'on veut faire. Ça devient compliqué, mais il n'y a pas mieux, question légèreté, me disent les copains maquettistes et modélistes. . À propos de «la source des inventions», je me procurais les matériaux grâce à la vente par correspondance, et grâce à une petite publicité qui paraissait au dos du magazine MRA (Modlèe Réduit d'Avion), qui publiait régulièrement un plans à l'échelle 1 en encart de fin de pages. J'ai conservé l'un de ces plans. Tu me donnes envie de m'y remettre. Ma parole ! .