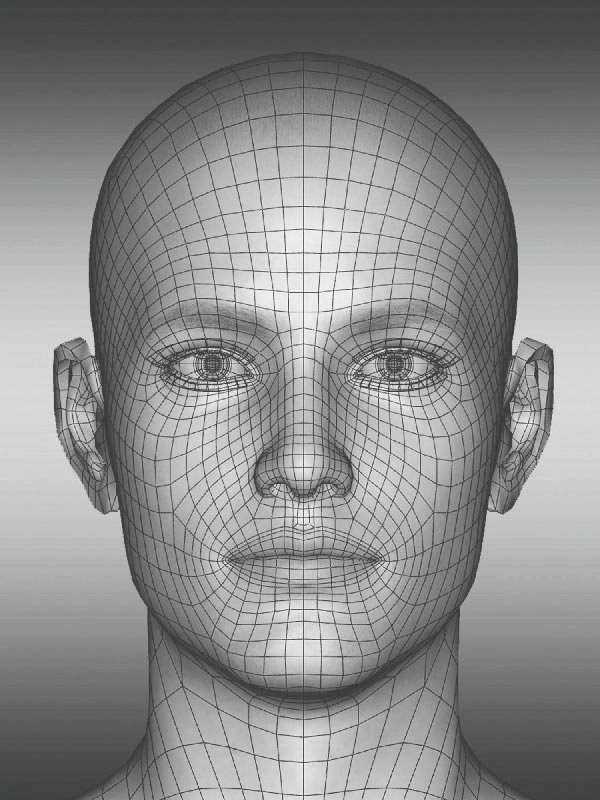-
Compteur de contenus
1 420 -
Inscription
-
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Blogs
Calendrier
Vidéos
Quiz
Movies
Tout ce qui a été posté par Guillaume_des_CS
-
Dans ce cas, pardonnez-moi de vous dire que comprendre "votre" monde ne m'intéresse pas (trop d'obligations, de règles de vie, d'obéissance, de prérequis... pour moi). J'ai quant à moi envie (et besoin) de comprendre le monde dans lequel je vis, c'est-à-dire le monde (minimaliste) dans lequel nous vivons tous ensemble. Je ne ressens aucun besoin de le redessiner à l'image d'une interprétation personnelle que j'en ferais. Désolé, incompréhensible pour moi. Je ne suis pas "philosophe". Je ne sais pas comprendre tous les sous-entendus de votre affirmation, ce qui fait qu'elle m'est totalement incompréhensible. Quand, de mon côté, je définis "mon" "je", je le fais sans le moindre sous-entendu... C'est une lapalissade, non? Qui n'est pas d'accord avec cela? Mais où est votre effort de clarification pour y atteindre?
-

4 principes tout simples pour... changer de monde ?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
MERCI en tout cas! Un grand merci pour ce retour. Il m'est TRÈS PRÉCIEUX! "...c'est moi qui fait parce que j'en ai décidé ainsi librement...": Oui, on peut en tirer cette conclusion, mais ce n'est pas sa signification première. La signification première serait plutôt: "tout" n'existe [pour moi] que parce que je peux le percevoir; ou encore: "je" ne peut être périphérique, accessoire, satellite, etc., de quoi que ce soit. Pour l'illustrer (quand je parle à des amis), je pose souvent la question (simpliste et naïve) suivante: que devient, pour toi, "tout" ce qui t'entoure lorsque tu meures? Et 9 fois sur 10, mon interlocuteur n'entend pas "pour toi" et me répond: tout continue comme avant... Or, évidemment, si la question est bien: que devient, pour toi..., la réponse ne peut être que: tout disparaît avec moi. N'est-ce pas? Ok, quel est l'intérêt de constater ainsi que notre perception du monde disparaît avec nous lorsque nous mourrons? Et surtout, peut-on en déduire quoi que ce soit sans basculer dans le sophisme? L'intérêt est double: d'abord poser le [simple] constat d'une évidence. Ça a l'air ridicule, mais il me semble que c'est fondamental dans le raisonnement philosophique (et en tout cas ça l'est dans le raisonnement systémique, qui est le mien). On peut discuter (ici) cette évidence en arguant que personne ne sait ce qui se passe après la mort, etc., mais cela ne changerait rien à l'impact rétroactif (dans la vie) de l'évidence elle-même. Je veux dire par là que quoi qu'il se passe après la mort (qu'on ne connaît pas donc), on ne peut jamais en tirer la moindre conclusion quant à la façon dont cela pourrait impacter la vie. Nous avons donc là, selon moi: le constat d'une évidence solide: après ma mort, pour moi, "tout" aura disparu avec moi. Mais bien sûr, "je" (tous les autres "je" qui peuplent ce monde, et pas seulement les "je" humains) étant le centre de "tout", "tout" continuera d'exister pour tous les "je" du monde. De très nombreuses implications découlent de cette dernière affirmation mais les développer ici prendrait des plombes (et des dizaines de pages). Je le fais dans le livre, de façon très incomplète cependant, car nous entrons alors dans le domaine de la prospective économique et sociale. Or, je ne suis pas prévisionniste et encore moins devin... Le deuxième intérêt de constater ainsi que notre perception du monde disparaît avec nous lorsque nous mourrons, est... stratégique! En effet, ce constat sert un dessein. Ce dessein, je l'explique dans mon autre post récent ("L'hypothèse K"). L'ensemble de la proposition que je fais constitue une théorie. En schématisant (beaucoup) pour pouvoir la rendre un tant soit peu intelligible au commun des mortels, je lui fais dire "qu'on peut tout changer sans rien casser en appliquant seulement quatre petits principes à chacune de nos décisions". Or, ces principes rentrent dans l'hypothèse de la théorie (l'induction). Ils n'ont donc pas à être "prouvés". Ils ont par contre à être "bien compris", c'est-à-dire qu'ils doivent prendre le même sens pour tous. Peu importe en fait ce qu'ils expriment/représentent (d'où j'écris aussi, dans le livre, qu'on pourrait même les changer...) pourvu que nous soyons tous d'accord sur le sens qui leur est donné. Toute théorie, toute, est toujours (au départ de son élaboration) basée sur ce genre de postulat (que ce postulat relève de "l'état de l'art", de la connaissance scientifique "actuelle" ou de la pure hypothèse – car la théorie a aussi vocation à vérifier l'hypothèse...). Je n'invente donc rien ici, ce qui me donne à penser que le risque de sophisme (pris ici au sens de "faux raisonnement qui a l'apparence de la vérité") est écarté. Mais si tu, ou un-e autre, voit ce risque (ici ou ailleurs), alors évidemment je suis très intéressé de ton/son analyse. C'est essentiel pour moi. Je n'ai rien à vendre, et je veux être sûr de la fiabilité [théorique] de ma théorie avant de [essayer] la diffuser réellement... L'enjeu est à mes yeux humaniste, et non commercial, et encore moins "idéologique" (au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire "manipulatoire"). Maintenant, lorsque tu déduis de " "je" est le centre de tout", -> "...c'est moi qui fait parce que j'en ai décidé ainsi librement...", mais que tu ajoutes: "...à mon sens, je me mens...": je te rejoins sur le premier point (c'est une déduction possible du principe, bien que nous changions alors de plan d'analyse), et respecte ton ressenti exprimé dans le deuxième point. "je" est le centre de tout, donc... "...c'est moi qui décide librement de "je" et de "tout": c'est ainsi que je reformulerais pour m'assurer de t'avoir bien comprise. Si je t'ai bien comprise (si je peux donc reformuler ainsi), à mes yeux: le premier principe K aurait pu s'écrire ainsi (tel que reformulé) si... cette reformulation n'en réduisait pas le champ de façon considérable! (Or, un principe a vocation... universelle!) En effet, mon premier principe et la compréhension que tu en as (la reformulation) disent bien la même chose, mais le seul fait d'invoquer la "liberté de décision" en réduit le champ à "la liberté de décision" (les paramètres de l'acte de décider). Or le champ de mon principe est universel: "je" est le centre de "tout"... C'est donc également vrai dans le champ de "la liberté de décision", mais aussi partout ailleurs (liberté de penser, liberté d'aimer, liberté de haïr, liberté de mourir, etc. etc., mais aussi liberté d'entraver ma propre liberté pour jouir davantage et parfaitement [nous allons en parler...] et/ou pour assumer pleinement mon pouvoir de liberté totale en acceptant mon devoir de responsabilité totale [nous allons en parler...]...) [Bon, ta critique est très précieuse et très riche. Il me reste beaucoup de points à adresser. Je veux le faire de la façon la plus respectueuse possible, donc la plus précise possible. Je ne peux le faire dans l'instant. Je reviendrai le plus vite possible. Merci de ta patience Et merci aussi de m'offrir le plaisir d'échanger avec une personne à l'esprit critique ouvert!...] -
D'accord (presque) avec la deuxième partie: dans ma langue, "la" vérité n'existe pas. Pour la première partie: le mot "obligatoire" me... terrifie! Quel sens lui donnes-tu réellement (dans ce contexte)? Je suis bien incapable de différencier la personne de l'individu. Pour le faire, il me faudrait ajouter un qualificatif à chacun de ces deux mots. Ou alors en donner (dans le contexte) la définition précise, l'acception que je leur donne... Je ne peux donc comprendre le sens de ta phrase, et ne peux me positionner. Idem. Je veux dire: qu'est-ce alors qu'un individu selon toi? Comment souscrire (ou critiquer) tes conclusions sans savoir de quoi l'on parle? C'est dommage d'ailleurs (cette imprécision latente) car j'ai l'intuition que le sens caché pourrait me faire progresser vers quelque chose de nouveau (pour moi)...
-

4 principes tout simples pour... changer de monde ?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Je réponds "à chaud" n'est-ce pas? Je veux dire par là que je me réserve de changer d'avis (ou de me contredire...) "...on ne peut répondre de ce qu'on n'a pas choisi...": là, pourrait être notre point de divergence (fondamentale, le cas échéant) car je me range du côté de La Boétie (même la servitude serait volontaire!): on choisit tout ce que l'on vit (selon moi). Dès lors, je peux être d'accord: la liberté est contingente de la responsabilité (vu sous cet angle). -
"Moraligions" & "Idéologie" ?... Pourquoi vouloir à ce point "une" vérité?
-

4 principes tout simples pour... changer de monde ?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Pardon, mais non. Le 3ème principe ("Il n'est de responsabilité qu'individuelle") n'implique pas "une liberté totale de l'individu". Il implique, au contraire, une dépendance totale de l'individu en regard du principe de "responsabilité". Ni K... ni moi-même (j'expliquerai cette "distanciation" volontaire quand le besoin s'en fera sentir...) ne parlons jamais de "liberté" (en regard des principes). Ce mot est bien trop imprécis et polysémique aujourd'hui. Nous parlons "d'autonomie". Or, l'autonomie n'est pas liberté, mais bien "responsabilité" (adversité, solitude, survie, etc.) Cela dit, il me semble que vous vous engagez dans la même "erreur" d'interprétation que @Zerethoustre: K... ne propose pas un nouveau conformisme social qui engendrerait une nouvelle "moraligion". Il propose au contraire de dépasser (transcender) le système actuel (le "blockhaus") en cherchant à atteindre des "buts" ("utopistes", au sens premier du terme) situés justement à l'extérieur ("au-delà", mais aussi "en-deçà"...) des piliers du "blockhaus", à savoir des "moraligions" et du "conformisme social" (et des deux autres). Les piliers du blockhaus ne sont pas des objectifs de la "théorie K"; ils sont des fondamentaux incontestables (des inductions?) de l'état du système à modifier. Il n'est jamais question de les reproduire ou les modifier eux-mêmes. Il s'agit juste de constater qu'ils sont là, et qu'ils sont fondamentaux... Et bien sûr: de les relativiser dans un nouveau système... (relativiser leur impact sur le fonctionnement du nouveau système). -

4 principes tout simples pour... changer de monde ?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Je n'en suis pas certain... L'avons-nous fait (dans l'histoire de l'humanité)? Avez-vous un exemple d'une société humaine (une civilisation?) qui se soit construite sur la base d'une unanimité résultant de cette démarche individuelle? N'avons-nous pas au contraire créer nos "divinités" (acceptées ici au sens le plus large...) pour leur confier cette responsabilité? Et nous en dédouaner (notamment de ses impacts...) par la même occasion? Cela dit, j'espère quand même que vous avez lu ma(mes) proposition(s) et ne me faites pas procès de vouloir dicter/initier quelque morale ou religion que ce soit... Sinon, ce serait m'avoir bien mal lu, et surtout bien mal comprendre le sens des premiers et troisième principes K. (sens que j'ai quand même déjà beaucoup explicité dans différents posts, mais que je peux réexpliquer [plus sommairement]ici si vous le souhaitez...) Assez d'accord avec vous, si tant est que vous puissiez comme moi considérer cette déconstruction sans violence, c'est-à-dire sans destruction. Autrement dit: pas forcément totale (mais fondamentale), et pas forcément "frontale"! L'inefficacité de la méthode "frontale" (révolutionnaire) me semble avoir été tout autant démontré que l'inefficacité de la méthode "théorique" (le discours philosophique, la rhétorique...). D'où cette nouvelle approche que je propose: le jeu! (L'action indirecte par le jeu?) Merci pour l'étymologie de "société", mais je n'y vois pas de lien direct avec "déséquilibre". Après, c'est un détail à mes yeux. Il est certain que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui est TOTALEMENT déséquilibrée. Elle l'est à un point telle qu'elle pourrait finir par voler en éclats... Donc, de mon point de vue: vous et moi sommes d'accord sur ce qui importe c'est-à-dire sur ce à quoi nous devons proposer des pistes de réflexion ? C'est peut-être la raison pour laquelle je vous propose (à tous) de réfléchir avec moi? De critiquer ma proposition? (Critiquer son contenu...) -

4 principes tout simples pour... changer de monde ?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Quand il les construit lui-même, individuellement?, et n'a pas en conséquence à les subir (comme les fruits d'une entité constituée par un "collectif" d'individus (autres que lui-même))? Pourquoi? Sur quoi basez-vous cette affirmation? Qu'elle soit un champ de conflictualité est une chose; en déduire qu'elle est par nature déséquilibrée en est une autre (à mon entendement en tout cas). Par ailleurs, je vous fais cordialement observer que la proposition K ne consiste JAMAIS à rendre l'individu plus autonome et responsable en le guidant par la morale et la religion, mais bien au contraire en positionnant des principes d'action au-delà des piliers de la société actuelle (dont les "moraligions")... -

4 principes tout simples pour... changer de monde ?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Bon, puisque tu me poses la question de définir mon "je", je te donne ici un extrait (non encore publié sur ForumFr) de K... (le livre) dans lequel je définis à la fois "je" et "Je"... Désolé si c'est un peu long, mais je pense qu'il s'agit d'un point crucial, et au vu de vos échanges à toi et à @hell-spawn, je pense que vous serez d'accord. Merci de lire cet extrait tranquillement (car il y a beaucoup de choses...). Toutes questions sont bienvenues évidemment... Début de l'extrait: "Parfait. Nous pouvons commencer la dissection... — Commençons par cette entorse à la grammaire, ce bannissement de la capitale... — Voilà : "je" n'est pas "Je" ; pour Kovanien, "je" représente l'individu intime que perçoit en lui-même chacun d'entre-vous. Il le différencie de "Je", qui pour lui représente l'individu social qu'est aussi chacun d'entre-vous. Le premier est spontané. Le deuxième est fabriqué. Les deux sont légitimes, mais différents... Ils ne s'opposent ni ne se contrarient naturellement, mais artificiellement, culturellement. Je dirais même "arbitrairement", pour la seule commodité du blockhaus dont l'intention première est de remplacer "je" par "Nous". Et "Nous" n'est pas davantage "nous" dans la même logique kovanienne... — Puis-je...? — Je t'en prie... — "je" serait unique quand "Je" serait multiple ? — C'est une autre façon de le dire en effet. "Je" est synonyme de "Moi", et ce dernier ne peut se définir qu'en rapport à l'autre. Nous sommes donc déjà pluriels... — Mais "je" n'est-il pas également synonyme de "Moi" ? — Pas dans la logique kovanienne. — Pourquoi pas ? — C'est un postulat. — C'est arbitraire donc ? — Oui. Enfin..., en partie. — Je ne comprends pas... — Notre but ici n'est pas de prouver mais d'expliquer. Je ne vais pas tenter de te convaincre par la démonstration mais essayer de te rendre la logique kovanienne compréhensible. Au moment où tu la comprendras, il sera toujours temps de te positionner : soit l'accepter, soit la refuser. Tu pourras alors le faire librement... Cette logique repose sur trois fondamentaux : des évidences, une hypothèse, et un but. Les évidences, nous en avons parlé dans ma première partie. J'ai fait de mon mieux pour les démontrer... Le but, nous le connaissons : atteindre à une société humaine plus équilibrée, mieux en harmonie avec son milieu et basée sur un individu plus autonome. Le moyen d'y parvenir, c'est-à-dire le jeu kovanien, est l'hypothèse. Elle postule qu'il est possible d'atteindre au but sans rien casser ; autrement dit : en s'appuyant sur l'existant. Cet existant, ce sont les évidences, et la première d'entre-elles : le blockhaus. On voit bien ici la relation entre sa position centrale dans l'algorithme et cette obligation que l'on se donne de ne rien détruire par la violence. Mais notre logique se construit autour de lui et non en lui... Elle se proclame différente et innovante en regard de la sienne, mais ne la contrarie pas. Elle l'intègre au contraire comme une séquence, une étape de son propre déploiement. Prétendre pouvoir le faire est un postulat. C'est une proposition que je te demande d'admettre sans pouvoir la prouver autrement qu'a posteriori, donc une fois réalisée ! — Je l'avais bien compris... — Bon. En fait, ces différences entre ces pronoms personnels selon qu'ils prennent ou ne prennent pas la majuscule sont également des postulats. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la précaution de dire "pour Kovanien" ou encore "dans la logique kovanienne". Il n'est pas question ici d'énoncer une vérité universelle mais de proposer une nouvelle logique. C'est donc Kovanien qui décide des bases de cette nouvelle logique et dans ces bases il introduit ces postulats. Il décide que "je" est différent de "Je", et mon rôle à moi est d'expliquer en quoi – pour lui – "je" est différent de "Je". Tu me suis ? — Tout à fait. Cela étant..., j'ai une question si tu permets : ces postulats ne vont-ils pas fragiliser cette logique ? Est-il bien raisonnable de construire ainsi une logique sur des bases non démontrées ? Est-ce rationnel ? — Si la logique rationnelle consiste bien en inductions, hypothèses et déductions, la réponse est oui, la logique kovanienne est bien rationnelle. Ces postulats entrent alors dans le champs de l'induction. Mais attention ! Cette rationalité n'est pas recherchée par Kovanien. Peu lui importe que sa logique soit ou ne soit pas rationnelle. Ce qui est essentiel à ses yeux est justement qu'elle dépasse cette rationalité ! Qu'elle s'en libère... Pourquoi ? Parce qu'une logique qui ne serait que rationnelle serait pour lui insuffisante : elle ne pourrait s'exercer que dans le domaine de la raison. Or, la raison conduit... au blockhaus ! Ce qui m'amène à répondre à ta question de savoir si c'est raisonnable par une autre question : est-il bien raisonnable de ne confier son destin qu'à sa raison ? Descartes me répond oui. Mais il me dit aussi que sa raison lui dicte de se rendre maître et possesseur de la nature par le progrès des techniques... Mais il me dit encore « d'obéir aux lois et aux coutumes de mon pays retenant constamment la religion en laquelle Dieu m'a fait la grâce d'être instruit dès mon enfance ». Et il me dit enfin de tâcher toujours de me vaincre moi-même plutôt qu'à tenter la fortune, de réduire mes désirs plutôt qu'à changer l'ordre du monde, et de croire surtout à mon impuissance en toutes choses sauf à la direction de mes pensées ! Je t'accorde qu'il n'a pas vu le blockhaus ; mais ne l'a-t-il pas déjà — explicitement ! — décrit ?... Le blockhaus n'est-il pas... cartésien !?... Quant à la question de la fragilité ou de la solidité d'une logique, elle ne peut, selon moi, se poser qu'en termes d'efficacité. Si la logique permet d'obtenir le résultat escompté, elle est solide. Si elle ne le permet pas, elle ne l'est pas. Nous ne pourrons donc là encore y répondre qu'a posteriori. Me rejoins-tu ? — Je te rejoins. — Bien. Revenons à "je" et à "Je"... Comme je l'ai dit, les deux sont légitimes. Ils ne sont pas contradictoires par essence. Cependant, toujours dans la logique kovanienne – mais posons une fois pour toutes que je ne parlerai dorénavant et par défaut que dans cette logique, ce qui m'évitera d'avoir à le préciser mille fois... –, ils sont de natures fondamentalement différentes : "je" est singulier et unique quand "Je" est pluriel et général. Le premier est irremplaçable du fait de son ipséité, le second interchangeable du fait de sa conformité. "je" est spontané : il émerge à l'instant même où l'individu commence à penser ; "Je" est fabriqué : il lui faut, pour se concevoir, pouvoir se comparer à d'autres "Je"... Il en formera "Nous". Il est en quelque sorte... présocialisé ! Le premier est vivant par lui-même, le second participe de la vie d'une autre entité : la société. Et pour mémoire, la logique de cette société est la logique... — Blockhausienne. — Qu'on ne peut donc encore décrypter ! C'est sur la base de ces considérations que Kovanien choisit "je" pour formuler son premier principe. On peut déjà en déduire deux indications précieuses :... — La première, je pense la voir...: il veut réhabiliter "je" en le distinguant clairement de "Je". Seul "je" peut être le centre de quoi que ce soit ; "Je" est forcément satellite, périphérique..., ou en tout cas accessoire, car il n'est que partie d'un tout. Pour qu'il en soit le centre, il faudrait que tous les "Je" en soient le centre en même temps... Par contre, si "je" est le centre du tout, c'est forcément que la nature de ce tout a changé, non ? — Tu brûles les étapes, comme à ton habitude... Je t'accorde la réhabilitation et l'impossible centralité de l'individu social. Mais pour le changement de nature du "tout", il te faudra patienter... Cette réhabilitation, ce rétablissement du "je" dans toute sa puissance initiale est bien l'une des précieuses indications auxquelles je pensais. L'autre, c'est le rapport à la vie qu'ont ces deux êtres : l'un en est animé, l'autre en est instrumentalisé. La vie coule dans les veines de "je", mais "Je" coule dans les veines de la société ; et c'est elle qui devient l'organisme vivant, l'individu social..., à son détriment ! On peut aussi analyser ce rapport à la vie d'un autre point de vue : "je" est en amont de "Je" dans ce rapport. En effet, pour créer le corps d'un individu social, il faut d'abord pouvoir le concevoir mentalement, le conceptualiser. Seul "je" peut penser "Je", car le premier est un être vivant quand le deuxième est un organe... fonctionnant ; un simple rouage, inerte en soi, qui sert le dessein d'un organisme." Fin de l'extrait. -

4 principes tout simples pour... changer de monde ?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Merci de cette question pertinente, que, je l'avoue, je ne me suis jamais posée (en tout cas sous cet angle). Ne me l'étant jamais posée, j'y réponds spontanément (je construis ma réponse en écrivant) et me réserve de changer d'avis... Je n'ai d'ailleurs pas vocation à énoncer quelque vérité que ce soit (K... ne sait pas à quoi son jeu pourrait mener, c'est écrit en toutes lettres dans le livre). Effectivement, je serais assez d'accord avec vous pour ce qui est du conformisme social. Si tout le monde appliquait ces quatre principes, il en résulterait une manière généralisée de se comporter en société différente de celle(s) que nous connaissons, et l'on pourrait, je pense, considérer qu'il s'agit d'un nouveau conformisme social. La question est alors de savoir si ce nouveau conformisme social pourrait être caractérisé comme (ou conduire à) une nouvelle "moraligion"? S'agissant d'un néologisme, précisons à toutes fins utiles ce qu'est une "moraligion": c'est une religion de la morale. C'est donc, en fait, un concept qui englobe à la fois "la" (les) religion, et qui emporte la religiosité (potentielle) de la morale, ou, autrement dit: la possibilité d'une "religion laïque". D'où provient-il? De l'application que j'ai faite d'un principe que j'appelle le "meta-raisonnement" à l'analyse de la religion en général. (J'adore mettre du "meta" un peu partout, vous l'aurez remarqué si vous avez lu quelques-uns de mes posts...). En quoi consiste ce "meta-raisonnement"? En une mise en perspective (en abîme?) du raisonnement par rapport à lui-même. Pour illustrer cette démarche, je dis souvent qu'elle consiste (en simplifiant) à se poser deux questions: que suis-je en train de faire? et, pourquoi le fais-je de cette manière? (En d'autres termes, adopter une attitude de questionnement épistémologique). Enfin, pourquoi avoir appliquer ce principe (meta-raisonnement) à cette problématique (la religion)? Pour m'extraire de la logique cartésienne. En tout cas essayer d'éviter l'écueil de la binarité qui oppose le bien au mal, la vérité à l'erreur, le religieux à l'athée, etc. C'est donc ainsi qu'est née la "moraligion" La question suivante serait donc, selon moi: une moraligion est-elle "toxique" par nature? Est-elle dangereuse? Doit-on s'en défier? etc. etc. Observez que je ne dis jamais cela, nulle part. (Vous ne le trouverez pas dans K...) Je propose une modélisation (parmi d'autres possibles) du système social dans lequel nous vivons. Les "moraligions" y jouent un rôle tout aussi considérable que les trois autres piliers (science & technologie, réalisme économique et conformisme social). K propose d'en sortir en positionnant quatres "principes actifs" à l'extérieur de ce système (un peu comme quatre aimants...). Il s'agit de transcender ce système, et non de le détruire (le slogan est "tout changer sans RIEN casser"...). J'explicite même (dans le livre) qu'on peut "prendre appui" sur ce système pour le changer. Donc, pour conclure et vous faire une réponse claire, je dirais, comme ça, à chaud, que: OUI, si tout le monde appliquait ces quatre principes K (ou d'autres), cela pourrait provoquer l'émergence d'une nouvelle "moraligion". Oui, mais si cette moraligion conduit à une société plus équilibrée, mieux en harmonie avec son environnement, et basée sur un individu plus autonome et plus responsable, où est le problème? Votre idée? -
On a un peu avancé tu sais... Dans beaucoup de domaines.
-

4 principes tout simples pour... changer de monde ?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Peu importe si tu contrôles ou non. (Je n'ai utilisé ce concept que pour expliquer la différence entre nos deux propositions). Le problème n'est pas de contrôler directement mais de se donner toutes les chances d'impacter positivement sur le résultat global (des actions de... toute l'humanité!). Chacune de nos milles et une petites actions quotidiennes impactent ce résultat global, et sur ces actions quotidiennes qui sont les nôtres propres, nous pouvons tous agir. Applique les 4 principes à chacune de ces actions, et dis-moi ce qu'il se passe... (le cas échéant). C'est la seule chose qui m'intéresse vraiment. -

4 principes tout simples pour... changer de monde ?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Peut-être, et pourquoi pas. Mais peux-tu le contrôler? As-tu la moindre puissance d'agir sur ce que tu ne peux percevoir? Les 4 principes K ne s'appliquent que dans le champs du "réel perçu"... Celui sur lequel on peut, par contre de manière certaine!,... AGIR! -

4 principes tout simples pour... changer de monde ?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Non. J'ai bien écrit "a minima"... Il y a donc éventuellement plein d'autres choses, y compris des "choses" qui ne nous sont pas forcément accessibles (du fait notamment de nos limitations sensorielles, mais pas que!...) Parce que ce qui "existe" (est "impactant") pour nous n'est que ce que nous percevons... Le reste, ce qu'on ne peut percevoir, ne nous impacte pas (a priori) et n'est pas en cause dans nos problèmes actuels... à ce moment-là, précisément, tu rejoins mon "je" ! -
Au fait, la "version pour les nuls", c'est le livre! (Rubrique littérature ici sur ForumFr). C'est un dialogue "tout bête" entre deux interlocuteurs (Ok, les concepts restent les concepts, mais il n'y a aucun langage "technique"...)
-

4 principes tout simples pour... changer de monde ?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Exactement. Dès lors, dans "tout" il y a forcément "toi" et "l'autre" (a minima) Si "je" est le centre de "tout", alors tout "je" est "le" (donc le seul possible) centre de "tout". Autrement dit ils (les "je") se confondent forcément, car il n'y a qu'un seul centre d'un seul "tout". C'est là où je vois un point commun entre ton raisonnement (ta perception) et le mien... La différence, peut-être?, c'est qu'il me semble que ton "je" accepte de se "noyer" dans l'entité de laquelle il participe, quand le mien la crée et conserve son individualité et sa puissance dans cette entité. Mais bon, je ne t'ai pas suffisamment lue pour affirmer cela. Vois le plutôt comme une question... (Pour ce qui est en gras, on m'a demandé de la mettre en veilleuse... De m'abstenir de "propagande" et de "prosélytisme" à propos de K...) -
Il n'y a que toi qui peut répondre. Si tu veux quelque chose de simple, voici: mets chacune de tes milles et une petites décisions quotidienne en perspective de mes 4 petits principes. (Pose-toi simplement la question de savoir si ce que tu vas faire/décider de faire, heurte, s'oppose, est contrarié... par l'un seulement de ces 4 principes - QUEL QUE SOIT LE SENS que tu donnes toi-même à chacun de ces principes). Tu pourrais avoir quelques surprises... Et ton retour m'intéresse au plus haut point... Pour ce qui est de la "théorie", oui, elle est complexe et il faut investir beaucoup de temps (et plonger un peu dans la systémique) pour l'appréhender "scientifiquement". Mais, est-ce nécessaire? Non. Cela ne devient nécessaire qu'au moment où l'on a besoin de se justifier à soi-même d'agir selon ces 4 principes. Or, montre-moi où il pourrait y avoir danger (pour qui que ce soit, mutuellement parlant) à agir selon ces principes... Merci de tes questions
-

4 principes tout simples pour... changer de monde ?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Vous et moi ne me semblons pas très éloignés finalement. Quand je dis que ""je" est le centre de tout", je dis forcément (et je démontre dans ... celui on ne doit pas citer le nom...) que ce "je" étant le centre de "tout", "tout" incluant forcément tous les autres "je" (et le premier), "je" se confonds au final avec "je" et tous ces "je", y compris inter-individuellement (par couple) ne forment qu'un seul "je"... Alors s'ouvrent également pour moi, toutes les possibilités. Mais peut-être vous aurai-je mal comprise? -
Un peu abscons votre jugement, Monsieur le Juge... Des attendus?
-

Peut-on faire ce que l'on veut "en philosophie" ?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Marzhin dans Philosophie
La philosophie a-t-elle vocation à faire ? Peut-on faire en philosophie? -

4 principes tout simples pour... changer de monde ?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
C'est bien "dogmatique" que j'entendais. Merci de la correction (subtile). Et vous avez raison de me retourner le compliment! C'est ma hantise! Lisez-moi bien (quelle prétention!). Lisez (oops... risque de censure), et vous comprendrez combien ce risque de "direction de la pensée de l'autre" me hante... Pour ce qui est de la probité intellectuelle: je vous assure de la mienne. Je viens juste d'essayer de la manifester (une énième fois) ici (sur ForumFr), dans une petite poésie que j'adresse à quelques-uns qui me semblaient en douter (de cette probité, et du "désintérêt" conséquent). Quant à faire un lien entre ma pensée et celle de @Maroudiji, well, well... Croyez-moi, c'est un pari audacieux. Ou alors peut-être l'ai-je mal lu (en diagonal). En tout cas je serais très très prudent sur ce terrain. Je ne le/la suis pas a priori dans sa démarche analytique (sauf à l'approfondir)... Enfin, pour ce qui est est de me rencontrer, c'est très simple: venez à l'accorderie de Brignoles (place cavaillon), demandez Guillaume. Je suis là presque tous les jours, et même si je n'y suis pas, tout le monde saura me trouver. Vous accompagner chez moi! Venez! Je ne suis pas un "profil" anonyme/virtuel/ masqué sur une pseudo-réalité: je suis juste un être humain qui porte des convictions et un idéal humaniste! Try me! -

4 principes tout simples pour... changer de monde ?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Vous êtes docte. J'attends votre démonstration dogmatique avec, sinon impatience, au moins curiosité. Merci de me faire l'honneur de me lire et me critiquer. -

4 principes tout simples pour... changer de monde ?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
Pas du tout. Vous êtes un homme. Et je suis comme vous. C'est juste peut-être, probablement, que d'une façon ou de l'autre, je suis plus vieux que vous. Ne vous y trompez pas: je ne me prétends pas "plus sage" ou "plus aîné"... Seulement plus "vieux". Tiens, nous sommes en philo décidément: avez-vous jamais pensé à "habiter" ce mot? "VIEUX" Remarquez-vous d'abord qu'il ne s'écrit jamais... qu'au pluriel!? Seuls LES VIEUX existent. "je"... "vieu" = impossible? -

4 principes tout simples pour... changer de monde ?
Guillaume_des_CS a répondu à un(e) sujet de Guillaume_des_CS dans Philosophie
C'est un jugement. Vous avez décidé que ce topic "a été pris à la rigolade" et vous l'exprimez. Cela vous appartient, à vous seul. De quel droit légitime pouvez-vous exprimer un tel jugement? Du droit que vous pensez (vous-même) vous être acquis par vos prestations sur ce forum. Dès lors, ne serait-il pas temps de vous poser la question suivante: êtes-vous en train de vous inscrire dans une tentative manipulatoire de vos lecteurs? (suiveurs, fans, admirateurs...) Confirmation de "la voie" (la bonne) à suivre... Où est votre démonstration de cette (votre) affirmation ? Et TOUT LE RESTE de votre commentaire découlant de ce postulat initial... (Sophisme? Syllogisme?...) Jusqu'à cette phrase, j'aurais pu vous gratifier d'être un critique bienveillant. Mais elle m'en fait douter... Figurez-vous que je vous ai lu comme tel! Je me suis d'abord dit : "Whaoo! Enfin quelqu'un qui a compris! Quelqu'un qui a compris que je ne sais rien et qu'il faut critiquer mes idées. Critiquer les idées et non la personnne... Ignorer la personne qui n'est que vecteur. S'attaquer aux idées, d'arrache pied. Chercher derrière chaque mot de l'idée l'essence même d'une vérité ou d'une contre-vérité (et non forcément d'un mensonge). Argumenter, démontrer, établir?, essayer en tout cas... Au fait, Monsieur/Madame @Marzhin, n'est-ce pas là l'un des principes fondamentaux de la philosophie? La philosophie emporte-t-elle principe de jugement péremptoire? Car nous sommes en rubrique "Philosophie" ici, n'est-ce pas? -
Le marketing Le "marketing" et le "management" sont à mes yeux des "sous-dimensions" (sous-systèmes?) du... Commerce. Qu'est-ce que le Commerce?, et pourquoi cette majuscule? Le commerce est, selon moi, "LE fait civilisateur". En tout cas le premier. L'expliquer ici prendrait des plombes, et probablement plus de 1000 pages... Mais je crois que cette simple affirmation suffira(it), dans cette rubrique philosophie, à provoquer le questionnement (et, éventuellement, la contradiction, donc, dans les deux cas – [l'adversité n'étant pas par essence productive] –, la progression vers l'humanité... L'humanisme?...). L'escroquerie n'est pas "cousine" du commerce. Elle est – potentiellement – partout. Elle est beaucoup plus présente dans la philosophie que dans le commerce par exemple (selon moi). Sauf que je me contredis, j'en conviens, puisque je considère le commerce comme "fait civilisateur", donc comme éminemment philosophique. Bon, tu m'auras compris: accoler "l'escroquerie" au seul commerce (marketing, management), me semble injuste et réducteur. Après, que tu le ressentes ainsi, je respecte et comprends. Depuis quelques temps, le commerce est vu davantage sous l'angle de la mondialisation, de la finance, que sous l'angle de l'échange culturel. Il faut remonter à Ogilvy (qui n'est pas si loin quand même...) pour en retrouver le sens. Oui, Ogilvy (David)! Paradoxalement? Non. Quitte à réduire (outrancièrement) sa pensée, sa vision (et son analyse quand même), il définit la nature du commerce en édictant une règle fondamentale de la communication publicitaire: "On ne peut vendre (promouvoir) que ce qui existe." (France Telecom, par exemple, [à l'époque sous la gouvernance "éclairée" d'un énarque...] a fait les frais de ne pas respecter cette règle d'or...) Or, nous avons changé d'ère: aujourd'hui, on promeut aussi ce qui n'existe pas... Si besoin, on le crée de toutes pièces. Dans le jargon du marketing, on appelle cela "le marketing de l'offre". Hélas, "le marketing de l'offre" est une arme efficace, considérablement efficace contre... la démocratie!... Cette arme n'est accessible, économiquement parlant, qu'aux multinationales ! (Là encore, 1000 pages? Mais je répondrai aux questions, s'il y en a... en moins de mille pages, promis!) Le jeu "Le jeu questionne ma volonté de participer, implique ce recul possible. Alors j'aimerais t'entendre davantage sur ce choix, qui en dit sans doute long ?" À te lire, il me semble évident que tu as parfaitement compris mon intention et qu'il n'est donc nul besoin de l'expliquer. En tout cas pour toi. Effectivement, le jeu permet d'échapper au "sérieux". En d'autres termes, le jeu permet de "rêver" la "réalité". Et le rêve de la réalité, c'est (selon moi encore), la virtualité. Or, ne sommes-nous pas dans l'ère du virtuel? D'accord, il y confusion dans l'acception que donnent à ce mot la plupart d'entre-nous (qui confondent "virtuel" et "imaginaire" quand il s'agit en fait de "ce qui a vocation à devenir réel... – ou à l'avoir été! [mais bon, là, on entre dans quelque chose d'un peu compliqué...] ). Mais qu'importe: le virtuel est bien le virtuel! Dans le réel, le virtuel est le virtuel, quoiqu'on mette derrière ce mot... Nous serions donc, selon mon raisonnement, entrés [aussi] dans l'ère du... JEU!? Il nous faut donc réapprendre à jouer! Comme quand nous étions enfants. Car nous sommes des enfants, ne le sommes-nous pas? Qu'est-ce qu'un enfant sinon un être humain qui ne sait rien, qui ne comprend rien, et qui doit tout apprendre? Et comment le fait-il cet apprentissage? Par le jeu! (C'est pitié de constater que notre "Éducation Nationale" continue [globalement] de se battre contre cette évidence...) Le raisonnement systémique "...la condition est de réfléchir en termes de décision, par couples problèmes/solutions.": Non. En tout cas, je ne raisonne pas ainsi. Il n'y a pas (à mes yeux) un problème, mais une multitude de problématiques, et a fortiori pas une solution, mais un chemin vers des solutions, toutes insuffisantes/partielles ("une" solution n'existe pas et n'existera jamais). Je ne conteste pas la condition, tu l'auras remarqué. Réfléchir en termes de décision me convient. Car oui, il faut décider. Il faut oser décider, se positionner sur l'échiquier de la responsabilité, c'est à mon sens ce que signifie "décider". Décider, oui; mais pas par couple "problèmes/solutions"; plutôt par couple "problèmes/chemins de réflexion". "En contrepartie c'est comme si cette notion portait avec elle le poids de la domination, de l'hétéronomie, des élites, des experts et de la spécialisation...": Exactement! Et c'est bien la raison pour laquelle je n'empreinte pas cette voie... " ...la complexité correspond au fait que les problèmes soient liés entre eux par l'enchevêtrement des facteurs sociaux, politiques, économiques, à différentes échelles éventuellement, etc. ...": la complexité me semble plus complexe que cela. Tu l'expliques ici rationnellement (au travers d'un prisme de causalité: parce que des facteurs multiples sont enchevêtrés les uns aux autres, je pourrais en déduire des problèmes...). Hélas, et tant mieux!, la complexité ne relève pas de l'analyse cartésienne. Il suffit (à mon sens) de... nier Descartes pour s'en approcher. Et là encore, c'est un jeu!... Essaie de jouer à mon jeu: nie Descartes! Et découvre (who knows...) la complexité de la complexité? (Là encore encore... 1000 pages... mais ouvert aux questions... ) "Or la forme ludique et le contenu lui-même veulent apporter une solution unique et simple et en principe universelle.": En tout cas, cela n'est pas mon intention. Moi je suis un peu là pour faire le contraire: apporter des questions multiples qui n'ont aucune réponse, mais qu'on pourrait se poser plus utilement en suivant un chemin... intelligent? Merci de ton commentaire très riche qui m'a permis d'essayer d'expliquer quelques points importants de ... (je ne cite plus sous peine de censure...). Et désolé d'y répondre un peu tardivement. J'ai eu quelques fâcheux empêchements...