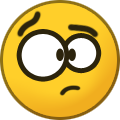-
Compteur de contenus
3 006 -
Inscription
-
Jours gagnés
1
Type de contenu
Profils
Forums
Blogs
Calendrier
Vidéos
Quiz
Movies
Tout ce qui a été posté par satinvelours
-

Théorie de la relativité : éléments
satinvelours a répondu à un(e) sujet de aliochaverkiev dans Sciences
Pour se déplacer de lui-même il faudrait que le vaisseau recourt à une source d’énergie. Nous ne serions plus alors dans le cadre du principe d’inertie. Ici nous sommes dans un cadre où aucune force n’agit sur le vaisseau, que ce soit une force extérieure ou une force d’origine intérieure : combustion d’un carburant par exemple. Le vaisseau ne peut pas se déplacer « de lui-même» c’est-à dire sous l’action d’une quelconque force. S’il de déplace c’est par pure inertie. L’inertie ne peut que laisser le corps au repos ou lui conférer une vitesse constante et rectiligne. De plus ce mouvement étant indétectable de l’intérieur il faut encore « voir » un autre vaisseau pour se savoir en mouvement. Cela c’est le principe d’inertie pensé par Galilée, formulé par Poincaré puis amendé par Einstein. Vous pensez qu’une expérience interne au vaisseau peut permettre de connaître sa vitesse par rapport à un référant quelconque. Or aucun expérience faite sur la lumière n’a encore permit de déduire, de l’intérieur, la vitesse d’un vaisseau, par rapport à un autre (dans le cadre de référentiels inertiels, au repos ou en mouvement relatif qui obéisse à une vitesse constante et en ligne droite). Pour le moment personne n’a pu réaliser une expérience qui infirme ce principe. C’est pour cela que nous le posons comme étant vrai. Bien sûr vous pouvez penser que ce principe est faux. Dans ce cas la théorie de la relativité est fausse aussi. Mais jusqu’à présent aucune expérience n’a pu mettre en défaut cette théorie. Mais peut-être est elle fausse, vous pouvez avoir raison. Dans ce cas il ne faut pas lire mes développements puisque, pour vous, ils sont forcement faux puisque je m’appuie sur le caractère vrai du principe de relativité. -

Théorie de la relativité : éléments
satinvelours a répondu à un(e) sujet de aliochaverkiev dans Sciences
Attention Holdman : la vitesse d’un vaisseau (mouvement rectiligne uniforme) n’agit pas sur sa longueur. C’est l’erreur classique des profanes. Mais c’était aussi l’erreur de Poincaré avant qu’Einstein n’arrive. Le paradoxe de la relativité est justement là : les longueurs se contractent dans un vaisseau du point de vue d’un observateur situé sur un vaisseau au repos par rapport à l’observateur situé sur le vaisseau qui se déplace à une vitesse v, mais pour celui qui se trouve sur le vaisseau animé d’une vitesse v, les longueurs ne se contractent évidemment pas si on pose comme postulat que le principe de relativité est vrai. C’est justement parce que Poincaré pensait que les longueurs se contractaient réellement à bord du vaisseau en mouvement qu’il n’ a pas pu poser comme étant vrai le principe de relativité. Le principe de relativité pose que, pour un observateur situé sur n’importe quel vaisseau animé de n’importe quelle vitesse (rectiligne uniforme) les longueurs, les durées, etc. ne sont pas affectées par les dites vitesses sinon l’observateur saurait qu’il serait en mouvement. C’est ce paradoxe : des longueurs différentes pour un même objet (selon le référentiel), des durées différentes pour un même événement(selon le référentiel) qui explique que peu de gens parviennent à « intuitionner » la théorie de la relativité. -

« Boire un grand bol de sommeil noir... »
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Littérature
Champ funèbre pour Ignacio Sánchez Mejías Lorca n’a pas assisté à la funeste corrida du 11 août 1934, où son ami Ignacio Sánchez Mejías âgé de 43 ans, est mortellement blessé, dans les arènes de la petite ville de Manzanares. Ignacio s’était retiré de l’arène en 1927 : au moment de l’hommage à Góngora, il avait invité, dans sa propriété de Séville, le groupe des amis, poètes, artistes, essayistes qui devaient faire éclore le deuxième siècle d’or de la poésie espagnole. Mécène, grand lecteur de littérature, amateur éclairé de cante jondo, auteur d’une pièce de théâtre, Ignacio incarnait au plus haut degré la gracia andalouse, la culture, le courage et, face à la mort, l’élégance et le drame. Le chant est dédié à la Argentinita, Encarnación López Júlvez, compagne du torero, danseuse et chanteuse, pour qui Lorca harmonise des chansons populaires. En 1950, Maurice Ohana, qui avait été en 1936 l’accompagnateur au piano de la Argentinita, met en musique le « Chant funèbre… ». L’œuvre est créée, le 22 mai 1950, à la Sorbonne ; le récitant en est l’hispaniste Maurice Molho. Le chant est rigoureusement construit en quatre parties... Absence de l’âme [la dernière des quatre parties], oppose à la disparition définitive et à l’oubli la permanence du chant et de la tristesse du vent dans les oliviers. Aguilar, Poésies III. -

« Boire un grand bol de sommeil noir... »
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Littérature
Alma Ausente Llanto por Ignacio Sánchez Mejías No te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo porque te has muerto para siempre. El Otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y montes agrupados pero nadie querrá mirar tus ojos porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la Tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie. No. Pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia. La madurez insigne de tu conocimiento. Tu apetencia de muerte y el gusto de su boca. La tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Traduction Âme absente A mi querida amiga Encarnación López Júlvez Ni le taureau ni le figuier ne te connaissent, ni les chevaux ni les fourmis de ta maison. Ni l’enfant ni le soir ne te connaît parce que tu es mort pour toujours. Ni l’arrête de la pierre ne te connaît, ni le satin noir où tu te défais, ni ton souvenir muet ne te connaît parce que tu es mort pour toujours. L’automne viendra avec ses conques, raisins de nuages et cimes regroupées, Mais nul ne voudra regarder dans tes yeux parce que tu es mort pour toujours. Parce que tu es mort pour toujours, comme tous les morts de la Terre, comme tous les morts qu’on oublie dans un amas de chiens éteints. Nul ne te connaît plus. Non. Pourtant, moi, je te chante. Je chante pour des lendemains ton allure et ta grâce. La maturité insigne de ton savoir. Ton appétit de mort et le goût de sa bouche. La tristesse que cachaient ta joie et ta bravoure. Il tardera longtemps à naître, s’il naît un jour, un Andalou si noble, si riche d’aventures. Je chante son élégance sur un ton de plainte et je me souviens d’une brise triste dans les oliviers. Traduction originale du poème en français; Sylvie Corpas et Nicolas Pewny: Traduction agrée par la Fondation et les héritiers de García Lorca. Autre traduction (Pierre Darmangeat) Ni le taureau ni le figuier ne te connaissent, Ni les chevaux ni les fourmis de ta maison. L’enfant ne te connaît ni la soirée Parce que tu es mort pour toujours. Ne te connaît le dos de la pierre, Ni le satin noir ou tu te déchires. Plus ne te connaît ton souvenir muet Parce que tu es mort pour toujours. Viendra l’automne avec les coques-fleurs, Raisins de brume et montagnes en groupe, Mais ne voudra personne regarder tes yeux Parce que tu es mort pour toujours. Parce que tu es mort pour toujours, Comme tous les morts de la Terre, Comme tous les morts qu’on oublie Dans un amoncellement de chiens éteints. Nul ne te connaît plus. Non. Mais je te chante. Je chante pour plus tard ta silhouette et ta grâce. L’insigne maturité de ta connaissance. Ton appétit de mort et le goût de sa bouche. La tristesse qu’éprouva ta vaillante allégresse. De longtemps ne naîtra, si toutefois il naît, Un Andalou si clair, si riche d’aventures. Je chante son élégance en des mots qui gémissent, Et me rappelle une brise triste dans les Oliviers. -

Théorie de la relativité : éléments
satinvelours a répondu à un(e) sujet de aliochaverkiev dans Sciences
Vous ne racontez pas de bêtises. Je m’aperçois que le commentaire de 1905 me sert sans doute à mieux maîtriser la théorie mais ce commentaire n’est pas clair car le texte d’Einstein n’est pas non plus simple. J’essaye de mettre au point un schéma qui permette de saisir «l’étrangeté » de cette théorie . Après tout ce qui m’intéresse c’est de réussir à illustrer les paradoxes de la théorie et non d’en tirer les conséquences. Je vais vous rassurer : très peu de spécialistes arrivent eux-mêmes à « concevoir », à « intuitionner » ces paradoxes. Ils savent les démarches mathématiques à suivre pour tirer les conséquences de ces paradoxes mais ils n’arrivent pas à « intuitionner » ces paradoxes. Pourquoi ? Parce que ces paradoxes sont totalement contre-intuitifs. Pour parvenir à intuitionner ces paradoxes il faut renoncer à ses propres réflexes intuitifs. Je reviens sur le principe d’inertie. Si vous êtes sur un vaisseau, seul, que ce vaisseau n’est soumis à aucune force (en fait si le vaisseau est soumis à une force c’est qu’il existe un autre vaisseau ou un « objet »dans les « parages » car, une force, en soi, ça n’existe pas non plus, la force est un concept qui illustre une relation entre au moins deux objets distincts) alors vous êtes au repos. Vous dites non car vous vous dites « oui mais si le vaisseau se déplace par rapport à un autre (même si on ne voit pas ce vaisseau) alors cette vitesse joue sur la distance parcourue par la lumière dans un sens ou dans l’autre ». D’abord il faut bien voir que le rai de lumière est émis à partir du vaisseau lui-même (par exemple une torche qui se trouve sur le vaisseau). Si vous émettez un rai de lumière avec une torche qui appartient au référentiel constitué par le vaisseau ce rai de lumière parcourt une distance AB qui sera égale à la distance BA. L’éventuelle vitesse du vaisseau n’influe pas sur le rai de lumière émis à l’intérieur du vaisseau. Si ce n’était pas vrai, alors si le vaisseau était entouré de dix vaisseaux par rapport auxquels il aurait une vitesse différenciée alors votre rai de lumière émis de l’intérieur du vaisseau serait influencé de dix manières différentes. Mais il n’est pas possible que ce rayon de lumière subisse dix influences différentes. Si vous émettez un rai de lumière de l’intérieur même du vaisseau, cette émission ne vous permet pas de savoir si oui ou non vous vous déplacez par rapport à un éventuel autre vaisseau. Est ce que vous acceptez cela ? -

Théorie de la relativité : éléments
satinvelours a répondu à un(e) sujet de aliochaverkiev dans Sciences
J’ai bien lu votre remarque. Il faut faire attention : nous faisons de la physique, c’est-à-dire que nous restons dans le domaine pratique, concret. L’espace est une représentation mentale mais il n’a pas de réalité concrète. En physique ce qui est concret ce sont les référentiels, c’est-à-dire des systèmes de coordonnées formés en général de trois axes perpendiculaires les uns par rapport aux autres, axes que vous pouvez imaginer (pour les rendre concrets) comme des tiges métalliques rigides. Ces axes partent d’une origine, souvent notée O, origine arrimée à un solide. L’ensemble s’appelle : référentiel. Quand on parle d’un point de l’espace c’est une image. En réalité nous joignons le point selon certaines règles (projections) aux trois axes du référentiel ce qui permet de déterminer la localisation de ce point par rapport au point O du référentiel. Ainsi le rai de lumière part d’un point localisé dans un référentiel choisi. Puis ce rai suit une trajectoire elle aussi déterminée en référence au référentiel choisi (une droite est un ensemble de points dont la position est déterminée dans le référentiel choisi). Tout cela bien sûr ce sont des modèles géométriques. Nous travaillons en nous appuyant sur ces modèles car ils permettent d’agir sur la réalité. Ils ont une efficacité prédictrice. Nous ne savons pas s’ils sont vrais en soi (ce sont des représentations) mais nous savons qu’ils nous permettent d’agir sur la réalité. Nous posons vrai, en physique, ce qui permet l’action concrète. Si vous ne vous donnez pas pour discipline de faire vôtres ces modèles il est impossible que vous compreniez ce que j’écris. Vous essayer d’accéder à la réalité autrement que par des modèles géométriques. Pourquoi pas, mais alors vous n’êtes plus dans le sujet que je décris. Vous êtes dans la poésie et c’est beau certes mais vous n’êtes plus dans la physique. Enfin la notion de mouvement est relative. Tant que vous êtes seul dans l’espace et qu’aucune force n’agit sur vous (ou que la somme des forces qui agit sur vous est nulle) vous êtes au repos. Vous ne pouvez commencer à parler de vitesse que par comparaison avec quelqu’un d’autre. La vitesse exprime une relation entre deux objets distincts. Il n’ y a pas de vitesse en soi. Il n’ y a pas de vitesse en absolu si vous voulez (sauf la vitesse de la lumière). Pour vous déclarer animé d’une certaine vitesse il faut que vous ayez un autre référant que vous. Si vous êtes seul dans l’espace, si un vaisseau est seul, il est au repos (s’il n’est soumis à aucune force). Les questions qui se posent ici concernent la perception relative d’un rai d e lumière par deux vaisseaux qui sont dans une relation telle que l’un se déplace par rapport à l’autre. Tant qu’il y a qu’un vaisseau et un rayon de lumière dépendant d’un même référentiel, pas de problème. Mais si advient un deuxième vaisseau qui observe par rapport au premier une relation traduite par une vitesse relative (si ce vaisseau est fixe par rapport au premier alors là il n’ y a plus de problème non plus), alors la perception du rai de lumière par l’observateur de cet autre vaisseau par rapport à la perception qu’en a le premier diffère. C’est cette différence de perception relative (je dis bien relative ) d’un même phénomène (l’émission d’un rayon de lumière) par deux observateurs en mouvement relatif l’un par rapport à l’autre qui est ici étudiée. -
Lettre 46 4 décembre 2018 Samuel, La communauté juive d’Espagne (les Séfarades) des origines jusqu’en 711 Sous la domination de l’Empire romain une communauté judéenne s’était intégrée à la population de la Province romaine d’Hispania. (L’origine de l’implantation des Juifs en Espagne reste controversée). Il s’agissait surtout d’agriculteurs installés dans la région de Tolède, en Catalogne et en Andalousie. Jules César avait autorisé les Judéens à pratiquer librement leur religion et à entretenir des liens étroits avec la Judée. Profitant de la décomposition de l’Empire romain d’Occident les Wisigoths, tribu germanique, envahirent l’Espagne au début du 5 ème siècle de notre ère. Ils étaient convertis à l’arianisme, branche hérétique du christianisme : ils ne croyaient pas au caractère divin de Jésus. Cela les rapprochait des Juifs et les éloignait des chrétiens orthodoxes (orthodoxe au sens : qui suit la doctrine officielle de l’Église). Mais, en 589, le roi wisigoth de l’époque Récarède I abjure l’arianisme et se convertit au catholicisme romain. L’Église catholique installe ses dignitaires dans la capitale des Wisigoths, Tolède, et commence à persécuter les Juifs en demandant l’application du code de Théodose II (voir lettre 44). Les rois wisigoths continuèrent tout de même à protéger les Juifs malgré quelques persécutions sporadiques. Cependant au cours du temps la situation des Juifs s’aggrave. En 694 le roi wisigoth Egica décide de réduire en esclavage tous les Juifs et il les dépossèdent de tous leurs biens ( notamment les terres). La situation devient catastrophique, nombre de Juifs doivent s’enfuir, les rois s’orientent vers leur expulsion voire leur extermination. Mais les armées arabes de la dynastie des Omeyyades dirigées par le berbère Tariq ibn Ziyad, venues d’Afrique et rejointes par tous les Juifs bannis, rentrent en Espagne et remportent une victoire décisive en juillet 711 à Guadalete où Rodéric, dernier roi des Wisigoths meurt. Les Arabes victorieux conquièrent l’Espagne. Les Juifs les accueillent en libérateurs. Une culture judéo-arabe va s’épanouir en Espagne. Les Juifs d’Espagne sont appelés : séfarades. Les communautés juives d’Égypte et d’Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye) En Afrique du Nord la présence juive remonte à l’époque des rois lagides d’Égypte (appelés encore les Ptolémées, voir lettre 27). Ceux-ci au IV siècle avant l’E.C. firent appel à des mercenaires juifs installés à Alexandrie pour défendre les villes qu’ils avaient conquises en Cyrénaïque (région de la Libye actuelle) et à Chypre. Des communautés juives s’installèrent ainsi en Cyrénaïque. En Égypte au moment de la chute du royaume d’Israël puis de celle du royaume de Juda (en 586 avant l’E.C.) une petite communauté juive se développa dans l’île Éléphantine située au milieu du Nil en face d’Assouan. Les Juifs servaient comme soldats au service des pharaons. Au début du IV siècle avant notre ère cette communauté disparut et les Juifs se retrouvèrent à Alexandrie sous la domination des Lagides qui désormais régnaient sur l’Égypte. Ils s’hellénisèrent considérablement ce qui les distingua des autres Juifs de la communauté mondiale. C’est à cette époque que sera rédigée la Bible des Septante (voir lettre 27). Quand l’Égypte passa sous la domination des Romains en 30 avant notre ère la communauté s’adapta. Elle produisit ses propres penseurs, notamment Philon d’Alexandrie (20 avant notre ère, 45 après notre ère), contemporain de Jésus et de Paul. Philon respecte les rites du judaïsme mais comme Paul il prend ses distances avec la Loi, conscient que celle-ci est un obstacle à la conversion des non-juifs au judaïsme (à l’époque ne pas oublier que les Hébreux pratiquent un prosélytisme actif). Il réinterprète la Bible et tente de l’enrichir de la culture platonicienne. Comme Paul il tente de présenter le judaïsme sous une forme nouvelle susceptible de séduire les Gentils. Mais le triomphe du christianisme plongea sa philosophie dans l’oubli. En 115-117 dans le sillage de la révolte des Judéens contre l’occupation romaine en Palestine, les communautés d’Alexandrie et de Cyrénaïque se révoltent à leur tour contre les Romains. Ceux-ci réagissent violemment. Les Juifs fuient vers l’Est, trouvent asile à Carthage (près de Tunis) puis près des berbères de Tunisie et d’Algérie. De petites communautés se constituent en Tunisie, Hamman-Lif près de Tunis; Utique près de Carthage, Chemtou (nord-ouest de la Tunisie), en Tripolitaine (région de Tripoli, ouest de la Libye), en Numidie (Algérie actuelle), à Hippone (Annaba actuelle, Algérie), à Cirta (Algérie), en Maurétanie césarienne (à Sétif, à Auzia, à Cherchell), en Maurétanie Tingitane (Maroc) notamment à Volubilis. [La Maurétanie césarienne correspond à l’Algérie centrale et occidentale. La Maurétanie Tingitane correspond au Maroc. Les deux Maurétanies étaient peuplées de Maures autre nom des Berbères]. La cohabitation avec les chrétiens est difficile et elle s’aggrave nettement lorsque Constantin se convertit. La pression s’atténue lorsque la région est occupée à la fin du V ème siècle par une tribu germanique qui chasse les Romains christianisés : les Vandales convertis à l’arianisme. Mais là encore c’est la conquête de la région par les Arabes au VII siècle qui va soulager les Juifs de la persécution des chrétiens. La communauté juive d’Italie jusqu’à la chute de l’Empire romain d’Occident (476) Une communauté juive, probablement originaire d’Alexandrie était établie à Rome depuis le II siècle avant l’E.C. Les relations cordiales entretenues entre Rome et les Maccabées venus négocier une alliance contre les Séleucides consolide l’intégration de la communauté. Celle-ci soutint la lutte de Jules César dans sa conquête du pouvoir. Ce soutien lui valut en retour la bienveillance de ce dernier. Les Juifs possèdent l’autonomie administrative, pratiquent librement leur culte et sont exemptés d’impôts. Auguste, le premier Empereur romain (la République s’efface devant l’Empire à la mort de César assassiné en 44) leur accorda la citoyenneté romaine. La communauté se développe sensiblement sur le plan démographique. Selon Flavius Josèphe il y aurait à Rome entre 30 000 et 40 000 Juifs au premier siècle après l’E.C. Ceux-ci pratiquent un prosélytisme actif qui rencontre un certain succès (mais qui leur vaut aussi une certaine hostilité de la part de Romains soucieux de protéger leur identité). Après la révolte des Judéens en 70 en Palestine, l’empereur Vespasien (il règne de 69 à 96) se montra moins favorable. Il impose à la communauté le paiement d’un impôt destiné à financer la reconstruction future à Jérusalem d’un Temple dédié à Jupiter. Sous l’empereur Hadrien (voir lettre 43) la circoncision est interdite dans tout l’Empire aux Juifs comme aux non-Juifs ce qui inspira la révolte de Simon Bar-Cokhba. Rappelons que les Romains n’interdirent pas la circoncision pour des raisons religieuses mais pour des raisons philosophiques. Ils voyaient dans la circoncision un acte humiliant, symbole de la castration. La circoncision sera de nouveau autorisée par l’empereur Antonin-le-Pieux (il règne de 138 à 161) mais il la maintiendra interdite pour les convertis. Sous Constantin le christianisme devient religion d’État. A Rome la liberté religieuse est encore respectée. La scission entre l’Empire d’Occident et l’Empire d’Orient en 395 freine le développement des mesures anti-juives prises par l’Empire d’Orient. Mais la situation des Juifs finit tout de même par se dégrader. Ils sont progressivement exclus des charges publiques, les mariages mixtes sont interdits, les Juifs sont progressivement marginalisés. Rome tombe en 476. Le roi Ostrogoth Théodoric qui règne sur Rome de 493 à 526 rétablit la liberté religieuse et contient l’hostilité des catholiques contre les Juifs. Théodoric est issu des tribus germaniques et il pratique lui aussi l’arianisme, il ne voit donc pas chez les Juifs des déicides. Considérations générales Après la perte de leur terre les Judéens vont poursuivre lentement leur dispersion à travers le monde malgré leur baisse numérique consécutive aux persécutions et aux guerres. Ils atteignent des contrées aussi éloignées que l’Inde et la Chine. Ils s’établissent en Sicile, en Sardaigne, aux Baléares, sur les bords du Rhin (Cologne) autour du Bosphore, en Macédoine (Salonique), en Chypre, en Arménie (Van), au Kurdistan. Contrairement à d’autres communautés ils ne cherchent pas à se regrouper sur un seul territoire ni une seule ville. Ils forment ainsi un chapelet de petites communautés rassemblées autour de la synagogue, partout dispersées dans le monde. Il est nécessaire de parler maintenant de la communauté juive établie en Arabie. Là va naître un nouveau conquérant, à l’instar de César, d’Alexandre le Grand ou de Paul : Mahomet. Celui qui fonda l’Islam posa aussi les fondations d’un nouvel Empire. Les Hébreux assistèrent à l’émergence de ce nouvel acteur de l’Histoire qui façonna autant que ses prédécesseurs les civilisations issues de Mésopotamie. J’espère que tu vas bien Je t’aime
-

Théorie de la relativité : éléments
satinvelours a répondu à un(e) sujet de aliochaverkiev dans Sciences
J’ai bien lu votre remarque, j’y réponds dès que possible. -

« Boire un grand bol de sommeil noir... »
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Littérature
Anónimo No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Traduction Anonyme Mon Dieu, ce qui m’incline à vous aimer N’est pas le ciel que vous m’avez promis, Et ce n’est pas la crainte de l’enfer Qui me retient de ne vous offenser. C’est vous-même, Seigneur, c’est de vous voir Cloué en croix, objet de moquerie ; C’est de voir votre corps si lacéré, Les outrages subis et votre mort ; C’est l’amour pour vous-même, en telle sorte Que, sans le ciel, je vous adorerais Et sans l’enfer, je vous redouterais ; Point n’est besoin de don à mon amour. Car si je n’espérais ce que j’espère, Je vous aimerais comme je vous aime. Ce sonnet est sans doute l’un des plus beaux de la poésie du Siècle d’or espagnol. Il a été attribué à saint François-Xavier, à saint Ignace de Loyola, à sainte Thérèse d’Avila à fray Pedrode los Reyes. Extraordinaire produit d’une écriture si partagée qu’elle est de tous, mais si authentiquement individuelle qu’on n’y reconnaît vraiment personne, le sonnet anonyme est à la poésie sacré ce que sont à la peinture le Christ en Croix de Velásquez (16131) et le Christ de Saint-Jean de Lacroix de Salvador Dali (19151). Il a été publié pour la première fois dans la Vida del espiritu des Antonio de Rojas (Madrid, 1629). Mathilde Pomès Anthologie. « Le sonnet anonyme A Cristo crucificado, également connu par son vers initial No me mueve, mi Dios, para quererte, est l’un des joyaux de la poésie mystique espagnole. Son auteur est inconnu mais quelques experts l’attribuent à Juan de Ávila. Il fut imprimé pour la première fois en 1628 dans le livre du docteur madrilène Antonio de Rojas Vida del espíritu, bien que l’on pense qu’il ait circulé longtemps auparavant dans une version manuscrite. Selon le franciscain Ángel Martin, « le style est direct, énergique, presque pénitentiel. Ce n’est pas la beauté imaginative du langage qui définit ce sonnet, mais la force avec laquelle il renonce à tout ce qui n’est pas aimer celui qui, par amour, a laissé détruire son corps. Le langage, en renonçant aux ornements du langage figuré, adhère, dans une conjonction admirable, d’une façon robuste et décharnée, à la nudité mystique du contenu. » (Je n'ai pas trouvé d'autres traductions satisfaisantes.) -

« Boire un grand bol de sommeil noir... »
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Littérature
La poésie chinoise, est un autre monde qui s'offre à nous. La pensée chinoise est si différente de la pensée occidentale ! François Cheng est un admirable traducteur de cette pensée. Passionné par la culture et la poésie françaises, il est à même de nous fait saisir le raffinement, la quintessence de la poésie chinoise. (A lire du même: "Cinq méditations sur la beauté") -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
« La femme éveille l'homme à l'idéalité et l'y rend créateur par son rapport négatif vis-à-vis de lui ». Au point de vue de la terminologie c'est absolument du Hegel, mais c'est du Kierkegaard. Il nous faut comprendre que la femme n'existe pas en soi, elle est la simple médiation par laquelle l'homme accède à lui-même. Elle va servir un peu de révélateur en même temps que de catalyseur et cet accès à soi, on pourrait dire à la spiritualité, à l'idéalité, ici un terme hégélien. L'idéalité est tout simplement le stade de l'idée c'est-à-dire lorsque l'homme précisément commence à s'élever de la sphère du sensible, des impressions, de l'émotion et par un travail, le travail artistique, esthétique, il commence à s'élever à la sphère de l'idée, du concept mais aussi avec dans l'idée quelque chose de beaucoup plus créateur que dans le concept. Donc la femme n'a aucune existence en elle-même. Elle est la médiation nécessaire à l'homme pour que celui-ci puisse se spiritualiser, accéder à l'idéalité y compris à la sienne propre. La femme est ce support, ce pôle contingent sur lequel se projettent les fantasmes de l'homme, mais cela va révéler à l'homme l'existence de monde autre. C'est par delà la médiation du féminin que l'homme découvre qu'il existe, au-delà du monde dit réel, du monde naturel dans lequel nous subissons tous les déterminations de la nature (corps pesants), un monde épuré totalement spirituel, un monde des idées, un monde tout à fait platonicien qui essaierait de retrouver quelque chose qui va intéresser le désir. Un monde de pures idées où tout est idéalisé où la laideur, la misère, l'étroitesse de la réalité, tous les thèmes romantiques apparaissent comme insupportables, d'où l'idée de sortir de cette prison de la réalité. Or la femme apparaît comme cette ouverture, cette fenêtre qui s'ouvre à l'homme et au-delà de laquelle il va lui-même pouvoir s'ouvrir à l'existence du Beau, de la Beauté, de l'Amour. Mais il s'agit du Beau comme forme, de l'Amour comme forme. Et ce phénomène d'idéalisation est tellement puissant que chaque fois que l'esthète devra faire l'épreuve de la réalité il ne pourra trouver que l'aspect décevant de cette réalité, puisque la réalité n'a rien à voir avec cet idéal que l'esthète constitue. La femme n'est que la tentation platonicienne de l'homme. Donc par la femme découverte de la pureté, de la perfection absolue. Cependant cette pureté cette perfection absolue que l'on projette loge dans une personne réellement existante et réellement en chair. Il faudra donc s'accommoder de ce qui sera vécu par l'esthète comme un écartèlement, d'où le thème récurrent de l'épouse et de la maîtresse : l'épouse n'éveille pas l'idéalité trop occupée à accomplir ses tâches domestiques. Le mariage est la mise à mort de l'idéalité. « La femme inspire l'homme aussi longtemps qu'il ne la possède pas ». La possession détruit le fantasme, substitue le réel au possible et en tant que tel révèle la finitude de l'être possédé. La femme apparaît comme le fini, elle est cet être enserré dans des limites physiques, charnelles. Mais le phénomène d'idéalisation tente par tous les moyens de passer outre ces limites et donc de conférer à cet être un caractère illimité, infini, d'où la phrase « la femme n'est que le fini porté à la puissance d'un infini trompeur ». La femme en elle-même n'est rien mais elle est ce qui suggère l'infini. Et l'infini dont il est question ici c'est l'infini de la puissance du désir. Au travers de l'être féminin ce qui se découvre c'est ce que l'on pourrait appeler l'objet paradoxal du désir puisqu'en analysant cette notion de désir on voit qu'il ne poursuit pas strictement le plaisir. Mais à la question que veut le désir, on ne peut que répondre : le désir veut le désir (Hegel). -

Théorie de la relativité : éléments
satinvelours a répondu à un(e) sujet de aliochaverkiev dans Sciences
Dans le paragraphe précédent nous avons noté que l’événement E suivant : un rayon lumineux part de A au temps t(A), est réfléchi en B au temps t(B) puis revient en A au temps t’(A) a une durée t’(A) – t(A) = 2 AB/ V (avec ici V= c, vitesse de la lumière dans le vide). Cette durée est déterminée par des horloges que nous avons synchronisées. Nous avons aussi ces égalités intermédiaires : t(B) – t(A) = AB/V et t’(A) – t(B) = AB/V. Nous pouvons considérer que les points A et B, et les horloges associées, font partie d’un référentiel inertiel R. Tout autre référentiel inertiel R’, dans lequel deux points A et B sont tels que leur distance est la même que celle des points A et B de R et dans lequel est noté l’événement E’ suivant : un rayon de lumière part de A, est réfléchi en B puis revient en A permet de synchroniser des horloges associées et de déterminer la durée de l’événement E’ qui sera la même que celle de l’événement E dans R [principe de relativité]. Les deux référentiels se comportent comme s’ils étaient au repos, les expériences ayant lieu à l’intérieur d’eux-mêmes et ne dépendant en rien de leur éventuelle vitesse relative (ils ne peuvent pas non plus avoir une vitesse différenciée par rapport à la vitesse de la lumière puisque la vitesse de la lumière est la même pour les deux référentiels inertiels). Supposons maintenant que le référentiel inertiel R’ se déplace par rapport au référentiel inertiel R avec une vitesse v. Les horloges synchronisées en R et en R’ sont elles synchronisées entre elles ? Observons l’événement E’ en supposant les horloges de R’ synchronisées avec celles de R (et non pas synchronisées selon la méthode retenue dans le paragraphe précédent pour les horloges de R). Les temps relevés en A et B de R’ (trajet du rayon) sont les mêmes que les temps relevés en A et B de R puisque ces temps sont relevés sur des horloges synchronisées avec celles de R [Nous posons l’axiome suivant, posé par Einstein: si une horloge H est synchronisée avec une horloge H’ et si l’horloge H’ est synchronisée avec une horloge H’’ alors H est synchronisée avec H]. Comme la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels inertiels la distance parcourue par la lumière dans R’, dans la durée t(B) – t(A) est égale à V x [t(B) – t(A)]. Mais cette distance est égale à la longueur AB dans laquelle le point B, du fait de la vitesse de R’ par rapport à R a parcouru une distance v x [t(B) – t(A)] . [C’est en fait AB qui a parcouru cette distance mais cela revient au même de se concentrer sur le point B]. Donc V x [t(B) – t(A)] = AB + v x [t(B) – t(A)] et t(B) - t(A) = AB / (V- v). [Avec un raisonnement analogue nous trouverons t’(A) – t(B) = AB / (V + v)]. Pour observateur en R’ les horloges qu’il a réglées sur celles de R ne sont donc pas synchronisées. Alors qu’elles le sont dans R. Si R’ rejette ces horloges et synchronise les siennes avec la méthode retenue pour les horloges de R, il trouvera avec ces nouvelles horloges synchronisées dans R’ : t(B) - t(A) = AB/ V et non t(B) – t(A) = AB / (V – v). Pratiquement cela signifie que les horloges dans R et celles dans R’ n’ont pas le même rythme de fonctionnement ou encore que chaque référentiel a un temps propre distinct de celui de l’autre. -

« Boire un grand bol de sommeil noir... »
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Littérature
Je ne peux que vous remercier pour votre brillante analyse. Je vois que, comme moi, certaines traductions ne vous satisfont pas. Je dis toujours : traduire c'est trahir. Et là vous venez d'en faire l’éclatante démonstration. -

« Boire un grand bol de sommeil noir... »
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Littérature
CANCIÓN DEL JINETE - Córdoba. Lejana y sola. Jaca negra, luna grande, y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos yo nunca llegaré a Córdoba. Por el llano, por el viento, jaca negra, luna roja. La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. ¡Ay qué camino tan largo! ¡Ay mi jaca valerosa! ¡Ay, que la muerte me espera, antes de llegar a Córdoba! Córdoba. Lejana y sola. Ce poème fait partie des Canciones Andaluzas. Traductions Chanson de cavalier Cordoue Lointaine et seule. Jument noire, lune grande Olives dans ma besace. Bien que je sache la route Je n’atteindrai pas Cordoue. Par la plaine, par le vent, Jument noire, lune rouge. La mort approche, me guette, Depuis les tours de Cordoue. Ah, que le chemin est long ! Ah, que ma jument a du courage ! Ah, que la mort m’attende Avant d’atteindre Cordoue ! Cordoue. Lointaine et seule. Cordoue Lointaine et seule. Lune grande, jument noire, Olives dans le bissac J’ai beau connaître la route Je n’atteindrai pas Cordoue. Par la plaine, par le vent, Jument noire, lune rouge, La mort tout là-bas me guette Depuis les tours de Cordoue. Ah ma jument valeureuse Quelle interminable course ! Je sais que la mort m’attend Sur le chemin de Cordoue ! Cordoue Lointaine est seule. Deux traductions. Les différences sont infimes, mais elles montrent combien traduire est difficile. L’une, la première, est de Catherine Réault-Crosnier, la seconde d’André Belamich. Je laisse au lecteur l’appréciation de l’une ou l’autre. -

Théorie de la relativité : éléments
satinvelours a répondu à un(e) sujet de aliochaverkiev dans Sciences
Le « temps » commun à A et B va être ainsi posé par Einstein : « Nous posons par définition que le « temps » [ici temps = durée] requis pour aller de A à B est équivalent au « temps » requis pour aller de B en A pris par la lumière». Ainsi est défini le synchronisme des deux horloges. Autrement dit si le rayon de lumière part de A au temps t(A) [indication de l’horloge] et arrive en B au temps t(B) puis s’il est réfléchi en B toujours au temps t(B) et revient en A au temps t’(A), alors les deux horloges sont synchrones si t(B) - t(A) = t’(A) – t(B). Les deux horloges sont synchrones en fonction de la vitesse de la lumière. Einstein fait donc dépendre les indications des horloges non plus d’un temps absolu mais de la vitesse de la lumière. C’est la vitesse de la lumière dans le vide qui devient un absolu, un invariant universel. On remarquera que le temps (durée) mis par la lumière pour aller de A à B est égal au temps mis pour aller de B en A quelle que soit la vitesse du référentiel contenant A et B. La vitesse de la lumière est la même dans un sens comme dans l’autre quelle que soit la direction de la vitesse du référentiel. Autrement dit même si le référentiel inertiel est animé d’une vitesse allant dans la direction de A vers B, la vitesse de la lumière de A à B est égale à la vitesse de la lumière de B à A. Si AB est la distance de A à B alors le rapport 2AB / (t’(A) – t(A)) est égal à V (ou c) constante universelle de la vitesse de la lumière dans le vide. Le rapport 2 AB / ((t’(A) – t(A)) est constant quelle que soit la vitesse du référentiel inertiel contenant A et B. -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
C'est cette idée que nous nous emparons d'un certain nombre de choses que la vie nous offre, à commencer par la sensation, la recherche de sensations plaisantes, donc une certaine addiction toujours possible au plaisir, que nous en passons par là et qu’à l'intérieur de cette configuration nous projetons l'existence d'une certaine façon. Nous la voyons d'une certaine façon, nous l'interrogeons d'une certaine façon et l'interrogeant d'une certaine façon, nous ne pouvons en obtenir que des réponses que nous analysons aussi d'une certaine façon. Il nous faut éprouver nous-mêmes les limites de cela pour justement voir que pousser au bout c'est la mort nécessairement, et que si ce n'est pas la mort c'est de toute façon ce à quoi nous prétendons échapper qui nous rattrape, c'est-à-dire l'ennui. Le fait que Don Juan lui-même est obligé d'enchaîner sans aucun répit conquêtes sur conquêtes montre cette inanité profonde. Son être n'est rien, il est ce pur mouvement de séduction. De la même façon que chez Sartre notre être n’existe pas. Ce que nous sommes c'est l'ensemble de nos actes et donc c'est notre transcendance. C'est pour cela que la conduite séductrice est une conduite de mort. Dans ces mythes nous avons vu le côté brillant, le côté affirmation de la vie, le côté dionysiaque. C'est notre héritage méditerranéen, notre côté latin. Il y a une lecture scandinave de tout cela dont Kierkegaard est un des représentants. Une part d'obscurité des mythes les plus solaires de notre culture. Il y a la puissance qui s'enivre de sa propre puissance de séduction, le désir qui s'enivre de lui-même c'est Don Juan . De l'autre côté c'est Faust qui a une conduite réactive au désir c'est-à-dire qu'il est déçu du savoir, la science ne lui apporte rien, en tout cas il n'y a pas de science de l'existence. La science ne nous apprend rien sur comment vivre, comment fabriquer notre bonheur. On peut être très savant et être misérable et lamentable dans sa propre vie. C'est parce qu'il a lu tous les livres et qu'il est toujours aussi malheureux que Faust va découvrir le désir. Le désir est donc réactif. C'est quelque chose qui est censé réparer ce que la science est incapable de lui donner. Donc caractère subjectif de la sensation. Au sein de ce stade esthétique et avant de voir Don Juan il nous faut nous arrêter sur la conception de la femme, de la féminité. Kierkegaard va tenir sur la femme un discours paradoxal. Il parle de la femme d'abord comme l'être que l'on adore « l'homme s'approche en adorateur… Je dis en adorateur, car tout soupirant l'est vraiment ». Il faut souligner le « vraiment » qui a l'air d'attester d'un discours sincère et en même temps sur la sincérité, c'est-à-dire le soupirant est vraiment, réellement, sincèrement en adoration devant l'objet aimé et Kierkegaard semble en faire lui-même le constat sincère. Mais il rajoute ce qui fait et l'ambivalence et le paradoxe de son propos que le prétendant en demandant la jeune fille qu'il aime en mariage «sacrifiait à l'illusion ». Essayons de comprendre cette posture ou à la fois cette adoration de l'objet aimé et une conscience lucide du côté du soupirant qu’en convoitant la jeune fille, en la demandant en mariage il ne fait que sacrifier à l'illusion. Ici Kierkegaard est encore très hégélien. Pourquoi le soupirant sacrifierait-il à l'illusion ? -

« Boire un grand bol de sommeil noir... »
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Littérature
La soleá Vestida con mantos negros piensa que el mundo es chiquito y el corazón es inmenso. Vestida con mantos negros. Piensa que el suspiro tierno, y el grito, desaparecen en la corriente del viento. Vestida con mantos negros. Se dejó el balcón abierto y al alba por el balcón desembocó todo el cielo. ¡Ay yayayayay, que vestida con mantos negros! La soleá ( transcription de la prononciation andalouse de soledad, solitude, nostalgie, et prénom féminin) est un chant mélancolique, accompagné de parole et de danse (Poésies II). Traduction : toujours par Pierre Darmangeat Vêtue de voiles noirs Elle pense que le monde est bien petit Et que le cœur est immense. Vêtue de voiles noirs. Elle pense que le tendre soupir Et le cri, disparaissent Dans le courant du vent Vêtue de voiles noirs. On a laissé le balcon ouvert, Et à l’aube, par le balcon Tout le ciel s’est jeté. Aïe ! Aaah !... Vêtue, oui, de voiles noirs ! -

« Boire un grand bol de sommeil noir... »
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Littérature
SEVILLA Sevilla es una torre llena de arqueros finos. Sevilla para herir, Córdoba para morir. Una ciudad que acecha largos ritmos, y los enrosca como laberintos. Como tallos de parra encendidos. Sevilla para herir. Bajo el arco del cielo, Sobre su llano limpio, dispara la constante saeta de su río. Córdoba para morir. Y loca de horizonte mezcla en su vino, lo amargo de don Juan y lo perfecto de Dionisio. Sevilla para herir. ¡Siempre Sevilla para herir! Poème de la saeta. La saeta est un chant bref, lancé, crié presque, au passage de la statue du Christ lors des procession de semaine sainte : impressionnant il troue de sa flèche le silence de la foule. (Poésies II) Traduction : Pierre Darmangeat Séville Séville est une tour Pleine de fins archers. Séville pour blesser Cordoue pour y mourir. Une ville qui épie De longues cadences, Et qui les enroule Comme des labyrinthes. Comme des sarments Enflammés. Séville pour blesser ! Sous l’arche du ciel, Sur sa plaine limpide, Elle décoche la constante Flèche de son fleuve. Cordoue pour y mourir. Et, folle d’horizons, Elle mêle à son vin L’amertume de Don Juan, La perfection de Dionysos. Séville pour blesser Toujours Séville pour blesser ! (Rien ne vaut le texte original, même si la traduction ne trahit pas) -

« Boire un grand bol de sommeil noir... »
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Littérature
Alba Campanas de Córdoba en la madrugada. Campanas de amanecer en Granada. Os sienten todas las muchachas que lloran a la tierna soleá enlutada. Las muchachas de Andalucía la alta y la baja. Las niñas de España de pie menudo y temblorosas faldas, que han llenado de luces las encrucijadas. ¡Oh, campanas de Córdoba en la madrugada. y oh, campanas de amanecer en Granada! Celui-ci aussi, que j'aime, fait partie de Poema de la soleá. toujours aussi beau. -

« Boire un grand bol de sommeil noir... »
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Littérature
Puñal El puñal entra en el corazón, como la reja del arado en el yermo. No. No me lo claves. No. El puñal, como un rayo de sol, incendia las terribles hondonadas. No. No me lo claves. No. (Toujours Federico, toujours El cante jondo) -

« Boire un grand bol de sommeil noir... »
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Littérature
Fusilamiento Van a fusilar a un hombre que tiene los brazos atados. Hay cuatro soldados para disparar. Son cuatro soldados callados, que están amarrados, lo mismo que el hombre amarrado que van a matar. —¿Puedes escapar? —¡No puedo correr! —¡Ya van a tirar! —¡Qué vamos a hacer! —Quizá los rifles no estén cargados... —¡Seis balas tienen de fiero plomo! —¡Quizá no tiren esos soldados! —¡Eres un tonto de tomo y lomo! Tiraron. (¿Cómo fue que pudieron tirar?) Mataron. (¿Cómo fue que pudieron matar?) Eran cuatro soldados callados, y les hizo una seña, bajando su sable, un señor oficial; eran cuatro soldados atados, lo mismo que el hombre que fueron los cuatro a matar. Nicolás Guillém poète cubain (Poème extrait de Sóngoro Cosongo y otras poemas). -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Ceci va être manié dans une dialectique subtile chez Kierkegaard puisque à la fois c'est ce qui est recherché par l'esthète et en même temps il en connaît les dangers. Il va falloir à la fois rechercher cela et se protéger du danger qui serait que à trop ne viser que les plaisirs on finirait par ne plus rien contrôler. C'est ce qui menace « le sensuel grossier ». Or l'esthète est tout sauf un sensuel grossier. C'est ce qu'avait compris les grands libertins de fin XVIIe et XVIIIe siècles. Dans les analyses que fait Kierkegaard des deux grandes figures Don Juan et Faust, on voit que plus il analyse ces deux grands mythes plus il met en avant le fait que ce n'est pas la possession des femmes séduites qui les intéressent, cela ça les ennuient. Il le dit bien pour Don Juan. Ce qui l’intéresse c'est de croire qu'il est capable de construire une arme, l'arme absolue. On est dans une machine tout à fait intellectuelle. La passion est évitée, elle est dangereuse et remplacée. Ceci ne peut conduire qu'à la mort. Si nous poursuivons uniquement dans le droit fil de l'esthétique, cet ennui que nous cherchions à éviter qui ronge déjà les préromantiques et les romantiques nous le réintroduisons à l'intérieur même de la conduite séductrice. Il faut à Don Juan démultiplier le nombre de conquêtes, séduire de plus en plus de femmes parce qu'il supporte de moins en moins l'interstice qu'il y a entre deux conquêtes. A partir du moment où Don Juan (Mozart) provoque le Commandeur à dîner, qu'il soutient ce repas et qu'il provoque la mort, démontre bien de façon rétroactive qu’il a toujours su que cette conduite n'avait de sens que dans un défi permanent jeté à la mort et en même temps que son être ne tenait que dans ce défi. Si je ne peux plus défier la mort au travers de l'Eros je n'existe plus. Nous sommes en permanence des êtres en perspective, des êtres en devenir. Si l'on admet cela, on ne peut arrêter ce flux (Héraclite) cela veut dire que notre demande de vérité nous devons la mettre dans la même perspective, elle est le produit de notre évolution et de notre rapport au temps. Nous sommes toujours dans l'illusion par rapport à nous-mêmes. Notre demande de vérité sur nous-mêmes est travaillée par le temps. Elle est donc toujours porteuse d'une illusion. Jamais nous ne posséderons la vérité objective et absolue sur nous-mêmes. Ce que nous voulons savoir sur nous-mêmes c'est quelque chose qui est formé et qui est le fruit de notre histoire et dans cette histoire, nécessairement, du temps que nous avons vécu, de ce rapport au temps. Donc notre demande de vérité change elle-même dans le temps, ce qui veut dire qu'elle est elle-même dans cette illusion absolument générale. Les stades, que Kierkegaard va découper artificiellement dans ce flux, cela correspond à cela. -

« Boire un grand bol de sommeil noir... »
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Littérature
-

« Boire un grand bol de sommeil noir... »
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Littérature
Je te disais que ma conception concernant la traduction était tout à fait personnelle. Mais bien entendu il faut traduire. -

« Boire un grand bol de sommeil noir... »
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Littérature
Tu as « osé » traduire La guitarra. J’aime bien. Je n’ai pas voulu traduire le poème. Il y a une émotion, une musique que je ne retrouve pas. Mais c’est une perception tout à fait personnelle. La poésie de Lorca, pour moi, est une vibration musicale, que je ne retrouve pas lorsque je traduis ou lis les traductions. On dit toujours que traduire c’est trahir, néanmoins traduire est nécessaire.