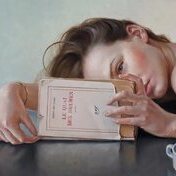Rechercher dans la communauté
Affichage des résultats pour les étiquettes 'les domestiques'.
1 résultat trouvé
-
En dehors des domestiques de très grandes maisons qui passaient souvent leur vie entière au service du même maître, il existait beaucoup de « bonnes » et de domestiques occasionnels, qui venaient pour la plupart de la campagne, de la province, venus à Paris dans l’espoir de gagner plus. On retrouve rarement plus de trois personnes au service d’un bourgeois aisé. La majeure partie des domestiques sont employés par de grands aristocrates et de très riches particuliers. Chez les d’Harcourt il y a 15 à 20 personnes en 1877. En 1906, 35 domestiques servent la maison parisienne du prince Murat et 80 sont occupés, à l’aube de la Première Guerre mondiale, dans ses domaines d’Ile-de-France. Le domestique représente d’abord un prestige social. Beaucoup de ménages font des sacrifices financiers disproportionnés à leurs revenus, pour pouvoir montrer leur appartenance à la bourgeoisie. Et bien sûr les domestiques ont une fonction utilitaire. C’est la totalité de l’entretien de la maison et des personnes qui leur échoit.Suivant le niveau social, le travail sera réparti entre les domestiques et les services (bouche, appartement de réception et table, appartements privés et linge de maison, écurie et remises, plus les institutrices et gouvernantes) ou cumulé par la bonne. Un bon serviteur… Un bon serviteur doit être discret. Il doit savoir protéger les secrets de la maison, et, mieux encore, en apprendre le moins possible. Le serviteur doit être « invisible ». L’usage de la sonnette facilitera ceci. Un bon serviteur doit être honnête. L’obsession du vol prend une ampleur sans précédent dans ces foyers où l’on n’entretient qu’une seule « bonne à tout faire » au prix de sévères privations. Les morceaux de sucre sont comptés dans le sucrier, on vérifie le nombre de couverts etc.., le serviteur est voué à vivre dans une ambiance de suspicion permanente. Un bon serviteur doit être d’une patience à toute épreuve et subir sans moufter remontrances, accusations, mépris, mauvais traitements,supporter le monologue de son maître tout-puissant (qui use de la troisième personne pour s’adresser à lui, c’est la règle générale). Un bon serviteur doit avoir le physique de l’emploi : La prestance et la beauté font toujours partie des critères de recrutement (pas trop non plus : on craint la bonne trop jolie). La force, l’allure, la constitution correspondront, dans la mesure du possible, à la fonction qu’on lui destine. Un bon serviteur doit être propre. Malgré des conditions d’hygiène rudimentaires, le domestique doit se laver régulièrement. Les femmes portent un bonnet sur leurs cheveux et pour servir à table, le port des gants blancs (cachant souvent des ongles noirs) est obligatoire, ainsi que celui d’un tablier propre. Un bon serviteur doit être constamment disponible. La journée de travail compte de 15 à 18 heures. Dans la première moitié du XIXe siècle, on permet des « repos » utilisés pour l’instruction ou l’éducation religieuse. Après 1850, on ne s’encombrera plus de ces préoccupations. Le domestique est corvéable à merci et on attend de lui un dévouement absolu ! C’est ainsi que les domestiques sont logés par leurs maîtres, dans l’appartement même, ou dans les fameuses « chambres de bonnes » (le plus confortable) au dernier étage des immeubles, de façon à être disponible en permanence. La plupart du temps, un débarras s’ouvrant sur la cuisine sert de logement. Et ceci est encore confortable, car bien des bonnes n’ont qu’un lit pliant dans la cuisine. Toute vie personnelle de la bonne est ainsi confisquée. Le logement Les domestiques sont éloignés de l’intimité familiale, dans les chambres mansardées du dernier étage, « les sixièmes », accessibles par le seul escalier de service. Pas de chauffage, peu de lumière, et en été on étouffe sous les mansardes. Dans le meilleur des cas, un point d’eau unique alimente l’étage où l’on peut trouver jusqu’à plus de trente « chambres ». Lemanque d’hygiène et l’insalubrité sont tels que les sixièmes deviennent de véritables foyers de tuberculose, dénoncés par les médecins. La promiscuité qui règne entre domestiques des deux sexes achève de faire des « sixièmes » un monde physiquement et psychologiquement difficile à supporter. Le salaire, le travail Les salaires sont très bas, surtout en province. Comme par le passé, ils sont réglés par l’usage, et liés à la capacité, au crédit du domestique et à son sexe. Il s’agit bien d’un salaire, rétribuant une location d’ouvrage, et non plus de gages. A ce salaire s’ajoutent le pourboire (de plus en plus interdit), les étrennes (1 à 1,5 mois de salaire en 1900), les gratifications et cadeaux, et les avantages reconnus : le don de vêtements, la vente des graisses et des cendres, le « sou du franc ». La nourriture fait partie des avantages en nature, mais (sauf dans les grandes maisons) elle est souvent médiocre et insuffisante : soupe, pain et restes de la table des maîtres. Sur ce poste l’on fait de sordides économies, afin de pouvoir s’offrir une servante supplémentaire qui ajoutera au prestige social… Dans les grandes maisons, la répartition précise des tâches permet un travail moins pénible. Mais pour la bonne à tout faire c’est autre chose… Imaginons ce que représente la corvée de bois et de charbon, la corvée d’eau pour le nettoyage de l’appartement, la toilette, la cuisine, la lessive…quand l’eau courante n’existe pas. Pas de produits d’entretien performants pour laver et frotter les parquets, astiquer les cuivres, traquer la poussière dans les appartements croulant sous les tissus, encombrés de petits meubles et de bibelots en tous genres. La cuisine n’a d’autre aération qu’une petite fenêtre sur cour, la pièce est surchauffée par le fourneau et la lessiveuse, saturée d’humidité par les vapeurs et le linge qui sèche… La cuisinière, la bonne à tout faire qui passent leur vie là, dans une atmosphère viciée, attrapent le fameux « rhumatisme des cuisinières », la tuberculose, et s’intoxiquent à l’oxyde de carbone. La condition psychologique La crainte et la méfiance des maîtres s’accompagnent d’un mépris profond. Les serviteurs sont considérés comme des inférieurs, des sous-hommes, porteurs de tous les vices et capables de tous les excès. Indispensables, ils sont pourtant gênants. Tout l’effort du XIXe siècle tend donc à les rendre invisibles : ils sont dépersonnalisés, on leur confisque leur prénom, on les écarte le plus possible des lieux de vie, ils sont niés en tant qu’individus, privés de toute vie personnelle. Le domestique connaît la plus terrible des solitudes, dans une situation de dépendance totale. Il en résulte jusqu’à des troubles mentaux : la « névrose des domestiques », pouvant mener au suicide. Dans certaines grandes maisons, la promiscuité des sixièmes, les traditions de la campagne (d’où sont issues les bonnes, en majorité) favorisent ces névroses. Le contraste est frappant avec l’apparente austérité de la bourgeoisie et de la noblesse provinciale. Apparente seulement : le « forçage » des jeunes bonnes est «presque une tradition dans certains milieux de province ». La bonne est ainsi soumise aux désirs de son patron, ou du fils de la maison. Une grossesse (vite survenue vu les moyens de contraception de l’époque) provoque en général le renvoi, l’avortement ou même l’infanticide, le suicide parfois, souvent la prostitution. Vers 1900, la moitié des prostituées sont d’anciennes bonnes. Les maîtres ne sont pas les seuls responsables. D’autres domestiques, plus âgés, ou chargés du recrutement dans les grandes maisons, abusent de leur position. Le nombre d’enfants naturels des servantes s’accroît. L’abandon, l’avortement, l’infanticide sont fréquents. Dans les maternités créées après 1850 pour recevoir les filles enceintes, la moitié au moins des patientes sont des domestiques. On voit augmenter considérablement l’infanticide à partir de la suppression des « tours », sorte de guichets qui permettaient d’abandonner un enfant à l’hospice de façon anonyme. Les grandes maisons, moins nombreuses au fil des années, réduisent leur train après 1870 : le personnel masculin diminue sans cesse, notamment à cause du progrès technique (il faut moins de serviteurs pour conduire et entretenir une voiture que pour s’occuper de plusieurs chevaux et carrosses). Parallèlement, le nombre de foyers de petite bourgeoisie, avec « une bonne à tout faire », s’accroît sensiblement. La religion enseignait aux maîtres à laisser du repos au domestique et à respecter certains jours fériés, mais l’obsession de rentabiliser au maximum le temps de travail des serviteurs fera qu’une demi-journée de repos par mois paraîtra suffisant à la fin du siècle. Ce n’est qu’après la guerre que l’on reviendra à un peu plus d’humanité. On pourrait croire que l’évolution technique contribuerait à alléger les conditions de travail, mais non. Quand les ascenseurs existeront, la bonne continuera d’emprunter l’escalier de service. Le début d’un progrès ? Au XIXe siècle, la prise de conscience de l’isolement grandissant des servantes, le problème posé par leurs grossesses, voit se multiplier les organismes de charité se chargeant de l’accueil et de la réinsertion des servantes malades, enceintes ou au chômage. Peu à peu va naître l’idée que pour répondre aux difficultés, il est nécessaire de former les domestiques. Les premières écoles ménagères apparaissent au début du XXe siècle. Curieusement, l’Etat s’abstient de toute intervention jusqu’en 1914. La domesticité semble toucher de trop près à la famille pour qu’il s’y risque. Manque d’intérêt électoral ? Les domestiques n’ont pas le droit de voter (jusqu’en 1848), ils sont inéligibles et sont sous la contrainte du livret jusqu’en 1890 (livret aboli en 1930). Socialement les domestiques ne s’inscrivent dans aucune des grandes lois sur la protection ouvrière (travail des femmes et des enfants, accidents du travail, repos obligatoire, repos desfemmes accouchées – il faut attendre 1909 pour que la grossesse ne soit plus un motif légitime de renvoi). Même l’âge limite d’embauche des jeunes (13 ans) ne s’applique pas : on peut employer un enfant à tout âge s’il va à l’école. La domesticité s’inscrit trop bien dans la société et elle est trop mal organisée pour se rebeller. Avec retard sur le monde ouvrier, naîtra tout de même le syndicalisme des gens de maison : les premiers journaux datent de 1885, la première chambre syndicale de 1886. Encore s’y intéresse-t-on essentiellement au problème du placement, d’ailleurs le seul domaine dans lequel l’Etat va réellement tenter d’intervenir : règlementation des bureaux de placement, lutte contre l’escroquerie à l’embauche par l’institution de bureaux gratuits dans chaque arrondissement de la capitale. Un échec, les institutions municipales n’ont jamais réussi à concurrencer sérieusement les bureaux de placement privés. La guerre de 1914 marque la vraie rupture. Le nombre des domestiques baisse nettement. Les femmes, qui avec la guerre ont pris le chemin des usines et des ouvroirs, préfèrent cela à la place de « bonne à tout faire ». Les plus instruites trouvent un débouché dans les emplois de bureau. Après la guerre, les jeunes refuseront de devenir domestiques : un travail trop dur, des contraintes trop fortes, pour un salaire trop bas, et surtout le manque de considération en sont cause. Le mépris est devenu insupportable.