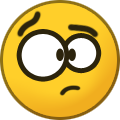-
Compteur de contenus
3 006 -
Inscription
-
Jours gagnés
1
Type de contenu
Profils
Forums
Blogs
Calendrier
Vidéos
Quiz
Movies
Tout ce qui a été posté par satinvelours
-
Ici le récit poétique, le Grand Meaulnes, n'a pas pour vocation de tuer le monde. Il a vocation à voir un arrière monde. C'est davantage le symbolisme de Rimbaud. Fournier lit beaucoup Laforgue et James jusqu'à ce qu'il rencontre en 1906 Claudel et en 1910 Péguy. Dans la correspondance Péguy/Fournier il partage l'importance de la terre, c'est-à-dire l'attachement charnel à la réalité du paysage de son enfance, pour ce qui concerne Alain Fournier. Lorsque Le grand Meaulnes est paru la presse à souligné essentiellement l'attachement à la terre, et a fait du livre une sorte de livre Barrésien sur l'enracinement dans la France la plus profonde. L'histoire se passe dans le Cher et en Sologne, une région qui a échappé à l'industrialisation et à la modernisation. Un pays où on peut encore croire à des histoires extravagantes, ce qui n'est plus le cas dans un pays rationalisé, un pays où vivent des enfants qui croient à cette aventure. Alain-Fournier construit un roman avec des personnages suffisamment naïfs pour croire aux miracles. Il fallait ce paysage rural pour que puisse encore se développer une ferveur et une disponibilité au miracle, et ce livre il voulait « l'écrire pour les hommes simples, les instituteurs et les paysans ». A la réception du livre ce n'est pas la dimension poétique a été relevée mais l'attachement à la France et à la terre. La force du livre, la puissance d'attraction tient à la conjonction des deux choses, mystère et réel, exigence spirituelle incarnée par Augustin Meaulnes, et la terre paysanne rurale. L'un allant avec l'autre. Le personnage devient un support d'impression ou de rêverie. C'est ce qui va construire le roman. Dans une lettre à sa sœur en 1906 il annonce qu'il veut écrire un roman sans personnages, le récit à l'état pur et réitère ce projet dans une lettre à Jacques Rivière « Les personnages ne sont et ne seront que le flux et le reflux de la vie et de ses rencontres ». Son histoire ce sont des rêves qui se rencontrent. C'est un récit poétique car le personnage est transformé. « Je ne ferai du roman avec ses personnages que des rêves qui se rencontrent. J'emploie ce mot rêves parce qu'il est commode quoique agaçant. J'entends par rêve vision du passé, espoir. Une rêverie d'autrefois, revenue, qui rencontre une vision qui s'en va, un souvenir d'après-midi qui rencontre la blancheur d'une ombrelle et la fraîcheur d'une autre pensée. Il y a des erreurs de rêve, des fausses piste, des changements de direction et c'est tout ça qui vit, qui s'agite, s'accroche, se lâche, se renverse » Lettre 13 août 1905 à Jacques Rivière. On entend très bien le fonctionnement analogique de l'imaginaire d'Alain Fournier. Le temps subjectif sera privilégié dans le roman. Il ne renonce pas au romanesque, mais c'est un romanesque de l'intériorité. Le maître mot d'Alain Fournier est le mot merveille. Le monde est une merveille exposée, non pas tellement devant nos yeux, mais surtout nos âmes, et la vocation du poète ou de l'écrivain c'est donner distance à cette merveille par la prose et la prose poétique. La prose est au service de l'évocation des instants qui sont des instants d'extase. Ce romanesque de la théorie de l'intériorité a une position, celle d'émouvoir le lecteur. C'est comme si le réel touchait une première fois le poète et provoquait cette prose poétique, et comme si la prose poétique à son tour touchait le lecteur. C'est un peu contre le roman français jugé trop cérébral et rationnel. « Moi je ne crois qu'à la recherche longue des mots, je ne crois qu’à la poésie ». C'est un culte de la merveille, une exaltation spirituelle, chrétienne qui explique la résonance qu'a eu sur Alain-Fournier la lecture de Claudel et la rencontre de Péguy. Dans le Grand Maulnes il y a le culte de la pureté, de la hauteur, associé au culte de la chasteté. « Mon style se satisfait d'une seule image pourvu qu'elle puisse enfermer un monde pour des âmes profondes. C'est en cela que je serai plus aristocrate et d'un seul mot pourvu qu'il affirme, c'est ici que me tente le christianisme ».
-
Très succinctement et le plus concrètement possible, je dirai que le symbolisme est un mouvement de pensée pour dire le monde par les images et les symboles. Le monde tel qu'on le voit n'est qu'apparence, il est une autre réalité, celle du mystère, de l'invisible. Il se manifeste surtout dans la poésie, Baudelaire précurseur, puis Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, mais aussi dans les romans avec Dujardin, Gide ou Claudel. Il se veut une rupture avec le naturalisme. Il y a un rejet du monde mécanisé et matérialiste. Le poète, le romancier s'est engagé, il s'est doté d'une mission : suggérer les mystères de ce monde. Le positivisme c'est le matérialisme, le rationalisme. C'est un mouvement à l'inverse du symbolisme. Le positivisme considère que l'homme ne peut atteindre les choses que par l'expérience (A. Comte). La réalité, telle l'intuition, est totalement rejetée. Seuls les faits éprouvés par l'expérience ont une valeur reconnue universellement. Seule l'expérience peut justifier une vérité et l'affirmer.
-

La decouverte de l'être des choses : Parménide
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Une fois que le sujet s'est étonné, c'est à nous de réfléchir. Pourquoi Parménide n'a pas annoncé un sujet pour cette affirmation ? Il présente une troisième personne au présent d'un verbe sans sujet, en l'occurrence le verbe être. Dans une phrase il y a un sujet et un verbe. Par exemple « la voiture roule ». Quand il y a un sujet le verbe nous donne des informations sur le sujet, mais le noyau de signification de la phrase c'est le sujet, c'est la voiture. À partir de ce sujet je me demande ce que fait la voiture : elle roule. C'est pourquoi sujet en grec veut dire substance. C'est la substance sur laquelle je dis quelque chose : La voiture roule... Pierre écoute. Les choses sont plus claires lorsqu'il y a le prédicat. C'est toujours le sujet qui est le noyau de la signification. Autre exemple, la voiture est blanche, Audrey est belle. Blanche et belle ne disent rien tant que l'on n'utilise, ou ne place pas le sujet. Si Parménide n'a pas proposé un sujet c'est dans le but de faire réfléchir. Dans toute phrase, sujet-verbe, le noyau c'est le sujet. Mais Parménide voulait que la vedette soit le verbe. La seule façon était de ne pas écrire un sujet. Si nous entendons la phrase « roule » à la troisième personne, nous ne savons pas qui roule. Mais nous savons qu'il y a l'action de rouler. Cette action existe. Déjà une troisième personne au présent « roule » nous informe d'une activité qui est en train de se dérouler maintenant, même si l'on ne sait pas encore qui déroule cette activité. Si Parménide dit tout simplement « est » dans le sens de existe, être présent, c'est parce qu'il veut attester, montrer qu'il y a maintenant la présence de quelque chose. Présence à la troisième personne d'une activité. « Roule » présence de rouler « est » est la présence de l'être. C'est-à-dire s'il y a la possibilité de dire « est » troisième personne du singulier, c'est parce qu'il y a l'infinitif du verbe. Au niveau linguistique, si on peut dire X écoute c'est qu'il y'a la possibilité d'écouter et on constate alors que quelqu'un est en train d'écouter. Si on dit « est » troisième personne du verbe être c'est parce qu'il y a la possibilité d'être. On constate alors que quelqu'un est en train d'être. Derrière le mot "est" troisième personne du verbe être se cache l'infinitif qui possibilise la troisième personne. Parménide va profiter d'un fait de langue pour philosopher. S'il n'y avait pas le verbe écouter il serait impossible de dire Untel écoute. Si on dit Untel écoute c'est parce qu'il y a le verbe écouter. On suppose d'effacer le sujet : on dit écouter tout simplement. On ne sait pas qui écoute mais on sait qu'il y a l'activité d'écouter, qu'il est possible d'écouter parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter. Et si quelqu'un est en train d'écouter, c'est qu'il y a le verbe écouter derrière : l'attention. Quand Parménide dit « esti » il est présent, il ne fait que confirmer au présent une activité, un étant, et cet étant représenté par une troisième personne renvoie à l'origine de cette troisième personne. De la même manière que roule renvoie à rouler, écoute renvoie à écouter et est renvoie à être. C'est la conséquence philosophique phénoménale. S'il n'y avait pas de l'être, l'existence, il n'y aurait pas la possibilité d'exister, il n'y aurait pas la possibilité de dire j'existe, tu existes nous existons... C'est parce qu'il y a de l'être qu'il y a des étants. Etant est le participe présent du verbe être. Ce n’est pas encore de la philosophie, mais Parménide va s'interroger sur la signification du verbe être, que veut dire être ? Comme il utilise le verbe être à l'ancienne il sait déjà que être veut dire être là, être présent. Donc cette signification du verbe contamine toutes les formes du verbe. Cela veut dire on existe : les choses, les êtres humains. En grec comme on n’a pas besoin d'un sujet une fois qu'on a déchiffré cette anomalie il serait étonnant qu'il n'y ait pas de l’être dans tout ce qui existe si tout ce qui existe possède de l’être. Quand un grec parle des choses, il parle des étants : « ta onta ». Onta est le participe présent du verbe être au pluriel. Dans le participe il y a la signification de l'infinitif. Dans la langue grecque quand nous disons les choses, quand nous disons étant nous disons quelque chose qui est présent. Etant hérite de la signification du verbe être parce que c'est le participe du verbe être. Un étant est une chose qui est en train d'être. Être en train d'être veux dire en grec existe. Lorsque Parménie pose comme point de départ le chemin qui conduit à la vérité en un seul mot c'est une incitation pour que celui qui va se consacrer à la philosophie prenne le point de départ absolu. C'est, il y a des choses. Comme il y a des choses, il faut philosopher et se demander que sont les choses. C'est une autre question. Mais la première question c'est « il y a ». Cela veut dire les choses sont là. Choses dans le sens grec, il y a des étants. Parménide se place volontairement au-delà du point de départ des autres philosophes. Les autres philosophes admettaient qu'il y avait des étants, mais ne posaient pas la question de savoir quelle était l'origine des étants, de quoi étaient-ils constitués, quel était l'élément des étants. Parménide aurait dit : avant de se pencher sur la constitution des étants, il faut dire « il y a » des étants. Et comme il y a des étants on va chercher les causes et les principes. Pour nous c'est tellement évident que ce n'est pas une question essentielle, mais s'il n'y avait pas des étants, il n'y aurait rien. S' « il y a » c’est qu'il y a de l'être. Parménide est conscience du poids de cette découverte « il y a » des étants . C'était une vérité incontestable, préalable. C'est pour cela que Parménide la présente comme un axiome. Qui pourrait nier qu'il y a de l'être ? En tout cas pas un étant. Nous sommes tous des étants. Comment pourrait-on nier qu'il y a de l'être. Ce serait suicidaire. Ce que veut Parménide c'est que l'apprenti philosophe prenne cette certitude et l'inculque dans son cerveau et qu'à partir de cette certitude il philosophe. La faiblesse d'un point de départ différent consisterait à croire que les étants, les choses qui sont, possèdent le monopole de l'être. Il est évident que tous les étants sont périssables. Parménide veux montrer que l'être se trouve dans les étants, comme le verbe être se trouve dans toutes les formes du verbe être. Une chose sont les étants qui naissent, périssent, se fabriquent, se corrompent, une autre chose est le verbe, le fait d'être qui fait être les étants comme une sorte d'énergie, de dynamique. Par exemple le soleil serait l’être, et tout ce qui est illuminé serait les étants. Les étants après le soleil meurent, mais le soleil reste toujours. C'est une force, une dynamique. Dès qu'il est présent dans les étants, il fait que les étants soient. Voilà ce que Parménide a découvert. Si toutes les choses sont, c'est qu'il y a de l'être. Cela ne veut pas dire que toutes les choses existent de la même manière, il y aura ensuite des niveaux de réalité. Il y a des êtres intelligibles, des êtres sensibles, des êtres imaginaires. Mais tout est. Les êtres imaginaires sont l'objet de mon imagination, les êtres intelligibles sont l'objet de ma pensée, les êtres sensibles sont l'objet de ma sensation. De quelle manière Parménide démontre cela. Il démontre par l'absurde -
Influence du symbolisme. Base de référence : Le grand Meaulnes. Comment le récit poétique qui fait face au roman ironique s'est élaboré ? Le récit poétique se préoccupe davantage du sujet et son rapport problématique au monde. Le monde urbanisé tel qu'il est devenu au XIXe siècle est une menace pour le sujet, et le recul vers la rêverie, l'intuition, va répondre à cette menace. Une nostalgie apparaît à la fin du XIXe siècle, idéaliste et mystique, nostalgie à l'égard de tout ce qui a été abandonné par le positivisme et le scientisme et que l'on peut qualifier de l'âme. C'est un mot récurrent chez les poètes, les romanciers et les philosophes. Des écrivains en Allemagne, où de développement industriel est plus avancé, expriment cette méfiance par rapport au monde trop technicisé, de même en Angleterre avec Virginia Woolf et Joyce où le monologue intérieur se développe par méfiance à l'égard du monde. Parallèlement à la production du grand Maulnes d'Alain Fournier, il y a une réflexion intéressante du poète Pierre Reverdy sur l'image et sur la puissance d'émotion de l'image. Est remise au premier plan une valeur qui a été particulièrement délaissée c'est l'émotion, car l'écriture moderne est une écriture essentiellement rationnelle. En France on observe aussi une sorte de repli vers le subjectif, l'émotion, l'image. Le Grand Meaulnes, ce roman poétique est considéré comme un récit prophétique, repli vers le sujet, méfiance à l'égard du monde, intuition de la guerre à venir. C'est un repli vers le subjectif, l'émotion, l'individu. Autre roman 1887, premier monologue intérieur avant Joyce « Les lauriers sont coupés » d'Edouard Dujardin. C'est une première exploration « du drame d'une âme ». Il y a une très importante influence de Rimbaud qui a marqué parmi les romanciers Gide et Claudel. L'intuition que « je » est un autre, le XIXe siècle le développe avec une tendance marquée au mysticisme. Importance de Huysmans et de Dujardin. Huysmans a d'abord été très proche de Zola, il faisait partie du cercle de Médan, avant de rompre radicalement avec le naturalisme en 1884. Le roman « A rebours » qui est une forme décadente expose le monde comme l'objet d'une rêverie. La France se prend d'engouement pour les écrivains du nord de l'Europe tel Ibsen, Wagner qui représentent une ouverture à l'idéalisme et au renouveau auxquelles aspirent les générations de 1910. Certains romans de la fin du XIXe siècle annoncent le roman de 1910. Le récit poétique explore le drame de l'âme du personnage qui est désancré, isolé de tout ce qui est anecdotique. Il est une totalité à lui tout seul mais rêvant sur le monde. Il y a là une intuition d'un mystère. Au-delà de la nostalgie pour la spiritualité il y a une tendance religieuse, une sorte d'au-delà du scientisme, du relativisme. Ce n'est pas une régression. L'idée très fortement exprimée par Alain Fournier est que le mystère est incorporé au réel. Il s'agit de prendre conscience intuitivement du mystère dans la chair de la réalité. Le réel est bien là mais il est habité par quelque chose qui le prolonge et lui donne une dimension supplémentaire. Le récit poétique n'est pas un récit à énigme. Il n'y a pas de révélation du mystère. Le grand Maulnes est l'histoire d'un pressentiment et d'une foi, foi dans un désir, dans une aventure intense. Le trajet du personnage consiste à avancer vers le domaine sans nom et ce qui le pousse vers ce domaine c'est la certitude qu'il a d'un mystère incorporé aux pierres. L'idéal est dans la réalité. A partir de 1907 Alain Fournier écrit à Jacques Rivière « Moi je ne veux pas connaître le monde en dehors de mon âme ». Le monde apparaît comme l'objet d'une représentation, il faut connaître le monde et non le nier, il faut le voir à travers son âme. Le monde fait lever des images. Ce roman est une sorte de glissement vers le poétique. Il quitte le registre de l'épique pour emprunter le registre du lyrisme. Dujardin, lui, est profondément marqué par Wagner, Mallarmé et Dieu. Il y a une unité mentale autour du mystère, d'une croyance. Mallarmé a davantage amené l'idée que le langage tue l'objet, donc la réflexion de Mallarmé sur l'acte de création poétique est une réflexion qui annule l'objet.
-

La decouverte de l'être des choses : Parménide
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
C’est la suite de l’exposé qui projètera et mettra en lumière ce que tu viens d’ecrire.. Je publierai la suite plus tard. -

La decouverte de l'être des choses : Parménide
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Quelle est la portée de cette découverte ? Cette question de l'être des choses n'est pas une question abstraite, elle concerne l'existence de la réalité. L'être des choses est quelque chose qui existe, ce n'est pas un être suprême, une divinité. Non, c'est l'être qui se trouve dans toutes les choses qui existent. Avec Parménide nous sommes au sixième siècle avant notre ère, avant Saint-Thomas, avant Jean-Paul Sartre et l'existentialisme ! Oui parce qu’à un moment donné il y a eu cette distension entre essence et existence. Saint-Thomas c’est l’essence, Jean-Paul Sartre c'est l'existence. Mais voilà qu'un grec à cette époque le 6ème siècle avant notre ère, essence et existence c'est la même chose. C'est un seul mot, le verbe être avec deux nuances qui dépendent de la phrase. Chez Parménide l'être des choses il s'agit de l'existence des choses. Il n'y a pas cette distension qui par la suite deviendra classique. Parménide présente sa philosophie comme un cours donné dans un poème philosophique. Dans ce poème, un jeune homme veut devenir philosophe, et part à la recherche d'un maître à penser, d'un maitre de philosophie. Ce maitre à penser c'est une déesse anonyme qui fait un discours à l'intention du jeune homme. Parménide qui est le maître de recherche responsable va conseiller ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Il y aura deux parties dans le poème philosophique présenté par Parménide. Parménide présente son poème d'une manière très didactique car il veut toucher un public plus large que le public habituel d'un traité. Il s'exprime en vers. Mais à part ce côté didactique Parménide veut convaincre ce jeune homme, qui veut devenir philosophe, du bien-fondé de ce qu'il a découvert. Le cours de philosophie commence par la présentation d'un axiome Qu'est-ce qu'un axiome ? C'est une affirmation que l'on pose sans la démontrer. Un axiome ne se démontre pas. On déduit ensuite des conclusions. Si les conclusions sont valables, l'axiome devient confirmé. Parménide part donc d’un axiome qui est un seul mot mais qui a un poids philosophique monumental. Parménide veut que ce jeune homme intériorise ce mot, qu'il assume ce mot. A ce moment-là il pourra devenir un philosophe, car il pourra déduire des choses à partir de ce mot. La déesse dit que le chemin qui va conduire vers la vérité consiste à penser que est « esti ». C'est la troisième personne du verbe être en grec. Le verbe être en grec c'est « einai », et « esti » est la troisième personne du verbe einai . Mais que veut dire être en grec, einai est l'infinitif, esti est la troisième personne du présent singulier. On peut traduire ce mot par « est ». Comme un paradigme. La déesse dit que le chemin qui conduit vers la vérité consiste ou commence par la pensée de « est ». Mais Parménide d'une manière volontaire imite les anciens. Il insiste, il imite les poèmes homériques, hésiodiques, il prend des clichés anciens. C'est quelqu'un qui volontairement écrit comme les anciens. Dans la terminologie parménidienne il y a aussi cette nuance de terminologie ancienne. Parménide utilise le verbe être à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il fait ressortir qu'elle était la valeur originaire du verbe être. Il y a déjà un message. Quand nous écoutons le verbe être il faut être conscient que nous héritons d'une tradition. Quel est le sens originaire du verbe être ? Le verbe être en grec dérive d'une langue indo-européenne. A l'origine la racine du verbe être est synonyme de vivre, respirer. Dès que le grec se constitue comme langue cette nuance « biologique » disparaît. Mais dans le verbe einaï, infinitif, dans tous les modes du verbe, il reste quelque chose de l'origine. La valeur originaire déjà en grec c'est d'exister, être présent, être là. C'est un sens plus concret que le sens verbe être copulatif est. En grec dans le mot esti il y a cette notion d'être présent, d'exister. Déjà le verbe exister en latin c'est «ex-sistere ». Sistere veut dire se tenir debout, être dressé. Quand quelqu'un utilise le verbe être dans le sens originaire il faut tenir compte de cette nuance. Donc lorsque la déesse de Parménide dit que le chemin qui conduit vers la vérité consiste à penser « est », en grec s'entend : existe, est présent, se trouve là, il n'y a pas de sujet. Parménide ne dit pas il est où elle est. Il dit existe, présent. En grec on peut utiliser des personnes verbales sans sujet, en français ce n'est pas possible, il faut ajouter un sujet vide : le « il » qui n'a pas de sens, par exemple : il est possible, il est préférable. C'est un « il » formel qui n'a pas de sens. Dans certaines langues on n'a pas besoin, comme en français d'un pronom. Mais Parménide viole une règle de la langue grecque. En grec on n’a pas besoin du sujet lorsque ce sujet a été déjà exposé, exprimé, présenté dans une phrase précédente. Dans la phrase suivante on suppose que le sujet est le même que nous avons utilisé auparavant. Le sujet n'est pas repris par le pronom. Par exemple : la définition de la vérité proposée par Platon. La vérité consiste à dire des choses qui sont telles qu'elles sont. On ne répète pas les choses qui sont, même « elles » peut être supprimé. En grec la vérité consiste à dire des choses qui sont, que sont. Mais dans le poème de Parménide, dans les phrases précédentes il n'y a pas de sujet et cela va à l'encontre de la langue. C'est une violation de la syntaxe grecque. Pourquoi cette entorse à la langue ? Justement pour étonner l'auditeur. Le poème était récité. A ce moment-là quand quelqu'un écoutait cette phrase, il se demandait ce que voulait dire Parménide avec ce « est présent, existe », sans sujet. Si Parménide réussi à étonner son auditeur la partie est déjà gagnée. Parce que l'étonnement c'est l'origine de la philosophie. Celui qui s'étonne est déjà sur le chemin de la philosophie. Aussi bien Platon qu’Aristote placent l'étonnement comme l'origine de la philosophie. Dans le Théétète de Platon et dans la métaphysique d'Aristote tous les deux disent exactement la même chose, l'état d'esprit qui déclenche l'activité philosophique c'est l'étonnement : « thaumazein » le fait de s'étonner, l'émerveillement. Celui qui ne s'étonne pas ne sera jamais philosophe. En revanche le philosophe s'étonne même des choses les plus banales. Les choses les plus banales peuvent susciter un étonnement et Aristote dit cet étonnement nous conduit à chercher la cause de certaines choses. Une fois que nous avons trouvé la cause de notre étonnement, il y a un autre étonnement qui survient : il serait étonnant que les choses ne se produisent pas de cette manière une fois que nous avons trouvé la cause. Parménide veut susciter l'étonnement. -

La decouverte de l'être des choses : Parménide
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Je propose une réponse. Depuis la nuit des temps il existe chez l’être humain le désir de s’expliquer la réalité. Les grandes questions ont toujours été proposées par des civilisations lorsqu’elles sont arrivées à un certain niveau de culture : la mort après la vie le jour après la nuit… les réponses se trouvent dans les récits mythiques, la civilisation grecque comprise. Il y a des mythes qui ont raconté l’origine des choses, de l’homme, d’un certain ordre cosmique. Ces récits mythiques restent anonymes. Dès qu’il y’a un auteur le mythe n’est plus admis. J’avance une hypothèse. Je ne pense pas qu’il y ait une coupure totale entre ce qu’on appelle la pensée mythique et la pensée rationnelle. On disait avant les travaux de Jean-Pierre Vernant que la philosophie consacre le passage du mythe à la raison. Ce n’est pas sûr. D’abord il y a des sujets principaux pour lesquels les mythes proposaient une réponse, origine du cosmos et l’ordre du cosmos. Ce qu’on appelle les mythes fondateurs dans n’importe quelle culture, c’est l’origine du cosmos, c’est l’origine de l’ordre que l’on voit dans le cosmos. Qui a mis de l’ordre ? Le hasard, la nécessité, les dieux ? Ces questions ont trouvé des réponses dans toutes les civilisations dans des mythes différents. Ces deux questions on les trouve aussi chez les premiers philosophes. Il y a un glissement du mythe à la philosophie. Les premières réponses ont eu lieu dans un univers mythique, dans les récits mythiques, cosmogonie, mythologies. Il y a aussi une coïncidence en ce qui concerne les questions à propos desquelles on trouve des réponses dans presque toutes les civilisations. Ces questions tournent autour de l’origine du cosmos de l’origine des choses et de la régularité que l’on trouve dans l’univers. L’origine de la régularité l’origine de cet ordre que l’on voit dans le devenir quotidien. Parménide est certainement l’héritier de toutes ces questions qui se sont posées dans toutes les civilisations à travers des mythes. Mais les récits mythiques sont anonymes, Parménide a existé, laissé un nom, des fragments lus par des contemporains. I Il y a une différence entre Parménide et Héraclite. Héraclite ne s’occupe pas de la découverte de l’être des choses comme Parménide, mais de la découverte du sens de la réalité. Il découvre qu’il y a une sorte de norme, de règle grâce à laquelle l’univers est un cosmos.Pourquoi l’univers est un cosmos, pourquoi l’univers est ordonné. Il n’y a pas le chaos. Un cosmos ne se trouve pas dans les éléments, il se trouve dans une loi cosmique qui établit un ordre dans l’univers. -

La decouverte de l'être des choses : Parménide
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Vous êtes très clairvoyant ! Je rôde ici mon sujet avant de le transmettre à mes étudiants !!! Ou, a contrario... le leur ayant dispensé j’en rapporte le contenu sur le forum !!! Plus sérieusement, c’est un sujet complexe et long et cela demande de la rigueur. Je réfléchis à votre question très intéressante. -

La decouverte de l'être des choses : Parménide
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Parménide conscient du fait qu'il est très difficile de saisir ce qu'il va dire, invente une mise en scène. Il présente ce qu'il veut dire comme un cours de philosophie, comme une leçon, comme un chemin à parcourir. Il y a une petite histoire dans son poème, comme dans les dialogues de Platon. Platon pour dire des choses invente une histoire pour rentrer ensuite dans le vif du sujet. Dans le cas du poème, Parménide se place dans la peau d'un jeune homme qui veut connaître la vérité des choses. Mais évidemment s'il veut connaître c'est qu'il est ignorant, il ne possède pas encore la vérité. Donc ce jeune homme entreprend un voyage le long d'un chemin à la recherche d'un maitre de vérité, quelqu'un qui va lui faire un cours de philosophie. Le point de départ c'est l'ignorance. On commence à marcher le long d'un chemin et les images du poème sont tout à fait homériques, hésiodiques. Un char qui se promène dans le ciel guidé par des filles du soleil qui illuminent le chemin. C'est très poétique. Tout cela se trouve dans 28 vers. C'est un petit texte qui a été conservé en entier. Ce jeune homme commence à voyager, il rencontre une déesse anonyme qui reçoit de bon gré ce jeune homme et lui adresse un cours de philosophie. Puisque tu veux savoir ce qu'est la vérité, écoute moi. Finissent alors les images poétiques. Le cours de philosophie commence à la ligne 29. Il y a 28 lignes qui racontent le voyage imagé, et à la ligne 29 Parménide commence à parler. C'est une mise en scène, la déesse n'a pas de nom propre, simplement Parménide fait un clin d'œil à Homère et Hésiode. Mais la déesse de Parménide est une déesse rationaliste, elle oblige le jeune homme à réfléchir. Il n'y a rien de révélation dans ce poème, il s'agit de la logique pure. Parménide souligne qu'il s'agit d'un jeune homme, un kouros. Cela veut dire que ce jeune homme n'a pas d'expérience intellectuelle, il pourrait donc être séduit par des faux discours. Il y a le chant des sirènes, comme pour Ulysse, qui pourrait tenter le jeune homme. Que fait alors cette déesse anonyme ? Elle fait un discours double. D'abord elle va poser la vérité. Quelle est la vérité des choses ? La première connaissance qu'il faut acquérir et qu'il faut admettre, est qu'il y a des choses. Voilà ce qu'il doit apprendre et ensuite tirer les conséquences, c'est la vérité. Mais la déesse présente aussi un faux discours, un discours séduisant mais rempli d'opinions. Il y a d'un côté la vérité et ce qu'il faut apprendre. Les opinions il faut les rejeter car elles sont subjectives. Le philosophe ce n'est pas les opinions, c'est la vérité. La déesse doit montrer qu'il y a aussi un discours faux, rempli d'opinions, mais très séducteur. Il faut apprendre à résister à la tentation. C'est pour cela que dans le poème de Parménide il y aura deux possibilités : la possibilité positive et le discours négatif. C'est tout à fait didactique. Un bon maître doit aussi suggérer à son étudiant ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Parce que, en réalité, savoir que ce qui est faux est faux est vrai. Donc démontrer que les opinions sont fausses fait partie de la vérité. On pourrait dire que la déesse de Parménide ne va exposer que la vérité. Simplement ce sera exposé d'une manière directe, puis d'une manière indirecte. Il va démontrer de quelle manière il faut se méfier des opinions fausses. C'est un programme d'études. A la fin de cette partie du poème la déesse dit « écoute moi je vais te transmettre quelles sont ces deux possibilités ». On a reçu un morceau complet constitué de 32 lignes. Jusqu'à la ligne 28 il y a cette description de voyage de la ligne 29 à 32 les premiers mots de la déesse et ensuite le texte se termine. Heureusement on a trouvé chez un autre auteur sept lignes qui pourraient venir juste après ce que la déesse annonce. On a placé ce nouveau texte comme un fragment II. C'est presque évident que l'un vient après l'autre. Dans ces 5 lignes nous trouvons le noyau de la philosophie de Parménide. On sait que Parménide a dit « l'être est, le non-être n'est pas » dans ces 7 lignes se trouvent cette formule. Parménide a écrit son texte, mais dans la réception d'un texte philosophique de la part de contemporains, il y a une sorte de décalage. Dans ce qu'un philosophe dit, c’est comme un iceberg, il y a une partie immergée, profonde, c'est le noyau de la pensée du philosophe. Mais peut-être que les contemporains ne le voient pas, ils ne voient peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Et c'est à partir de cette partie émergée que ses contemporains luttent, réfutent, acceptent, combattent. Peut-être que le fond de la chose n'est perçu que quelques siècles après. Dans ces 5 lignes il y a pour les post-modernes le noyau de la philosophie de Parménide. Mais ces 5 lignes sont restées inconnues pendant un millénaire. Parménide a écrit son poème au 6ème siècle avant notre ère, et la première citation de ces 5 ou 6 lignes où se trouve le noyau de la philosophie de Parménide, se trouve chez Simplicius, 6ème siècle de notre ère. Pendant un millénaire personne n'a cru opportun de citer ce qui est le centre de la philosophie de Parménide. Il faut formuler des hypothèses. Pourquoi ? Peut-être que dire l'être est, le non-être n'est pas est si évident qu'il est inutile de le citer. Mais Parménide l'a découvert et peut-être parmi ses contemporains il n'y avait pas le sens de découvrir une notion. Peut-être que la phrase est tellement obscure que personne ne l'a commentée. C'est un mystère ! Si Simplicius n'avait pas cité ces 7 lignes on ne saurait pas aujourd'hui que Parménide a dit « l'être est, le non-être n'est pas ». C'est le hasard. Pendant mille ans personne n'a cité ces 7 lignes pour d'autres raisons. Simplicius trouve quelque chose d'intéressant il cite « car comme l'ouvrage est devenu rare je me permets de citer de longs extraits ». Et parmi ces extraits il y a ce fragment. C'est très important ! Et surtout ce qui est inimaginable, c'est l'écho, l'héritage que ces 7 lignes ont eu pour la pensée occidentale ! -

La decouverte de l'être des choses : Parménide
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
" Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien ? Car le rien est plus simple et plus facile que quelque chose." (Principe de la nature et de la Grâce). Leibniz fait remarquer, non sans ironie, que l'on peut s'étonner qu'il existe quelque chose. Pourquoi l'être plutôt que le néant. S'il y a quelque chose plutôt que rien, c'est que forcément il y a une raison suffisante à l'existence du monde. C'est un argument à développer. -

La decouverte de l'être des choses : Parménide
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
C'est Parménide qui a poussé ce cri « il y a ». C'est à ce moment-là que la philosophie commence. Justement Parménide est très conscient du fait qu'il y a quelque chose de nouveau à dire. Il veut montrer ce qu'il y a derrière quelque chose de banal. Car rien n'est plus banal qu’il y a des choses. C'est cet « il y a » qui fait être les choses. C'est à ce moment-là que Parménide choisit un moyen littéraire capable de réveiller les gens ou les toucher, les captiver, d'abord pour lancer et démontrer ensuite tout ce qu'il a à dire. En réalité le point de départ de Parménide est très facile à saisir du point de vue de la langue grecque. La langue reproduit une structure de pensée. Si nous parlons une certaine langue c'est que nous pensons d'une certaine manière. Comme langue d'origine. Même si on l'on adopte une autre langue, dans des moments difficiles on pense avec les schémas de pensée d'origine. Le point de départ de Parménide c'est en réalité une analyse philosophique de la langue grecque. Pourquoi ? Le mot chose dans le sens général en grec n'existe pas. En grec il y a des mots équivalents au mot chose en français mais pour certaines choses. Par exemple quand il s'agit des affaires en grec il y a le mot « cremata ». Quand il s'agit de choses préfabriquées il y a le mot « pragmata », on parle de choses produites. Mais lorsque l’on veut parler de choses en général il y a en grec le participe présent du verbe être. C'est la forme équivalente du mot chose « ta onta ». C'est un pluriel : les choses. En grec les choses c'est le participe présent de verbe être. La seule façon de faire allusion à la réalité consiste à regarder la réalité comme des étants. Le participe présent du verbe être en français c'est étant. Littéralement « ta onta » sont « les étants ». Ce n'est pas une théorie philosophique, c'est la langue grecque. Le mot chose en français vient du latin « causas », rien à voir avec le mot grec. Déjà le mot grec équivalent au mot chose c'est un participe présent d'un verbe, le verbe être. Choses et être sont déjà unis à l'origine. Un participe est une forme d'un verbe. Le participe étudiant est le participe du verbe étudier, le participe protestant est le participe du verbe protester. S’il n’y avait pas le verbe être, il n'y aurait pas les étants. Les choses possèdent de l’être, de la même manière que l'étudiant possède le verbe étudier, ou un protestant le verbe protester. Que veut dire possède ? Cela veut dire que sans l'un il n'y aurait pas l'autre. Sans l'être il n'y aurait pas les étants. On parle du verbe. Ce n'est pas Parménide c'est la langue grecque. Le mot grec pour faire allusion aux choses nous montre déjà que les choses participent de l'être. De quelle manière les choses pourraient ne pas être si elles ne participaient pas de l'être. De quelle manière y aurait-il un étudiant s'il n'y avait pas le verbe étudier. Comme il y a le verbe étudier il y a des gens qui assument cette action au présent : ils sont des étudiants, ils sont en train d’étudier. S'il n'y avait pas le verbe original, il n'y aurait pas de forme verbale. La spécificité de la langue grecque c'est que pour nommer les choses on utilise le participe présent d'un verbe, le verbe être. Déjà comme le dit Parménide les choses existent, il y a des choses, les choses sont, c'est une tautologie pour un Grec parce que les choses sont des particularisations du fait d'être. Le mot chose, étant, est une forme du verbe être. D'un point de vue linguistique Parménide veux dramatiser l'origine des mots. Nous les Grecs nous appelons les objets des étants. Mais pourquoi nous les appelons des étants ? Parce qu'ils existent. Mais que veut dire exister ? C'est à ce moment-là que la machine Parménidienne se met en marche. Tout le poème de Parménide sera une analyse approfondie de cette notion d'être, d'existence qui se trouve dans tout ce qui est, car tout ce qui est, est appelé par un participe, étant, dont l'origine est le verbe être. A première vue c'est une lapalissade de dire qu'il y a des choses. Mais il faut entrer à travers les mots pour savoir ce que cela veut dire. La tâche du philosophe consiste à saisir la signification du verbe être. Si nous saisissons la signification du verbe être nous saisissons la signification de chose, parce que les choses sont des étants. Une fois que sera saisi ce que veut dire être, le verbe être, nous allons trouver une manifestation de ce verbe être dans tous les étants, dans toutes les choses. Voilà la tâche essentielle du philosophe. -

La decouverte de l'être des choses : Parménide
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
C'est cela. Les philosophes d'aujourd'hui ont laissé tomber cette question à partir de Heidegger, mais pendant 26 siècles les philosophes ont été obsédés par la découverte de l'être des choses. Cette recherche commence en Grèce avec Parménide au sixième siècle avant notre ère. -

La decouverte de l'être des choses : Parménide
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Quelle est alors la pensée transmise par les vers de Parménide ? Les tout premiers philosophes se sont posés des questions sur les principes, les causes, les éléments de toutes choses. Les choses ce sont les éléments cosmiques, l'être humain, les dieux, les classes sociales dans la cité. Quand un Grec utilise le mot chose en général c'est pour ne pas particulariser ce qu'il dit. Les tout premiers philosophes se posaient des questions sur le constituant des choses, les éléments, les principes des choses. De la réalité morcelée, découpée en choses. Or cette recherche supposait qu'il y avait des choses, qu'il y avait une réalité à décortiquer, à étudier, à analyser. La tâche du philosophe consistait à regarder d'une manière spéciale la réalité, les choses pour faire une sorte de radiographie, pour entrer au-delà des apparences, pour voir quel était le principe ou l'élément constitutif des choses. Parménide, en revanche, place la recherche dans une étape préalable, antérieure à celle des philosophes précédents. Parce que selon lui, avant de répondre aux questions sur l'origine et les éléments des choses, il fallait admettre qu'il y avait des choses, il fallait même démontrer qu'il y avait des choses pour pouvoir ensuite les décrire. L'affirmation banale, évidente « Il y a des choses » c'est le point de départ de la philosophie. Personne ne l'avait dit avant Parménide. On philosophait comme si il y avait des choses. Évidemment qu'il y avait des choses, mais il fallait le démontrer et surtout en tirer des conséquences. Que veut dire il y a des choses ? Dans la formule il y a des choses l’important ce n'est pas les choses, l'important c'est « il y a » dès que l'on dit il y a on peut remplir ensuite le sujet avec les choses, les dieux…. -
Il faut tout d'abord placer Parménide dans l'espace et dans le temps. Tous les témoignages accréditent que Parménide était un citoyen d'Elée, il serait né vers la moitié du 6ème siècle. Il était actif à la fin du 6ème début 5ème siècle. On ne sait presque rien de la vie de ce personnage. On sait qu'il était important dans la cité parce qu'il a écrit la constitution de la cité, la politeia, les règles pour gérer la polis. On dit que cette constitution était très bonne puisqu'elle a tenu des siècles. On sait aussi qu'il était médecin, à la tête d'une école de médecine importante. On fait des recherches aujourd'hui au sud de Naples, surtout à Salerne, et on trouve des traces d'une école fondée par Parménide fin 6ème siècle début 5ème. Il a écrit un traité de philosophie qui a fait date. Il a tant fait scandale que ce traité les philosophes devaient l'accepter soit d'une manière aveugle, soit le détruire. Mais il ne peut pas être ignoré. Parmi les philosophes qui ont essayé de détruire ce que Parménide avait dit il y a Platon. Et Platon dans un dialogue « le Sophiste » dit : « le moment est venu de tuer mon père Parménide ». Ce qu'a dit Parménide était tellement fort qu'il fallait soit l'accepter, soit le renverser. Parménide a écrit non pas un traité de philosophie, mais un poème philosophique. Comme tous les ouvrages des présocratiques il n'y a que des fragments de ce poème. L'objet nous est parvenu en mauvais état. Le contenu est tellement original, tellement atypique que même les contemporains de Parménide ont eu du mal à saisir sa pensée. Platon à peine une quarantaine d'années après la mort de Parménide, presque contemporain, toujours la même ambiance intellectuelle, Platon a écrit dans un dialogue Théétète-183e184a- « Parménide m'a paru avoir une profondeur d'une rare qualité. Cependant je crains de ne pas comprendre ses paroles et moins encore la pensée qu'elles expriment ». Déjà pour quelqu'un qui respirait la même atmosphère intellectuelle il était difficile à saisir. Est-ce que le chercheur actuel peut le saisir là où Platon avoue avoir échoué ? Certainement pas ! Platon était mieux placé. Mais il y a un avantage. Parce que dès que le philosophe expose quelque chose ce qu'il dit est l'objet de controverses, il y a des querelles. 26 siècles après nous sommes en dehors des polémiques suscitées par le texte de Parménide et nous possédons quelques pages, c'est un côté positif. Nous pouvons examiner avec plus de froideur que Platon qui était engagé et voulait tuer carrément Parménide. Nous pouvons examiner ce qu'il a dit avec le recul du temps, et grâce aux sciences du texte soumis au test de la paléographie, à la papyrologie, la codécologie nous pouvons traiter un texte comme s'il venait d'être créé. Parménide a écrit un seul poème philosophique sans titre. À l'époque les ouvrages n'avaient pas de titre. C'est un poème qui traite de sujets philosophiques. Tout ce que les présocratiques ont écrit s'est perdu. Parménide n'est pas une exception, son poème s'est perdu comme objet. C'est grâce à des citations que nous retrouvons chez d'autres auteurs que nous pouvons à peu près reconstituer des parties de l'original perdu. Des auteurs moins anciens que Parménide ont cité dans leurs ouvrages des passages de Parménide et ces ouvrages ont été conservés. C'est grâce à cela qu'une tradition manuscrite d'ouvrages qui contenaient à l'intérieur quelques mots de Parménide sont arrivés jusqu'à l'utilisation de l'imprimerie fin du 15ème siècle. A ce moment-là nous trouvons des citations de Parménide dans des ouvrages imprimés. Nous trouvons des passages mais nous ne savons pas où les placer. A l'époque lorsque l'on citait un passage, on ne disait pas : dans le vers 14 de son poème Parménide disait… L'auteur cite : Parménide avait dit que… Mais où placer ces lignes ? Évidemment il y a des passages que personne n'a cités. Ces passages se sont perdus pour toujours. Il reste 19 citations. C'est à partir de ces 19 citations que des érudits ont essayé de situer le poème de Parménide. Ces citations se sont étalées dans le temps, le long d'un millénaire. Le premier qui a cité quelques mots de Parménide c'est Platon 4ème siècle avant notre ère. Le tout dernier citateur c'était Simplicius 6ème siècle de notre ère. Quand Simplicius cite Parménide il dit « je me permets de citer Parménide parce que j'ai le plaisir et le privilège de posséder son texte qui est devenu rare à mon époque », il y a aussi Plutarque et une quarantaine d'auteurs qui ont cité des passages du poème. Il a fallu mettre de l'ordre de ses 19 morceaux, on ne savait pas où les placer. Et l'ordre chez d'autres présocratiques est arbitraire. Dans le cas d'Héraclite on peut placer chaque citation avant une autre ou après, cela ne change guère le texte. Dans le cas de Parménide c'est une exception. Etant donné le caractère méthodologique de sa philosophie, étant donné la rigueur de sa manière de présenter les choses, il donne des pistes pour qu'un intellectuel puisse mettre de l'ordre dans ses 19 fragments. Un ordre qui pourrait respecter dans 80 % des cas la place originale de ces morceaux dans le poème. Il y a une systématicité qui oblige à placer le texte X avant le texte de Z. Il y a un développement ce qui est assez rare. Il y a évidemment quatre ou cinq fragments sur 19 qui sont constitués d'une ligne en vers donc qui peuvent être placés n'importe où. Mais 80 % des citations de Parménide aujourd'hui se trouvent dans le même endroit où elles se trouvaient dans l'original perdu. Parménide est le premier philosophe qui s'est exprimé d'une manière systématique. Il n'y a pas chez les philosophes de son époque un souci de démonstration. Ils s’expriment comme les Oracles, par des proverbes, par des interjections. Bien sûr tout ce que les premiers philosophes ont dit est d'une grande profondeur, mais il n'y a pas de méthode. En revanche chez Parménide il y a une utilisation du principe d'identité, du principe de non-contradiction, il y a un raisonnement par l'absurde, il y a des alternatives exclusives. C'est une méthode. Parménide place la philosophie comme un chemin à parcourir. Et dans un chemin à parcourir il y a un point de départ, des étapes, un point d'arrivée. On ne peut commencer n'importe où. Il y aura un point de départ. La notion de chemin chez lui aura un poids considérable. Le chemin un grec c'est « hodos « methodos »poursuivre un chemin (« metá » qui suit, « hodós » chemin). Un philosophe méthodique, un penseur, un scientifique méthodique, est quelqu’un qui achemine sa pensée, qui met sa pensée à l'intérieur d'un chemin. Sinon c'est le chaos. Quand il y a une suite dans un raisonnement, c'est que le raisonnement s'achemine. Donc il est méthodique. En grec on dit « il suit un chemin ». Le mot chemin dans le poème de Parménide apparaît une vingtaine de fois. C'est le mot-clé. Voilà pourquoi l'on ne peut placer l'une des 19 citations n'importe où. Il y a dans le contenu de la phrase des choses qui renvoient à quelque chose d'antérieur ou quelque chose de postérieur. C'est la première remarque formelle. La deuxième remarque concerne la forme. Pourquoi Parménide a décidé d'écrire un poème dans une époque où déjà les philosophes écrivent des traités ? Les quatre lignes d'Anaximandre font partie d'un traité. Pourquoi a-t-il décidé, lui, de s'exprimer par l'intermédiaire de la poésie ? Si nous regardons la métrique utilisée par Parménide nous voyons qu'il utilise la métrique hésiodique et homérique. C'est-à-dire que volontairement Parménide décide de se placer dans une tradition épique. Il veut écrire comme écrivait Hésiode, comme écrivait Homère. Et non seulement cela concerne la métrique parménidienne, cela concerne aussi quelques clichés. Le poème de Parménide est rempli de clichés homériques, d'épithètes homériques. Tout cela pour que l'auditeur écoute la récitation d'un traité ou d'un poème dans un coin de l'Agora, ou chez des amis, et soit captivé. Ils ont entendu cela chez Hésiode, chez Homère, ce n'est pas la même chose, mais les images reviennent. Une fois que le lecteur a été pris, la philosophie rentre d'une façon directe. Si on commence le poème par « l'être est, le non-être n'est pas » l'auditeur s'en va. Mais si on commence par : « il y avait une fois un jeune homme qui faisait un voyage dans le ciel... ». C'est là le point de départ du poème de Parménide. Une fois séduit il envoie à l'auditeur sa philosophie. C'est pour se placer dans une tradition épique que Parménide décide d'écrire un poème. Les poèmes homériques même si ce n'est pas Homère qui les a écrits, les poèmes hésiodiques prétendent raconter des vérités. Les deux poèmes d'Hésiode commencent par un appel à une déesse « raconte-moi ô muse ce qui s'est passé... » Et la muse raconte. Les gens croient que c'est une vérité. Ce sont des réalités, simplement comme elles se placent dans un passé très lointain, qu’il n'y avait pas de témoins, le poète demande l'inspiration à la déesse. Une déesse qui a vu les événements inspire le poète pour qu'il les écrive. Parménide aussi a une vérité à transmettre, c'est pour cela qu'il rentre dans cette tradition. Mais la vérité qu'il va transmettre n'est pas une vérité mythique, c'est une vérité logique. C'est pour cela qu'il utilise des principes logiques, des arguments. Il veut convaincre, non pas grâce à l'autorité d'une déesse, il veut convaincre par l'intermédiaire d'un raisonnement, il donne des raisons. C'est le premier philosophe qui donne des raisons de ce qu'il expose. C'est pour cette raison que Parménide a décidé d'utiliser la poésie. De plus il est plus facile de retenir un poème à l'oreille et à la mémoire qu'un traité. A l'époque beaucoup de gens connaissaient la presque totalité de l'Iliade ou de l'Odyssée. Ce sont les raisons qui ont poussé Parménide à écrire un poème. Mais je crois qu'il il y a aussi une raison psychologique. Parménide est conscient que la découverte des choses est si importante qu'il veut toucher un public le plus large possible. Il dit « Plus didactique je serai mieux ce sera, plus les gens vont accepter et plus ils discuteront ce que je dirai ». C'est la raison psychologique du choix de la poésie.
-
J'adhère à ce que vous dites. La philosophie n'est peut-être pas grecque, mais c'est la philosophie qui fut pratiquée par des Grecs dans les temps de l'Antiquité. Philosophie dite ancienne, antique « dite » parce qu'elle n'est ni ancienne, ni antique mais fut appliquée par des gens de l'Antiquité c'est-à-dire des origines, de l'avènement, de la naissance de la philosophie, de sa gestation. Il est admis par tout le monde que la philosophie a pris naissance dans les cités grecques ou des Grecs pensaient et parlaient grec, écrivaient grec et parmi ces gens là nous trouvons les premiers philosophes. Les premiers essais de la philosophie se sont faits à l'intérieur d'une civilisation. Le fait que les premiers philosophes appartenaient à la civilisation grecque a créé une symbiose entre la philosophie et la Grèce. Cette origine grecque de la philosophie l'a marquée pour toujours. L'élément décisif qui va produire l'essor de la philosophie, c'est le changement vertigineux de structure de la société grecque entre la moitié du huitième siècle et tout au long du septième siècle. C'est un changement de structure dans la société, le changement que l'on trouve en Grèce et nulle part ailleurs. Ce sont dans les "poleis" les plus prospères qu'il y a des gens qui commencent à discuter. On dit que ces gens philosophent dans les cités, fin du 7ème, début du 6ème siècle. Jean Pierre Vernant : " L'avènement de la polis, la naissance de la philosophie, entre les deux ordres des phénomènes, les liens sont trop serrés pour que la pensée rationnelle n'apparaisse pas. A ces origines solidaires des structures sociales et mentales sont propres à la cité grecque..."
-
Vu hier Les grands esprits. Très bon scénario, cette immersion d'un professeur hautement qualifié dans un collège difficile de banlieue. Une belle histoire. Une belle fiction !