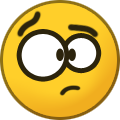-
Compteur de contenus
3 006 -
Inscription
-
Jours gagnés
1
Type de contenu
Profils
Forums
Blogs
Calendrier
Vidéos
Quiz
Movies
Tout ce qui a été posté par satinvelours
-

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Comment vivre dans notre existence et comment l’assumer ? Comment faire que celle-ci soit un accomplissement de soi, même si celui-ci est long et douloureux, et non pas une méprise ou encore une fuite. Il y a chez Kierkegaard une stratégie de la fuite. Je sais que j’ai envie de fuir telle chose et c’est dans cette fuite que peut-être je vais me rencontrer. C’est en assumant la conduite de fuite qu’alors je vais pouvoir faire apparaître de moi non seulement une réalité, mais une vérité. Et cette vérité je vais peut-être pouvoir en faire quelque chose dans un temps ultérieur. Mais il n’en n’est rien. -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Ce travail sur soi nous le retrouvons dans toutes les écoles socratiques. C’est un mensonge altruiste de penser que nous allons d’abord nous tourner vers les autres, et ensuite reconstruire le bonheur. L’une des grandes découvertes de ces philosophies, ce qui les rend humaines, c’est qu’elles montrent bien à la fois la nécessité d’autrui, le rôle de médiation d’autrui, pour certaines de Dieu, mais toujours en nous ramenant à nous-mêmes, en nous poussant par certaines questions qui sont des exigences, à nous assumer sans jamais chercher d’excuses. L’existant est donc celui qui accepte d’assumer l’existence. « De l’existentialisme à Heidegger » Jean Beaufret, Vrin 2000. Premier article de 1945 : « A propos de l’existentialisme » : « L’existentialisme se présente d’abord et avant tout comme une manière de philosopher. La philosophie a pour but essentiel d’exposer l’homme à lui-même de telle sorte qu’il s’y reconnaisse authentiquement » Cela concerne une manière de penser et non l’adhésion à des idées. Le manifeste de Sartre doit être remis dans son contexte de l’époque. Etant attaqué de tous bords il a rédigé ce manifeste qu’il ne faut pas prendre comme un corpus auquel nous sommes censés adhérer. L’existentialisme n’est pas un courant de pensée, c’est plutôt une manière de philosopher. Une certaine façon de poser les problèmes. Exposer l’homme à lui-même. Il faut d’une part montrer l’homme à lui-même, le faire se découvrir lui-même. L’existence étymologiquement, nous l’avons dit, nous conduit à nous situer à l’extérieur de nous-mêmes. En même temps cette situation n’est pas sans risque. Exposer l’homme cela veut dire le livrer à certains dangers. Mais l’idée sous-jacente est que si l’on n’expose pas l’homme à ce danger, il rate son existence. Pour lui, il n’y a aucune possibilité de se reconnaître dans son humanité donc d’assumer son existence et de la vivre de la façon la plus authentique qui soit. Le but de toutes les philosophies existentialistes, c’est d’amener l’homme à prendre en charge son existence et à s’assumer lui-même. Le désir d’exister est alimenté par cela. Toute la question sera de savoir par quel biais allons-nous exposer l’homme à lui-même et qu’entendons-nous par exposer. Ambiguïté du terme qui veut dire d’abord montrer, manifester, étymologiquement poser à l’extérieur mais aussi : livrer, être menacé par quelque chose. C’est en oscillant entre ces deux termes que les philosophies existentielles vont se dérouler. -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Si l'on se réfère à l'étymologie d'exister "ex-sistere" (se tenir à l'extérieur de soi), l'existence c'est essentiellement se projeter à l'extérieur de nous, se faire exister au travers de chacun de nos projets, être nous-mêmes un projet. De ce point de vue exister est de l'ordre du possible, jamais de l'ordre du fait. C'est ce que Jaspers va développer, l'existence est projet. Dire cela va me révéler une nouvelle contradiction à laquelle je vais devoir répondre. Cela sera une des grandes ambitions de Sartre à savoir d'expliquer que je suis projet. J'existe maintenant pour projeter quelque chose, et, par définition, ce que je projette c'est ce qui n'est pas encore, qui est de l'ordre du futur. Dans chacun de mes projets c'est un moi autre que celui que je suis en train de vivre maintenant, qui est en train d'être construit. Cela nous amène à nous concevoir, à nous comprendre. Il faudra vivre cela comme facticité, nous sommes de l'ordre du fait. "Je suis, j'existe". C'est un fait, nous pouvons le constater, mais ce fait n'a de sens que dans cette notion même de projet. Que ce soit sur le mode du désir, de la crainte, de l'espoir, de l'attente, ce ne sont que modalités de ce qu'on appelle projet. Je découvre une nouvelle contradiction en laquelle chacun de nous est tiraillé, ente ma propre facticité et ma propre transcendance. Si je suis descriptible, compréhensible qu'en tant que projet, je ne suis jamais ce que je suis. Je ne peux jamais coïncider avec moi-même. Je suis toujours autre que ce que je prétends. Nous vivons tous avec ce désir cette illusion qui fait que nous pourrions, l'âge aidant, savoir ce que nous sommes. Mais les années n'y font rien. Nous sommes poussés dans le devenir, et, à chaque instant "de devenir" nous continuons à nous transcender dans chacun de nos projets. Ce terme d'"exister" va être en permanence négocié avec facticité et transcendance. C'est ce qui va donner son originalité à la démarche sartrienne qui va raccrocher à la facticité et à la transcendance des thèmes que l'on trouve chez Heidegger et Gabriel Marcel, à savoir finitude et liberté. La facticité me renvoie à ma finitude : je suis un être limité dans l'espace et dans le temps. Si je suis ici, je ne suis pas là-bas. Je pars déjà limité. Mais cela m'offre une chance d'être délimité. Transcendance s'accommodera davantage du terme liberté. Comment faire entre ma finitude et ma liberté ? Est ce que je suis capable d'assumer la finitude de ma liberté ? Le plus souvent non, nous dira Sartre. Toute la thématique de la mauvaise foi sartrienne ne peut se comprendre que comme cela. Comme je n'arrive plus à supporter ma liberté infinie, quand la liberté me pèse trop, je la dénie, je me réfugie dans ce qui est qu'une partie de moi, ma facticité, donc ma finitude, et, à ce moment-là je suis de mauvaise foi. Je fais comme si je n'étais plus libre, je fais comme si je n'avais plus le choix, j'en rabats totalement avec ma transcendance, j'essaie de mettre en avant les limites de ma facticité. Quand je déroge à ma transcendance, donc à ma liberté, pour ne pas être jugé par les autres, pour essayer de sauver mon image sociale que je présente aux autres car elle est fondamentale, ici je suis dans les conditions de la mauvaise foi. Dans "l'Être et le Néant" Sartre analysera beaucoup de conduites de mauvaise foi. Ce n'est pas seulement un jeu psychologique, c'est le résultat d'une impossibilité d'exister, telle que la métaphysique définissait l'existence. C'est l'indice d'une difficulté d'exister au sens où les existentialistes appelleront, définiront, l'existence. L’existence ne se réduirait pas à un concept. Elle se donne à construire un existant. Qu’est-ce qu’un existant ? « L’existant c’est celui qui prend en charge son existence, la modèle, l’oriente et l’assume » Heidegger. Il y a une chose commune à toutes les pensées existentialistes c’est cette très grande exigence de responsabilité. Tous nous disent que nous devons prendre en charge notre existence et l’assumer. L’assumer vis-à-vis de Dieu, l’assumer vis-à-vis des autres, mais surtout l’assumer vis-à-vis de soi. Même chez les penseurs chrétiens on ne commence pas à répondre de soi devant Dieu, mais c’est soi-même que l’on va chercher à assumer. C’est en ce faisant que l’on va pouvoir s’aider à vivre. Si on attend de sa foi religieuse qu’elle achève cette transcendance dans l’homme, cela ne provient pas d’une illumination que Dieu nous apporterait, c’est un travail de soi sur soi, c’est une certaine façon de se positionner vis-à-vis de l’existence, de la prendre en charge, qui alors va nous rapprocher de Dieu. -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Il est intéressant que tu introduises Kant dans cet exposé et que Blaquière cite l’exemple kantien des thalers. Dans l’imbroglio linguistique que je développerai plus tard il sera question de ces fameux thalers réels ou fictifs. -
La subjectivité qui est mise au premier plan n’est pas celle de Van Gogh mais celle du facteur. En 90 Michon publie « Rimbaud le fils » un des textes les plus connus. L’écriture du texte est révélateur de l’élan de l’imaginaire qui est associé au soupçon. Non plus une paralysie de l’imagination – on ne sait pas, il est impossible de savoir donc on n’invente plus rien – mais puisqu’il est impossible de savoir on peut tout imaginer, ce qui est tout à fait différent. « Rimbaud le fils » est consacré à une figure majeure et tutélaire mais à travers les relations de filiation entre le fils et la mère. Le premier personnage du texte n’est pas Arthur, mais Vitalie Rimbaud la mère. C’est une invitation à entrer dans l’évocation de Rimbaud, mais l’enfant fils de Vitalie. C’est une technique qui s’apparente à la technique de la biographie, du roman historique et à une technique romanesque. Il s’agit d’une biographie imaginaire d’Arthur Rimbaud pétrie par le couple parental tel qu’il est évoqué sous la plume de Michon, et la biographie assume absolument la part de fable – « on dit que… il paraît que… » – de spéculation, d’hypothèse. Cette imagination est présentée comme collective dans la mémoire et la culture nationales. Arthur Rimbaud a une existence pour une collectivité qui est « on » et toute cette spéculation nous appartient collectivement. Les biographies d’imaginaire : Vies minuscules, Rimbaud le fils ou Vie de Joseph Roulin sont marquées par le retour de l’intérêt porté au sujet et au dialogue avec le sujet. Ce qui se lit aussi dans cette littérature c’est la nostalgie de l’autre tel que je puisse le rêver et l’imaginer.
-

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Sartre est parti de cette constatation dans "l'Être et le Néant" : "Comment penser le néant ?" En posant quelque chose que je vais nier. Le néant n'est pas une entité en soi mais le produit d'une activité de ma pensée, d'une activité logique que l'on appelle la négation qui consiste à nier. Mais nier c'est toujours affirmer. Pour nier je dois d'abord poser la chose que je dois nier. Cela a des conséquences jusque dans l'éthique, puisque pendant longtemps les philosophes, les théologiens ont toujours affirmé que le mal n'existait pas. Ce que nous appelons le mal n'est que par degrés successifs la négation, la privation d'un bien. Ce qui existe, l'être, équivaut au bien (La République, Platon). Quand nous faisons le mal, nous ne faisons que retirer le bien. "Nul n'est méchant volontairement" Socrate. Nous ne pouvons pas, puisque nous sommes la manifestation de l'être, rencontrer le néant sur le plan logique où le mal absolu comme entité serait mis en regard du bien. Nous sommes prisonniers de l'être. Catégorie première qui est l'être avec des conséquences multiples et variées qui vont peser très lourd dans notre tradition, d'où la théorie platonicienne des Idées. Platon montre qu'un être tient son être, donc va avoir son essence propre, par participation à un degré plus ou moins parfait à l'Être lui-même. Tout ceci doit se comprendre comme autant de conséquences et de résultats de cette place centrale que la métaphysique va conférer à l'être, d'où tout va émaner, dont, tardivement, l'existence. Pourquoi tardivement puisque nous nous éprouvons d'emblée des êtres existants ? Qu'est-ce-qui me fait croire en ma propre existence ? Nous sommes les héritiers d'une pensée qui installe l'être comme catégorie première, qui permet de poser la question suivante : "Y aurait-il quelque chose de défectueux dans l'existence ? Qu'est ce qui peut conduire à la considérer comme un moindre être ?" Dans ce cas pourquoi assiste-t-on à un renversement des positions respectivement occupées par l'être et l'existence dans l'histoire ? A partir du XVII siècle il y a un renversement des choses. Pourquoi progressivement le terme exister va être de plus en plus présent jusqu'à devenir le support de véritables pensées autonomes que l'on appellera pensées de l'existence ou pensées existentielles? Toutes les philosophies existentialistes peuvent de ce point de vue se définir comme autant de tentatives pour assurer l'autonomie de l'existence par rapport à l'être, pour arracher l'existence à l'être. Avec des stratégies diverses. Il faut bien comprendre quelles questions se posent et pourquoi elles se posent. Peut-on penser l'existence ? Si oui, comment la penser ? S'il y a une chose qui échappe à la pensée, c'est bien l'existence. L'examen de : "Comment penser l'existence ? " montre que toutes les voies qui ont été tentées n'aboutissent à rien, sont aporétiques. Nous allons déboucher sur cette idée que l'on trouvera en premier chez Kierkegaard, qui sera ensuite reprise par Jaspers puis Sartre, à savoir que l'existence est toujours, avant tout chose, à vivre. Cela semble un truisme, mais cela ne l'est pas tout à fait. L'existence est à vivre. Le premier à avoir montré l'intérêt de ce qui semble au départ une évidence, c'est Kierkegaard. Dans ses écrits de jeunesse il va régler ses comptes avec la philosophie. La philosophie tue la vie. Il y a une sorte d'antinomie entre vivre et penser. Tous ces philosophes qui ont élaboré des systèmes admirables (Hegel est le parachèvement de l'idée de système) sont passés à côté de la seule chose qu'il serait bon de comprendre : " Qu'est-ce que vivre pour un homme ? ". A partir de Descartes lors du grand rationalisme en France (à ce moment la France était la pensée hégémonique) la philosophie enrichie de la scolastique devient une philosophie savante. Kierkegaard revient au stoïcisme, à l’épicurisme, à toutes les écoles socratiques. Ce sont ces philosophies qui n'ont cessé de s'accrocher désespérément à la vie et dont la seule ambition est : " Que faire de notre pensée pour mieux vivre ?" L'un des postulats à partir desquels Kierkegaard va travailler est que la pensée nous éloigne de la vie, néanmoins il n'est pas pensable de renoncer à penser. Il va essayer d'assumer cette contradiction par une stratégie qui sera l'utilisation permanente de pseudonymes. Le refuge de cet auteur est la pseudonymie. On pourrait dire que la pseudonymie le protège, il n'en n'est rien. Pour lui c'est une façon d'assumer le fait qu'à partir du moment où je suis obligé de penser dans du langage, nécessairement je fracture. C'est le penseur pour qui le vrai, ou la sincérité, ne se rencontre que par une très haute stratégie de mensonge et de la dissimulation, y compris sur le plan amoureux (Journal d'un séducteur). La lecture naïve serait la lecture qui consisterait à voir ce que Sartre appelle un "salaud". Cette machination abominable sur le plan psychologique, moral, atteste un certain désespoir. Comment une relation d'amour peut-elle être authentique ? La réponse est négative. La conduite du narrateur vis-à-vis de la jeune fille séduite est expérimentale. C'est une démonstration mathématique. Cessons de tout enfermer dans des concepts parce que lorsque nous voulons conceptualiser nous tuons. Mais comment vivre sans faillir à cette tâche, qui est la tâche humaine par excellence, utiliser la pensée et la conscience ? -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Ce qui est donné bien sûr c’est d’abord l’existence. L’existence est un fait, l’essence est une idée. L’existence est contingente elle est de l’ordre du constat, du fait. Sartre le dit lui-même : « Je ne peux jamais déduire mon existence ». Comme elle ne se déduit pas, elle n’est pas nécessaire. Nos habitudes de penser nous « enjoignent » de tout penser dans une logique. Sartre ne se place pas dans une logique. C’est en cela que l’existentialisme est révolutionnaire : il initie une autre façon de penser. Bien sûr il est loisible de réfuter Sartre dans une telle démarche, mais pour le comprendre, pas seulement lui mais tous les existentialistes en général, il est indispensable de se couler dans sa démarche. Et on ne peut comprendre la célèbre phrase « L’existence précède l’essence » si nous ne revenons pas sur le positionnement de l’existence et de l’essence. Ce que je ferai plus tard, je me positionnerai sur cette imbroglio métaphysique et linguistique. -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
L'un des gros problèmes de l'existence est qu'elle ne se laisse pas démontrer (Sartre). Nous ne pouvons pas la justifier, donc elle n'est nullement nécessaire. Aucune existence n'est nécessaire. Si aucune existence n'est nécessaire il ne peut y avoir de science de l'existence. Le seul être capable de comprendre cela c'est l'être humain. Il va falloir qu'au sein même de son existence il soit porté par la métaphysique qui s'accroche à l'essence, à Dieu. Si ce n'est pas le cas, il va falloir assumer en permanence cette non nécessité de l'existence réelle, ce que nous appelons sa contingence. Tel est le problème existant majeur. Il y a une sorte d'ambiguïté dans le terme existence. D'un côté il renvoie à l'existence réelle, matérielle, et de l'autre côté il y a tout ce domaine qu'il ne faut pas oublier, auquel nous pensons rarement, parce que notre vie est d'abord engagée avec les autres dans les choses, dans la matière qui nous résiste, c'est cela qui attire notre attention, il ne faut pas oublier cet autre plan qui occupe la pensée. Or la philosophie a à voir avec la pensée. Exister doit se comprendre de deux façons : exister matériellement, exister sur la plan de la logique. L'existence commence à révéler sa fragilité, sa vulnérabilité. De certaine qu'elle était, évidente, la voilà progressivement incertaine. Genèse du concept d’existence, histoire du concept Nous voyons qu'il émerge lentement dans l'histoire, que l'existence apparait comme différenciation que la pensée introduit au sein de l'être. Ce que nous pensons c'est l'être, ensuite par différenciation successive nous allons isoler progressivement une chose que nous appellerons l'existence. Dans toutes nos traditions, l'existence n'est qu'une modalité de l'être. Elle n'existe pas en elle-même, elle n'a aucune autonomie. C'est une façon qu'a l'être de se manifester à nous, d'apparaitre. C'est une façon d'être de l'être. Mais dire ceci revient à affirmer la suprématie de l'être, le primat de l'être sur l'existence. Dire qu'il y a une suprématie de l'être sur l'existence implique deux propositions qui en sont les conséquences. Le primat de l'idée, du concept sur la matière, ce qui revient à dire qu'il va y avoir un primat du logique, de ce qui est pensable, de ce qui est représentable dans la pensée. Primat du logique, de ce qui est pensable sur l'empirique, c'est-à-dire sur l'expérience, sur la matière, ce qui constitue la réalité phénoménale. La réflexion philosophique commence pour nous, dans notre tradition, par une réflexion sur l'être, donc référence à Parménide. Nous trouvons dès le début du poème parménidien la déesse donnant des conseils au jeune homme. Ces conseils s'adressent aux philosophes qui vont, d'une façon imagée, poser les conditions d'intelligibilité des choses. La déesse dit au jeune homme : "A toi s'offrent deux voies, la voie de l'être et la voie du non-être. N'entre jamais dans la voie du non-être. N'égare pas ta pensée du côté du non-être. Le non-être n'est pas pensable donc ta pensée va irrémédiablement échouer". Le non-être n'est pas pensable. Si nous essayons de le penser nous introduisons de l'être de la pensée à l'intérieur même du non-être. Nous sommes en face d'une contradiction insurmontable. "Evite cette voie. Si tu la suis tu seras totalement emprisonné dans des contradictions que tu ne pourras jamais dépasser". C'est une voie aporétique (aporia) un chemin sans issue. La déesse met bien en garde le jeune homme en lui répétant : " Si tu veux penser, ne t'égare pas dans le domaine du non-être, jamais tu ne le saisiras. A essayer de le saisir tu introduiras de l'être au sein même du non-être donc tu n'auras jamais affaire au non-être en tant que tel et ta pensée tournera à vide. Détourne toi de cette voie". Il ne reste donc qu'une seule voie, c'est celle de l'être. "Poursuis sans relâche cette voie". "L'être est, le non-être n'est pas". C'est une tautologie féconde. Cette phrase doit se comprendre dans deux sens. D'une part la pensée ne peut penser que ce qui est (le non-être n'est pas) et on comprend que la pensée pour Parménide est elle-même une modalité de l'être. D'autre part lorsque Parménide dit le non-être n'est pas, il veut dire que tout ce qui est négatif est le fruit d'une sorte de tricherie. Je suis obligé de poser quelque chose, puis de nier cette chose pour avoir quelque chose de l'ordre du négatif. -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Oui. L’être logique qui se réalise dans l’esprit, dans les représentations mentales. « Il y a incertitude relative à la notion de causalité, incertitude soulignée par la physique quantique. La mise en doute du principe de causalité dans certains domaines de la physique sape la notion de nécessité ». -
Pierre Michon est un romancier qui s’est lancé dans une entreprise consistant à tenter de restituer des vies, mais de personnages qui ne sont pas nécessairement des figures importantes ou célèbres pour l’histoire de l’Humanité. En 84 Michon publie un ensemble de nouvelles « Vies minuscules » toutes consacrées à un personnage où revient le nom et le prénom, tout ce qui depuis Kafka avait été aboli. Le nom et le prénom reviennent, c’est-à-dire une identité romanesque. Le personnage n’a aucune prétention à être un héros ou un personnage historique par rapport à la mémoire nationale. C’est un personnage obscur. Il n’est plus anonyme, ni impersonnel, c’est une différence fondamentale, il est quelqu’un mais quelqu’un d’obscur, dont la vie ne ressemble pas à un destin exemplaire aux yeux de l’Histoire. « Vies minuscules » : le titre dit clairement pour Michon qu’il s’agit de s’intéresser aux humbles. Évidemment il n’y a aucune condescendance dans cet adjectif, il n’y a aucun jugement de valeur ni axiologique, mais au contraire il s’agit de restituer ce qu’il peut y avoir de romanesque dans une vie minuscule. Ce qu’il peut y avoir d’élan, de grandeur, de rêve, d’énergie dans une vie minuscule. Chez Modiano on peut très vite détecter la partie personnelle dans son œuvre, Michon, lui, utilise le détour de l’autre pour parler de sa propre nostalgie, de ses propres désirs, de ses propres rêves eux-mêmes inaboutis. Dans « Vie de Joseph Roulin » en 88, c’est le facteur qui livre à Van Gogh son courrier, Michon entreprend de raconter non pas la vie de Van Gogh, mais la vie du facteur, c’est-à-dire qu’il s’intéresse au personnages humble et minuscule qui entoure un génie, même si Van Gogh de son vivant n’a pas été reconnu. Ce qui intéresse Michon c’est le regard du facteur sur Van Gogh, la façon dont un personnage humble, Joseph Roulin, peut voir un artiste, un peintre à qui il livre son courrier.
-
Le nouveau roman, et tout le paysage mental autour du nouveau roman, est marqué par l’obsession de ne pouvoir savoir, de ne pouvoir se rappeler, de ne pouvoir être sûr de ce que l’on se souvient. Au contraire l’effort pour sauver de l’oubli, l’effort pour maintenir une mémoire, c’est-à-dire pour s’inscrire dans une filiation et dans une tradition, essayer de trouver des repères qui avaient été déboutés, cet effort caractérise la fin du XXe siècle. Donc un élan d’imaginaire puisqu’il s’agit de proposer des hypothèses pour saisir, tenter de saisir des figures fuyantes, celle du père, tenter de saisir une atmosphère vénéneuse, celle de l’occupation, ne pas réduire le caractère énigmatique et complexe de la réalité dont on parle, assumer la perplexité et en tout cas sauver de l’oubli. Revient aussi la question de la responsabilité du sujet par rapport à l’histoire. Si l’on admet que l’œuvre de Modiano dans les années 70 s’apparente à une autobiographie fictive : ll’autofiction, d’autres récits de vie sont des imaginations biographiques. Le terme de biographie est réservé à un récit qui prétend répondre de lui devant l’histoire, d’un point de vue scientifique, alors que l’on voit paraître dans les années 80 et 90 un certain nombre de textes : « Vie de… » qui se présente comme des biographies mais des biographies de personnages imaginaires, des personnages humbles.
-

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
On appelle idéalisme tout système de pensée, toute philosophie qui, à l'instar de celle de Platon qui fut le premier de tous les philosophes idéalistes, pose d'abord logiquement, avant toutes choses, le primat de l'être logique sur l'être réel. Le propre de l'idéalisme est de dire : il existe une autre réalité que la réalité matérielle et la réalité matérielle n'est au fond que la représentation de cette réalité supérieure qui est la réalité intelligible, la réalité de l'idée. Platon va tenter de nous montrer que le degré le plus grand de la réalité n'est pas dans la matière. La table n'est jamais qu'une duplication très décevante de quelque chose qui est posée au départ comme étant réelle absolument, vraie absolument. Ce réel absolument on ne le trouve qu'au niveau des pures idées, des purs concepts. Être et exister peut intéresser aussi bien les êtres matériels que les êtres logiques, comme les êtres mathématiques, les idées philosophiques. Ce sont des êtres logiques qui n'ont pas de matérialité. Cette distinction est tout à fait capitale puisqu'elle va nous poser immédiatement un problème, puisque nous ne pouvons plus nourrir la même certitude face à l'existence, laquelle a cessé de nous apparaitre comme quelque chose d'évident, qui ne pose pas de problème, qui est perméable à toute question, qui va de soi. Au contraire l'existence est vouée d'emblée, d'autorité, à ce que nous pourrions appeler une véritable duplicité. 1) Exister c’est être dans la réalité Cette réalité, comme le fait remarquer Descartes, m'est communiquée par l'entremise des sens, lesquels peuvent être trompeurs. Comment puis-je être assuré de l'existence de cette réalité si je suis sans cesse abusé par mes sens ? Si je veux me protéger efficacement de ce risque je suis obligé, dira Descartes, de déserter ce premier domaine de l'existence et de me réfugier dans le second. 2) Exister c’est être dans une pensée Exister ici désigne une existence purement idéale, purement logique. Mais si je privilégie ce sens d'exister au prétexte de me protéger de la tromperie des sens, je rencontre un autre problème. Je risque d'être enfermé dans une sorte de cocon, risque connu des philosophes : le solipsisme. Je risque de me retrouver prisonnier de ma propre pensée, de ne plus pouvoir jeter une passerelle entre le monde objectif, extérieur à moi, objectivement existant, et moi-même. Comment sortir de soi? Car si mon existence n'est assurée que du côté de la pensée, si mon existence est la pensée de mon existence, je suis coupé du monde, coupé des autres. Je ne peux plus retrouver le monde qui m'entoure. Quand Sartre et Merleau-Ponty se sont aperçus des risques encourus par cette stratégie de réflexion et de pensée, ils ont délibérément tourné le dos au sujet et ont essayé de poser comme point de départ un rapport de conscience au monde. Pour Sartre et Merleau-Ponty ce qui est donné au départ ce n'est pas moi face à ma propre vie, ce n'est pas moi tout seul, c'est moi avec les autres dans le monde. Donc je ne suis descriptible que comme un rapport à un ensemble de choses, non pas comme une substance, une entité, mais un rapport. C'est pour cela que l'existentialisme athée français est extraordinairement tributaire de la phénoménologie. On ne peut expliquer cette mouvance de l'existentialisme sans forcément retrouver des a priori, soit au contraire des conclusions qu'apportent à ces penseurs la phénoménologie qu'ils traduisent puisqu'elle nous vient d'Allemagne. Donc si mon existence est la pensée de mon existence, je ne peux plus retrouver le monde qui m'entoure. L'existence n'a rien d'évident. L'existence semble renvoyer à deux plans : - La réalité en s'aidant de la matière. J'existe réellement donc je suis un être dont la matérialité peut être éprouvée. - Exister est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le réel, entre autre ce qui est dans le réel est matériel, mais ce qui nous amène au domaine de la pure pensée, de la logique. C'est le seul domaine où on rencontre à l'état pur la notion de nécessité. Seuls les êtres logiques font apparaitre une relation de nécessité. Si sur le plan logique j'utilise la conjonction "parce que", je pose quelque chose qui est antérieur à autre chose et qui va être la cause de quelque chose qui est conséquent. Au niveau du discours cela fonctionne bien. On est dans la nécessité logique. Quand on rentre dans la réalité c'est terminé (Hume). Dans l'univers matériel et physique on ne rencontre jamais des relations nécessaires à l'état pur. La science pose que telles choses entretiennent des relations de nécessité avec telles autres, elle en a besoin. Ses expérimentations n'ont jamais prouvé le contraire. Nous allons donc dire : telle chose est nécessairement liée à l'autre de telle façon. Cela a-t-il un sens dans l'absolu? Certainement pas. La révolution de la physique quantique est de montrer que lorsque nous entrons dans l'étude de l'infiniment petit, les particules, nous ne pouvons jamais faire apparaître une quelconque relation de nécessité. C'est ce que Heisenberg appelle les relations d'incertitude ente les particules. La nécessité ne se rencontre qu'au niveau de la logique. -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Naturellement je vais poursuivre, et continuer à traiter le sujet d’un point de vue essentiellement philosophique. Il est interessant pour moi de connaître les idées que tu développes à partir de ce concept d’existence. Nous vivons dans une société du spectacle aux antipodes de ce que les existentialistes représentaient. C’est passionnant de se pencher aux sources de cette pensée de l’existence et de se poser la question de savoir à quoi répondent les philosophies existentielles. Comment chaque mouvance d’existentialisme s’empare de ces problèmes et tente de donner une réponse. -

« Boire un grand bol de sommeil noir... »
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Littérature
La femme chez Eluard est interchangeable avec la lumière. Il la divinise.Il lui confie un rôle mystique. Tu te lèves l’eau se déplie Tu te couches l’eau s’épanouit Tu es l’eau détournée de ses abîmes Tu es la terre qui prend racine Et sur laquelle tout s’établit Tu fais des bulles de silence dans le désert des bruits Tu chantes des hymnes nocturnes sur les cordes de l’arc-en-ciel Tu es partout tu abolis toutes les routes Tu sacrifies le temps A l’éternelle jeunesse de la flamme exacte Qui voile la nature en la reproduisant Femme tu mets au monde un corps toujours pareil Le tien Tu es la ressemblance. -
Boire Un grand bol de sommeil noir Jusqu’à la dernière goutte. Paul Éluard –La lumière éteinte. Il infuse à sa poésie la substance de la vie. Tout dépend du regard. Chez les surréalistes il y a cette volonté de susciter, de réveiller l’imagination créatrice. L’image est pour le poète transformée par l’imagination il donne à voir le réel mais transformé par cette imagination. Éluard exprime spontanément ce qu’il ressent, la raison ne domine plus. Ce qui est conscient ce qui est déconcertant c’est qu’il faut travailler pour saisir les images qui surgissent du subconscient il explore toujours le domaine du subconscient. « Tu fais des bulles de silence dans le désert des bruits Tu chantes des hymnes nocturnes sur les cordes de l’arc-en-ciel »
-

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Est-il sérieux de douter de son existence ? "Comment douter de mon existence ?" (Descartes, Méditations métaphysiques : première méditation paragraphe 4 aliéna 4). Il y a une fausse évidence de l'existence qui semble aller de soi. Mais si je veux, comme Descartes, être assuré de la véracité de mes propres certitudes, je vais faire l'effort de mettre en doute ce qui semble irraisonnable, c'est-à-dire l'existence elle-même. "Comment pourrais-je nier que ces mains, ce corps soient à moi" demande le philosophe ? Certes je le peux, mais si je le fais, je suis comparable à ces insensés, à ces fous qui ont d'eux-mêmes une perception erronée. Douter comme le fait Descartes, de son existence est encore témoigner de cette existence dont je doute. Douter est une modalité de la pensée, douter que j'existe est non seulement affirmer de ce fait mon existence, mais affirmer cette existence comme pensée. C'est le sens du célèbre cogito. Ce rappel cartésien nous montre que l'existence est présupposée dans la question de l'existence. Si je me pose des questions sur l'existence, c'est que moi je suis un être existant. C'est un truisme ; mais la chose la plus difficile à exposer. L'existence ne saurait être détachée de moi, je ne puis arriver qu'à une pure tautologie : je suis ma propre existence . Nous avons donc l'impression que le sens commun a tout à fait raison de confondre être et exister. Néanmoins il est remarquable que Descartes découvre cette certitude d'exister au cours d'une réflexion qui concerne les sens organiques. Cette certitude de l'existence que nous croyons posséder dès le départ, si nous nous interrogeons par quel moyen elle se donne à nous, la réponse est la réponse cartésienne : les sens. Nous sommes certains d'exister parce que nous nous sentons. Notre existence se confond ici par les millions de sensations que notre corps enregistre en permanence. En effet les sens nous donnent une certitude immédiate de l'existence de toutes choses. L'existence confondue avec l'être est certaine et immédiate parce qu'elle s'impose à nous d'abord par l'entremise de la perception et des sens. C'est un constat tout à fait banal, mais ce constat va nous conduire à une deuxième confusion. Cette confusion est que lorsque nous disons que quelque chose est, c'est-à-dire existe, nous voulons dire que cette chose existe réellement, dans la réalité matérielle. Être réellement, être vraiment cela veut dire être d'abord, exister d'abord sous une forme matérielle, que ce soit de la nature vivante organique ou de la matière inanimée. Cependant toute la philosophie occidentale à commencer par l'édification de la métaphysique va nous montrer qu'être dans la réalité, être matériellement n'épuise pas le concept d'être, lequel recouvre un domaine beaucoup plus vaste. Que veut dire être-exister ? [ les deux mots restant accolés du fait d'une distinction non encore réalisée dans les esprits] Être-exister signifie être-exister non pas matériellement, mais idéalement. Il y a une modalité de l'existence qui est une modalité logique. Quand je construis un concept dans mon esprit ce concept est, existe, il a une réalité, néanmoins je ne peux ni le voir, ni le toucher. Je ne peux que le concevoir dans mon esprit mais quand même lui donner un degré d'être, un degré de réalité. Cette catégorie d'être est beaucoup plus vaste qu'il n'y paraît puisqu'elle excède complètement cette partie de la réalité où sont les choses matérielles, inanimées et animées. Il y a donc de l'être ailleurs que dans l'univers des choses matérielles qui m'entourent et dont je fais partie. Il y a de l'être au niveau de l'idée, du concept. On peut aller jusqu'à inverser les choses et dire : "Si je peux tracer un cercle géométrique sur un tableau matériellement, réellement, c'est qu'il existe idéalement" c'est-à-dire dans mon esprit il existe un concept de cercle (Platon). Le concept de cercle dont mon esprit dispose c'est ce qui va me permettre de tracer réellement ce cercle. La réalité n'est pas que matérielle, plus exactement la réalité matérielle n'est qu'une petite partie de la réalité. Ce qui m'abuse, c'est que, lorsque je viens au monde, cette réalité s'impose comme étant la réalité. Et ceci me marque d'une empreinte quasiment indélébile. Il faut tout le travail de la philosophie qui est un travail de construction, pour substituer peu à peu à cette empreinte, une reconstruction conceptuelle plus riche. L'être se décline à deux niveaux. Il y a l'être réel qui se matérialise, il y a aussi l’être logique qui lui n’est que pensable. -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Cette dissociation et cette opposition entre être et exister va atteindre un degré extrême dans la philosophie sartrienne puisque Sartre écrit dans "L'existentialisme est un humanisme" : " Tant que nous existons nous ne sommes pas, et quand nous sommes nous n'existons plus". Nous devrons nous demander pourquoi cette antinomie. Comment comprendre que l'existence que nous confondons souvent avec l'être, comment comprendre que nous avons privilégié le verbe être au détriment du verbe exister. Nous employons "le fait est...", nous ne disons pas "le fait existe...". Pourquoi dans nombre d'expressions, alors que nous partons de la certitude que les deux s'équivalent, c'est quand même le verbe être que nous privilégions, que notre langue choisit ? Posons-nous cette question : être n'est-ce pas obligatoirement promouvoir l'existence ? Et si nous découvrions que non, que ce n'est pas forcément promouvoir l'existence ? Qu’est-ce alors exister ? Toutes les philosophies existentielles procèdent de cette question. De cette première question nous allons découvrir d'autres questions qui sont emboitées dans celle-ci comme c'est souvent le cas en philosophie. En se demandant qu'est-ce que l'existence nous allons découvrir d'autres questions qui font problèmes. Il y a donc un nœud de complexités philosophiques autour de l'existence et nous pouvons poser que les existentialismes, en maintenant les pluriels pour l'instant, sont des tentatives de réponses à cela. Qu'est-ce que l'existence ? En se posant cette question, nous éprouvons une sorte de gêne comme si le sujet n'était pas vraiment sérieux. Il semble qu'il y ait une évidence de l'existence. Sartre nous a fait comprendre que c'était une curieuse évidence, elle s'exhibe tout en se cachant. En même temps si nous regardons du côté de la langue, si nous remontons à l'étymologie latine, exister vient de "ex-sistere" qui veut dire se tenir à l'extérieur de soi-même. Il semble qu'il y a une sorte de paradoxe inscrit dans l'existence, dans le sens premier, puisque exister c'est à la fois être présent à soi et séparé de soi. C'est pour cela que l'allemand d'une façon générale utilisera l'expression " da sein", être là. Quand il s'agira de l'existence, telle qu'elle peut se proposer à vivre pour un être humain, l'allemand utilisera "existenz", montrant bien que nous ne sommes pas là, même si nous essayons de décrire les choses d'un point de vue spatial et temporel. Un des fils directeur de toutes les philosophies existentielles c'est de bien montrer que l'existence, certes elle est à vivre, mais elle implique une dimension qui arrache le vivant que nous sommes à son destin biologique, c'est-à-dire, exister n'est pas vivre. Là aussi dans le vocabulaire courant on ne fait pas toujours la distinction, on dit "je vis". Or ce sont des abus de langage parce que la vie c'est le bios, quelque chose qui est descriptible en termes de processus physico-chimiques dont nous sommes les manifestations, de même que n'importe quel type d'organisme vivant. L'existence est quelque chose à décider, à accomplir, à orienter, tous problèmes que ne se pose pas la vie. De même qu'il y a une différence entre être et exister, il y a une violente opposition entre vivre et exister. Si nous n'avions qu'à vivre ce serait beaucoup plus simple, moins douloureux, moins passionnant. L'existence se confond avec ce pur "être-là". Comment sommes-nous-là dans le monde ? -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Tu projettes une approche différente de l’existence, différente de celle de Sartre, le fer de lance de la pensée existentialiste avec le Manifeste. Cette approche différente n’en n’est pas moins très intéressante, elle apporte un tout autre éclairage sur ce thème. -
Il y a un auteur précurseur du roman des années 80, mais tout à fait anachronique au moment où il écrit : c’est Patrick Modiano. Au moment où il écrit il a l’outrecuidance de faire ce qu’il est interdit de faire. Patrick Modiano est né en 45, écrit en 68 au moment où d’autres ont envie de faire table rase du passé et d’oublier qu’ils ont des pères. Lui commence son œuvre en entreprenant une longue recherche spéculative sur l’image de son père. Il est totalement en contretemps par rapport au mouvement des années 70. Modiano est un précurseur de ce qui sera confirmé dans les années 80/90 d’une problématique prédominante qui est la problématique de la filiation et de l’héritage. Dans sa vie l’image de son père est une image fuyante, très énigmatique qui peut donner corps à un personnage romanesque. L’entreprise de Modiano est de tenter de saisir la figure de son père et au-delà de la figure de son père, de saisir le climat « vénéneux » de la France sous l’occupation. A la fin des années 60 il se retourne vers le passé non seulement un passé individuel et subjectif, sa propre adolescence au moment où son père a disparu de sa vie, mais aussi le passé de la France, en particulier l’occupation. Le père de Modiano est juif, lié à des activités clandestines pendant la guerre, ayant connu une sorte de succès commercial un peu douteux au moment de la libération. Tout cela est sondé par Patrick Modiano qui est hanté non seulement par la question d’identité mais aussi par le thème du faussaire et la question de l’authenticité. L’œuvre de Modiano dès 68 avec « La place de l’Étoile » présente un cas tout à fait singulier et donc tout à fait prophétique de questions qu’il va falloir remettre au devant de la scène et qui font réapparaître celles du sujet, et de l’histoire du sujet entre autres, dans la problématique de la filiation et celles de l’histoire nationale. Ce qui demeure non anachronique c’est l’extrême équivocité de ses romans. Il insiste toujours sur la perplexité du narrateur, sur l’équivocité de ce qu’il traverse. Les déambulations dans Paris, la traversée des espaces parisiens sont toujours associées à l’image d’une quête, à l’effort pour saisir un sens, une vérité. C’est marqué par une certaine modernité et ce sont les sujets de l’image du père, ou la question sur la France pendant l’occupation qui sont en contretemps par rapport à la fin des années 60. On peut considérer aussi que Modiano est intéressant parce qu’il présente une forme d’autobiographie fictive. Il travaille à la frange ou au seuil d’un imaginaire romanesque et d’une matière personnelle. Cette mixité entre l’imaginaire romanesque et la matière personnelle est caractéristique de beaucoup de textes de Modiano plus récents que les œuvres des années 70. Les romans de Modiano sont marquées par la nécessité de sauver de l’oubli.
-

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
J'existe signifie littéralement : je suis un être existant. L'existence est toujours objet d'une ellipse, c'est cela que les philosophes existentialistes vont essayer de faire ressortir, de faire apparaître : ce qui se dissimule. Mais que signifie un être existant? Quand on se pose cette question, on commence à rencontrer des petites difficultés. Car je suis un être existant veut dire, premier niveau de transcription, je suis un être réel, un être vrai, un être qui est dans la réalité. Mais dire que je suis un être réel, un être vrai n'a de signification que lorsque je confronte le réel, l'être, et de l'autre côté le néant. Dire que je suis un être réellement existant, un être réel, signifie que je me tiens face au néant. Or cet acte que Sartre étudiera par définition dans "L'être et le néant" l'amène à fracturer le néant, appelé aussi le non-être, à le fondre, le contraindre à s'ouvrir en deux vagues opposées que mon existence va littéralement repousser. En effet il y a le néant d'avant ma naissance, et le néant d'après, après ma mort. De sorte que mon existence pourrait déjà se qualifier comme cette déchirure qu'involontairement j'inflige au néant. Ma mort sera la suture, c'est-à-dire que ces deux vagues de néant vont se raccorder au-delà de mon existence. Lequel d'entre nous n'a pas été frappé d'étonnement, pris de vertige, de nausée pour reprendre le célèbre terme sartrien, face à ce constat? Celui par lequel nous découvrons que nous ne sommes qu'une forme de membrane très fragile qui sans cesse écarte deux aspects du néant. Fragilité ontologiquement extraordinaire de l'existence. C'est peut-être parce qu'il y aura une fragilité ontologique de l'existence qu'il va falloir la doper, la transformer en liberté, en action. Etonnement devant ce double néant dont nous sommes bordés. Réplique de Hamlet, acte III, scène 1 "To be or not to be", où toutes les traductions donnent "Être ou ne pas être". Or, quand nous disons "être ou ne pas être", nous comprenons, nous Français, "exister ou ne pas exister". Bien sûr la réplique d'Hamlet signifie cela. Il y a une méditation d'Hamlet sur la possibilité de quitter cette vie, de cesser d'exister, de mourir, de sauter la vie par le suicide, ou bien au contraire de l'accepter. Suit la tirade où Hamlet s'interroge sur ce qui nous pousse à supporter une vie difficile, pleine de tourments "telle est la question", être, ne plus être, exister, ne plus exister. Mais sous cette alternative, sous cette question s'en cache une autre. Au fond le choix dont il est question ici, au travers de la réplique d'Hamlet est aussi le choix qui ne me porte plus à choisir entre l'existence et la non-existence, mais le choix entre être et exister. D'où une première question qui sera longue quand à son traitement puisque Sartre par exempte s'y est totalement employé dans "l'Être et le néant" : si l'existence ne pouvait se comprendre réellement comme ce qui, en nous, tente d'être sans jamais précisément y parvenir ? Si au lieu de continuer à confondre comme une chose qui va de soi être et exister, nous essayions de regarder, de modifier notre regard ? Si ces deux notions n'étaient pas équivalentes, mais entretenaient des liens conflictuels, antagonistes ? Si d'une certaine façon l'existence n'était pas l'expérience fondamentale de tout être pour essayer d'être, c'est-à-dire pour essayer de réaliser son être, sous entendu : tant qu'il existe son être n'est pas réalisé? Dissociation possible entre être et exister, mise en accusation de l'existence laquelle va très vite montrer sa défaillance et montrer en même temps sa vassalité totale par rapport à cette leçon d'être dont nous verrons que dans la philosophie occidentale elle est première. La première catégorie qui existe est celle de l'être, c'est de l'être qu'il faudra partir pour passer à l'existence, mais cela aura de nombreuses conséquences philosophiques. -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Oui, il est vrai que pour Parménide essence et existence c’est la même chose. C’est un seul mot, le verbe être avec deux nuances qui dépendent de la phrase. Pour lui, (Parménide), l’être des choses c’est l’existence des choses. Cette distension qui par la suite deviendra classique n’existe pas encore. En effet à un moment donné il y a eu cette distension entre essence et existence : Saint-Thomas c’est l’essence, Sartre c’est l’existence. -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
On peut donc se demander quelle est cette existence avec laquelle chacun se confond et qui cependant nous apparaît comme une énigme, laquelle à son tour ne tarde pas à nous apparaitre comme étant l'énigme suprême. C'est-à-dire je ne puis rendre compte, je ne puis justifier ma propre existence, je n'en suis pas l'auteur, je n'en suis pas la cause, l'origine, je n'en suis pas non plus, sauf exception, le sujet et l'instance qui en décidera de la fin. Je suis là, jeté dans l'existence, et cette existence m'apparaît à la fois comme quelque chose qui va de soi et en même temps m'aveugle. Sous cette mauvaise évidence, non pas l'évidence philosophique travaillée, mais l'évidence au sens commun du terme, se cache un abîme susceptible de nous donner cette nausée dont nous parle Sartre. Donc évidence et en même temps énigme suprême car notre être est par définition un être existant. Ce qui nous conduit à noter que, au départ sur le plan philosophique, nous sommes conduits à confondre, à assimiler "être et exister". Nous ne faisons pas dans la vie courante de différence entre être et exister. Lorsque la différence sera faite, elle sera très tardive et sera le fait des travaux des existentialistes. Si on ouvre les "méditations métaphysiques", grand moment de Descartes, celui-ci emploie "être" au sens "exister", à commencer dans la formulation "cogito" : "je pense donc je suis", voulant dire j'existe. Je pense, et par ma pensée j'ai bien la certitude d'exister. Nous avons du mal à ne pas mélanger "être et exister". Nous assimilons être et exister parce qu'il nous semble que notre existence est par définition ce qui fonde notre être. Être ceci ou cela présuppose que tout d'abord je sois, c'est-à-dire j'existe. Je suis, j'existe donc cela semble hors de doute. Cette position va valoir, va s'imposer à deux niveaux, un niveau existentiel et un niveau ontologique. L'ontologie appartient au domaine de la métaphysique, domaine qui essaye de connaître les êtres en dehors de notre portée, les êtres transcendants sur lesquels on ne peut mener aucune expérience, voire expérimentation. L'ontologie est la partie la plus extrême de la métaphysique. C'est une discipline qui remonte à Aristote, est définie par Aristote comme la science de l'être en tant qu'être. "Être-exister" référence à certaines définitions qu'Aristote nous donne dans son ontologie, dans certains livres de la métaphysique, parce que ces définitions vont marquer totalement la pensée occidentale jusqu'à Sartre. Et ce n'est pas par hasard que Sartre a écrit "L'être et le néant". (J'emploie la formule "Être-exister" pour signifier que, pour le moment-chez Aristote- ces deux mots ne sont pas encore significativement dissociés). -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Je n’existe que pour autant que j’ai conscience d’exister. Cela exige donc, littéralement, que je me fasse exister. L’existence est le produit de l’activité de ma conscience qui est toujours en action, sauf sommeil, coma… Autrement dit c’est cela qui génère notre propre existence. Il y a tout un long monologue de Roquentin qui dit penser, ne plus penser, arrêter de penser, faire tous ces efforts pour arrêter de penser, je n’y parviens pas car vouloir cesser de penser c’est penser encore. Ce mouvement est incessant c’est pour cela que j’existe, et en même temps parce que cette existence est d’abord la saisie d’un mouvement interne qu’on appelle la transcendance de la conscience, j’en ai une espèce de vertige. Je suis, mais je ne peux jamais déduire mon existence. La nausée est le vertige devant l’existence. Je ne puis justifier ma propre existence, je n’en suis pas l’auteur. Cette existence m’apparaît comme quelque chose qui va de soi, et cette existence m’apparaît comme un abîme. Tout le roman de la Nausée pourrait se résumer de la façon suivante : la nausée n’est pas autre chose, par les yeux de Roquentin, que l’histoire, le récit, la découverte de l’existence. Dans la Nausée il y a le récit extrêmement précis de ce dévoilement par une conscience qu’est l’existence, en précisant que justement ce dévoilement de l’existence va produire ce sentiment métaphysique, ontologique qui portera le nom de nausée. -
[Reprise d’un sujet publié ailleurs] L’existence pose plusieurs problèmes philosophiques. Mais pourquoi et en quoi l’existence pose un certain nombre de problèmes philosophiques ? La Nausée, 1938 (Jean-Paul Sartre) : « Donc j’étais tout à l’heure au jardin public. La racine du marronnier s’enfonçait dans la terre juste au dessous de mon banc… quand on s’en rend compte, cela tourne le cœur. Et tout se met à flotter ».( la Nausée- collection Folio : p.181) Ce texte nous dit tout ou presque de l’existence. La première chose que dit le texte, qui va tant intéresser les existentialistes, est que l’existence se manifeste en se cachant, invisibilité habituelle de l’existence. Nous sommes donc ce qu’on appelle des existants. Précisément parce que nous sommes des existants nous ne sentons pas, nous ne voyons pas, nous ne remarquons pas notre existence. Le texte de la Nausée est un moment particulier dans le roman puisque le narrateur, Roquentin, assis sur son banc dans le jardin public découvre tout à coup l’épaisseur, la consistance de l’existence. Cette découverte est une découverte très angoissante, très inquiétante : « extase horrible ». Sartre utilise le terme d’extase dans son sens littéral : état dans lequel nous nous trouvons comme à l’intérieur de nous-mêmes. Les choses, dit Sartre, sont pétries, s’enferment dans l’existence, laquelle constitue la pâte même des choses. Nous pourrions décliner la métaphore culinaire, nous mangeons la pâte, mais nous ne la sentons pas. Découvrir tout à coup cette pâte des choses, habituellement dissimulée, est qualifiée par Sartre d’obscène. La découverte de l’existence, si l’on en croit Sartre, n’est pas quelque chose qui va de soi, mais quelque chose qui va peut-être nous révéler une partie de nous-mêmes qu’il faudra ensuite assumer, à laquelle il faudra se confronter. Dans le texte il y a évidemment une découverte majeure non seulement que l’existence est la pâte même des choses et se dissimule, mais aussi qu’elle est contingente (contingent : non nécessaire). Découverte de la contingence de l’existence. « Tout est gratuit, ce jardin, cette ville et moi-même ». Dire que l’existence est contingente revient à dire que nous ne pouvons que constater que nous existons. L’existence est de l’ordre du constat, du factuel. Certes j’existe, je suis, je suis là, « da sein » » dira l’allemand, mais je ne pourrai jamais dépasser ce constat. Comme le dit Sartre « Je ne peux jamais déduire mon existence ». L’existence ne se déduit pas, nous ne sommes donc pas nécessaires. Je suis là, mais j’aurais bien pu ne pas être là. Quand on se hisse à cette notion de contingence, que notre esprit s’empare de cette notion, le résultat de cette extase horrible est que tout se met à tourner, à flotter. Nous commençons à éprouver ce curieux sentiment métaphysique que Sartre va appeler, particulièrement dans son roman, la nausée : la nausée étant ce vertige qui était sans doute le vertige pascalien devant l’infinité du cosmos, à la différence que ce vertige ne va pas se saisir de nous devant l’immensité qui s’ouvre devant nous, mais devant le fait que moi, qui suis ce à partir de quoi le monde et les autres existent, j’aurais pu ne pas exister. Dans cette belle page littéraire se trouve la majeure partie des problèmes philosophiques qui occuperont tous les courants existentialistes.
-
Le roman de soi Bergounioux–Michon–Ernaux. Ces romans se caractérisent par un retour du sujet, de l’affectivité et de l’émotion qui avaient été sacrifiés dans les années 70. Les années 80/90 représentent un retour du sujet mais gardent des traces des années 60/70. Le sujet qui prend la parole à la première personne ou le sujet dont on parle dans une littérature à la troisième personne, n’est pas le sujet triomphant, maître et possesseur de soi-même, sûr de ce qu’il avance, de ce qu’il sait, de ce qu’il fait, que l’on pouvait connaître dans le roman du XIXe siècle. Le discrédit et la crise, d’abord épistémologique puis littéraire, a laissé des traces. Le sujet revient sur la scène du roman mais sous une facette légèrement différente. Là où l’ère du soupçon avait censuré et interdit toute certitude dans la représentation, toute affirmation de soi, toute croyance dans une cohérence narrative, biographique, dans les années 80/90 il y a un retour timide à la représentation, à la subjectivité et au récit de vie. Le récit de vie étant la bête noire de l’avant-garde antérieure. Le soupçon n’est plus assimilé à l’impossibilité de savoir, comme on l’avait vu chez Beckett ou Claude Simon, ou d’assurer quoi que ce soit, le soupçon se convertit en élan de l’imaginaire. Puisque l’on ne sait pas, on peut tout imaginer. Et au lieu d’aboutir à la forme stérilisation d’imaginaire, le soupçon aboutit à un envol d’hypothèses, de spéculations, de rêveries, d’évocations. Ce qui caractérise la littérature des années 80/90 c’est une sorte de nouvel apprentissage de l’imaginaire, de nouvel envol de l’imaginaire donc une réconciliation du roman avec l’évocation, la suggestion, la rêverie. Cela ne se présente pas du tout comme le récit poétique. Ce sont des récits proposés, imaginés et présentés au lecteur comme des hypothèses narratives. Ce qui est conservé dans le mouvement de dépassement de la crise c’est l’approximation, la spéculation et le mouvement toujours conjecturel de la pensée : on suppose que … L’évocation s’apparente à une sorte d’approche de l’autre, ou d’invention de l’autre. Sont conservés dans ces romans de soi, ou de soi par soi-même dans le cadre de la biographie ou de biographie d’autrui, sont conservés ces mouvements de la pensée, mouvements de l’hypothèse, mouvements de la spéculation, mouvements de l’imagination présentés comme tels par le narrateur, proposés comme tels au lecteur. Le lecteur doit partager l’ignorance et le soupçon.