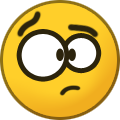-
Compteur de contenus
3 006 -
Inscription
-
Jours gagnés
1
Type de contenu
Profils
Forums
Blogs
Calendrier
Vidéos
Quiz
Movies
Tout ce qui a été posté par satinvelours
-
Bonjour Swannie, En effet, pourquoi la croyance en Dieu, en un Dieu quel qu'il soit, ne serait pas quelque chose qui serait inscrit dans notre patrimoine philo-génétique, dans le patrimoine de l'espèce humaine en tant qu'espèce ? J'ai introduit la morale kantienne dans ce topic, ce fut une erreur. Je vais tout de même en faire un sujet sur ce topic même..
-

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
St Anselme va chercher comment en dehors de toute référence à la foi on pourrait uniquement avec des arguments rationnels convaincre l’incroyant, c’est-à-dire l’insensé. St Anselme va montrer que Dieu dans notre esprit n’est qu’une idée. Il faut donc travailler cette idée. On est là dans le domaine de la raison, puisque la raison travaille uniquement sur les idées. Il s’agit en fait de parvenir à démontrer que l’existence est contenue, incluse dans l’idée de Dieu. L’existence est contenue dans le concept de Dieu en tant que concept. Anselme fait remarquer que l’insensé ne nie pas l’idée de Dieu. C’est une idée qu’il peut parfaitement concevoir, comme il peut concevoir l’idée du dragon, le monstre du Loch Ness. Donc l’incroyant ou l’insensé ne nie pas l’idée de Dieu, mais il nie Dieu comme réalité existante, et fort de ce constat, qui est un véritable truisme, Anselme va fournir un argument montrant que l’existence n’est pas forcément extérieure au concept de Dieu, mais que concernant Dieu elle est contenue d’une façon analytique dans le concept. Sur le plan logique pour qu’une substance puisse être représentée dans notre esprit il faut qu’elle contienne des attributs. Si je dis « chien », cela ne me dit rien. Pour que cela devienne une réalité représentable il va falloir qu’à « chien », substance, je rapporte un certain nombre d’attributs : comment est-il, que fait-il ? Tous ces attributs premiers et seconds vont qualifier la substance et lui donner de plus en plus sa configuration, sa crédibilité donc, d’une certaine façon, son existence. Mais nous avons deux façons de conférer des attributs à la substance. Soit ces attributs nous les cherchons à l’extérieur de la substance, et nous la rapportons de l’extérieur à la substance - nous sommes dans des prédicats contingents qui vont de l’accident jusqu’aux attributs seconds -, soit nous avons affaire à des attributs particuliers qui sont déjà contenus dans la substance, que nous ne pouvons détacher, car si nous les détachions la substance elle-même s’effondrerait. -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Oui, le néant n’est pas le non-être, c’est l’être nié. Il n’est pas le symétrique de l’être. « Le néant n’est pas, il est néantisé par un être qui le supporte ». C’est Heidegger, comme tu le soulignes, qui est à l’origine de ce terme néantiser. L’angoisse existentielle n’est pas la peur qui paralyse et interdit toute praxis, elle est le vertige de l’homme d’action devant l’infinité des possibles qui s’ouvrent à lui et qui n’ont de valeur qu’en ce qu’ils sont ses possibles. -
Ces idées régulatrices sont absolument nécessaires. L’idée de progrès est une idée régulatrice. J’ai besoin de poser que l’humanité accomplit un progrès. J’ai besoin de poser ce postulat, car si je ne le pose pas les vicissitudes de l’histoire sont désespérées, et à ce moment-là je me suicide. C’est le suicide intellectuel, c’est le suicide philosophique. La science dispose de concepts... La philosophie joue sur les concepts, c’est son matériau de prédilection mais le concept se doit d’être dépassé dans certains domaines. La philosophie est dans la nécessité d’excéder le concept. C’est parce que nous sommes dans cette nécessité en philosophie que, rétroactivement, notre vigilance doit être extrême. Le rôle du philosophe et de bien cerner pour lui-même quand il dépasse le concept qui se situe sur le sol de l’idée. Il ne peut pas les travailler de la même façon, depuis Kant en tout cas. Pendant longtemps idée-concept était le produit de l’esprit, de l’intellect, on naviguait entre les deux choses . Il y a maintenant des distinctions conceptuelles importantes.
-
Par exemple je peux construire l’idée de dragon. C’est une idée, ce n’est pas un concept, on ne peut pas vérifier. Cette idée n’est pas aussi important que l’idée de liberté ou l’idée de Dieu. Pourquoi ? Parce que ces idées sont des idées dites régulatrices. Je n’ai aucun moyen de les prouver. Néanmoins je les pose comme étant des principes a priori nécessaires de la raison. Si je ne pose pas cela, ce que Kant appelle le postulat de la raison pratique, aucune action morale dans le monde n’est possible. Certaines idées sont nécessaires comme celle de bien, celle de la possibilité de Dieu ou celle de l’immortalité de l’âme, et Kant va montrer que l’idée de l’immortalité de l’âme a, rétrospectivement, des effets plus positifs sur l’homme que l’inverse. Une morale athée est beaucoup plus difficile à construire qu’une morale religieuse, dérivée de la religion. Toute morale dérivée de la religion flatte la partie animale en nous, c’est-à-dire flatte le côté intéressé. Si j’accomplis la parole de Dieu, nécessairement je serai récompensé. Beaucoup plus difficile est une morale athée. Cette morale athée est presque kantienne d’essence puisque c’est le « tu dois ». Tu dois être moral par amour de la morale, respect de la morale en tant que telle, même si tu ne te réincarneras pas, même s’il n’y a pas de vie immortelle, même si tu disparaîtras et que poussière tu redeviendras poussière.
-

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
3) Preuve ou argument ontologique. Les deux preuves précédentes, la preuve téléologique et la preuve cosmologique manifestent la même faiblesse. Ce sont des preuves qui ne sont pas autosuffisantes, c’est-à-dire que ces deux types d’arguments vont chercher à l’extérieur de l’existence leurs raisons. Elles font état d’un ordre dans la nature, dans le cosmos, d’une harmonie. Ce sont toutes ces idées d’ordre, d’harmonie, de beauté, de fin qui vont servir à « fonder » l’existence, à la justifier, à en rendre compte, à en rendre raison. Il y a là quelque chose qui est logiquement inadmissible et que Kant, entre autre, repérera rapidement, à savoir que l’on présuppose ce qui doit être au contraire démontré. Il est question de démontrer l’existence, et pour démontrer l’existence on a besoin de présupposer l’existence, à commencer par l’existence de l’ordre, de la beauté, de l’harmonie. Il y a un paralogisme, c’est-à-dire une façon erronée de raisonner, une sorte de vice logique qui se cache à l’intérieur du raisonnement et qui fragilise ces arguments. Il nous faut trouver une autre voie, une autre preuve, et cette autre voie on la trouvera dans la preuve dite ontologique, c’est-à-dire la preuve qui concerne l’être même en tant qu’être et qui doit fondre être et exister. Cette preuve ontologique apparait à la fin du XIème siècle, début du XIIème siècle. On la trouve chez saint Anselme qui est le premier à la formuler. Elle va être reformulée par saint Thomas, reformulée par Descartes dans la Vème méditation, anéantie par Kant, reprise par Hegel. C’est un argument qui traverse plus ou moins vaillamment les siècles, et cette pérennité quant à son emploi montre qu’il y a quelque chose dans cet argument qui intrigue, voire qui trouble les philosophes quelle que soit la période à laquelle ils appartiennent. Il s’agit en fournissant cette preuve de réduire tout argument athée et de convaincre, rationnellement parlant, l’insensé, c’est-à-dire l’incroyant, par un argument qui sera absolument rationnel. -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Leibniz dit que ce principe de raison suffisante peut s’appliquer pour répondre à la question que tout être humain se pose : l’existence du monde. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi le monde existe ? Pourquoi l'être plutôt que le néant ? Leibniz fait remarquer, non sans ironie, que l’on pourrait s’étonner qu’il existe quelque chose parce que d’une certaine façon le rien est plus facile que quelque chose. Qu’il n’y ait rien demande moins d’effort, moins de peine, coûte moins de savoir, moins d’énergie. Néanmoins nous constatons qu’il y a quelque chose, par exemple que le monde existe. Donc si le monde existe, s’il y a quelque chose et non pas rien, c’est que forcément il y a une raison suffisante à l’existence du monde et à l’existence. Il est question donc de la contingence du monde. C’est vrai que Dieu avait le choix entre ne pas créer et créer, il a choisi la création, il avait donc des raisons. Le principe de raison suffisante implique un raisonnement de type ce qui existe, existe d’une certaine façon. Ce qui existe, existe ainsi. Mais existe ainsi parce que cette chose a le plus de raison d’exister, a le plus de perfection. S’il existe quelque chose plutôt que rien c’est que l’être, ou l’existence de quelque chose a plus de perfection que la non-existence. Quand je dis A différent de A’ j’exprime un principe de contrariété et je suis dans quelque chose d’équivalent. Il y a deux contraires qui sont posés symétriquement comme contraire l’un de l’autre. Si je prends l’analogie blanc et noir. Le noir a autant d’existence que le blanc, et le blanc a autant d’existence que le noir. Blanc et noir ce n’est pas la même chose que blanc et non-blanc. Le noir est peut-être la couleur opposée au blanc, mais elle existe en tant que telle. Elle n’a pas besoin du blanc pour exister. Est-ce que l’être et le néant peuvent être représentés de cette façon ? C’est justement le problème. Non. Il semblerait que pour ces deux concepts nous soyons, non pas dans des contraires, mais dans une chose qui engagerait la contradiction. Nous ne pouvons pas poser l’être et le non-être comme nous posons l’être et le néant. L’être et le néant ne peuvent être posés comme le blanc et le noir. Sartre fera valoir que quand je dis néant, que je le sache ou pas, je pose l’être, je le nie. Et c’est le résultat de cette négation que je labélise en disant c’est le néant. Nous ne sommes pas dans un rapport de contraire, nous sommes dans un rapport de contradiction. Le néant est l’être qui est nié, qui n’est pas là, qui n’est plus là, qui n’est pas encore là. Je ne peux pas faire exister le néant comme équivalent symétrique de l’être. Je suis obligé de poser l’être et de le nier. Le principe de raison suffisante c’est donc ce principe que l’on pose, qui stipule qu’il doit y avoir un postulat, une raison pour que telle chose, qui à nos yeux apparait comme contingente, soit en réalité une nécessité absolue. [ Pour approfondir la question : pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? « Les rencontres de Normale Sup’ » sous la direction de Francis Wolff. Édit. PUF ] -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
2) Preuve ou argument cosmologique Cette preuve va argumenter en utilisant la nécessité, à un certain moment d’arrêter la chaîne causale, qui si on ne l’arrête pas va à l’infini. Chaque chose est la conséquence d’une cause qui, elle-même, est la conséquence d’une autre cause …et comme ceci n’a pas de fin, il faut nécessairement, c’est une nécessité de la raison, qu’à un certain moment on postule une cause première. On trouve cela déjà chez Aristote puisque le premier moteur constitue la première forme de l’argument cosmologique. Dans la tradition judéo-chrétienne on trouverait un exemple chez Leibniz : Principe de la nature et de la grâce les paragraphes 7 et 8. 7. Jusqu'ici nous n'avons parlé qu'en simples physiciens : maintenant il faut s'élever à la métaphysique, en nous servant du grand principe, peu employé communément, qui porte que rien ne se fait sans raison suffisante, c'est-à-dire que rien n'arrive sans qu'il soit possible à celui qui connaîtrait assez de choses de rendre une raison qui suffise pour déterminer pourquoi il en est ainsi, et non pas autrement. Ce principe posé, la première question qu'on a droit de faire sera : pourquoi il y a plutôt quelque chose que rien ? Car le rien est plus simple et plus facile que quelque chose. De plus, supposé que des choses doivent exister, il faut qu'on puisse rendre raison pourquoi elles doivent exister ainsi et non autrement. 8. Or, cette raison suffisante de l'existence de l'univers ne se saurait trouver dans la suite des choses contingentes, c'est-à-dire des corps et de leurs représentations dans les âmes ; parce que la matière étant indifférente en elle-même au mouvement et au repos, et à un mouvement tel ou tel autre, on n'y saurait trouver la raison du mouvement, et encore moins d'un tel mouvement. Et quoique le présent mouvement qui est dans la matière vienne du précédent, et celui-ci encore d'un précédent, on n'en est pas plus avancé, quand on irait aussi loin que l'on voudrait ; car il reste toujours la même question. Ainsi, il faut que la raison suffisante, qui n'ait plus besoin d'une autre raison, soit hors de cette suite des choses contingentes, et se trouve dans une substance qui en soit la cause, et qui soit un être nécessaire, portant la raison de son existence avec soi ; autrement on aurait pas encore une raison suffisante où l'on puisse finir. Et cette dernière raison des choses est appelée Dieu. Ces deux paragraphes sont particulièrement importants puisqu’ils énoncent ce que Leibniz appelle le principe de raison suffisante (paragraphe 7) Ce principe dit que rien ne saurait arriver sans raison. C’est un principe qui exclut la notion de hasard. Tout a une cause, tout a une raison d’être, même si nous ne sommes pas capables d’en connaître immédiatement la raison. -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Je continue : donc trois types de preuve 1) Preuve ou argument physico-théologique. Cette preuve va mêler des choses empruntées à la physique et à la théologie. Plus tard on l’appellera l’argument téléologique (telos=fin, finalité). Ce sont des arguments qui font toujours intervenir le mot fin. Quand on ouvre les yeux on ne peut voir que l’ordre et l’harmonie régnant dans l’univers, des choses les plus petites aux choses les plus grandes de la voûte céleste. Ce ne saurait être le fruit du hasard. C’est le fruit d’un dessein, d’un projet, d’une fin qui est le projet divin. Il y a un dessein à l’œuvre de la nature, un dessein divin. -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Tu as raison. Il est possible que ce passage de l’étude paraisse flou à qui n’a pas lu la CRP. Mais je n’ai pas le temps, toi non plus d’ailleurs, ni le désir de résumer la CRP. En outre ce n’est pas le propos. Néanmoins le travail kantien est un passage obligé à ce moment de l’étude. . -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Donc Kant fait remarquer que la raison est ainsi faite, qu’elle ne peut faire autrement que d’excéder les limites de l’expérience et de poser l’existence dans l’inconditionné. Ce terme veut dire existence d’une cause première, causée par rien mais qui au contraire est cause de toute chose. Et cet inconditionné on l’appellera Dieu. En philosophie, dans la critique de la raison pure il est rarement question de Dieu, il y a la notion d’inconditionné. Regardons bien comment est faite notre raison. Notre raison est ainsi faite que d’une part il lui faut tenter de rendre compte de ce qui se passe dans l’expérience, et d’un autre côté elle a besoin d’un inconditionné. Cet inconditionné la raison ne se contente pas de le poser comme cela, elle va tenter de le conditionner aux exigences de la raison. C’est une façon pour Kant de lutter contre le dogmatisme et de montrer qu’il y a de l’irrationnel dans la raison. Au sein de la raison il y a quelque chose qui demande que la raison soit excédée, et qui fait partie du processus rationnel lui-même. L’irrationnel est une position de la raison, une conséquence de la configuration de notre raison. Kant va montrer que ceci conduit à l’édification d’arguments, essayant de démontrer l’existence de Dieu par trois types de preuve. -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Kant nous dit que nous sommes ainsi faits que nous ne pouvons pas renoncer à aller au-delà de nos connaissances et finalement à aller chercher, penser des choses qui ne peuvent plus être des choses connaissables. C’est le cas de Dieu, c’est le cas de l’âme, c’est le cas de la liberté. La liberté a un statut particulier, c’est une antinomie de la raison pure. On peut aussi bien démontrer que l’homme est libre et aussi bien qu’il ne l’est pas. On trouvera autant d’argumentations d’un côté comme de l’autre. Nous sommes dans le domaine que Kant appelle les antinomies de la raison pure, où tout est équivalent, tout est possible. Nous ne pouvons échapper à cette question de la liberté c’est pour cela que nous rencontrons le travail kantien. [ Il n’est pas possible d’aborder les philosophies existentielles tout de suite. Le travail kantien montre que sur la liberté la raison peut aussi bien argumenter en démontrant une chose et exactement son inverse. Nous sommes donc renvoyés à des attitudes que l’on appelle existentielles, c’est-à-dire au nom de mes croyances, au nom de mes valeurs, au nom de mon vécu je vais prendre position sur tel problème et que je vais dire la liberté pour moi c’est ceci ou cela. Et je ne peux pas l’étayer sur autre chose. C’est la prise de position existentialiste, où l’on prend la contingence de sa liberté, de son existence d’abord, et où l’on va à partir de là déployer un tas de jugements sur la liberté, mais en définitive cela n’aura d’étai qu’un ensemble de principes qui renvoie à l’ego. Tout l’effort existentialiste c’est soutenir cet ego qui est à la fois fantasme de toute puissance, et en même temps le plus défaillant, puisque, comme le disait Nietzsche ce petit danseur funambule évoluant sur une corde tendue entre deux néants : l’avant de ma naissance et le néant d’après la mort. Ma vie terrestre est ce petit fragment sur lequel je danse et où j’essaye de m’arracher au néant en me créant moi-même. C’est le parti pris des existentialistes, se donner à soi même une assise. Que, ensuite, cette assise puisse ouvrir sur Dieu, oui pour l’existentialisme chrétien, ou qu’elle ne puisse ouvrir que sur sa propre transcendance, oui pour l’existentialisme athée. Mais ces mouvements ne sont compréhensibles que si nous prenons acte d’abord du : comment émerge cette notion d’existence, ensuite à quoi elle nous confronte, peut-être aux limites de la raison. Et ici on est obligé de rappeler le discours kantien. ] -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Je poursuis l'exposé : l'existence est-elle démontrable ? L’histoire montre que les preuves de l’existence de Dieu ont afflué. Cette aventure constitue un des piliers centraux de la métaphysique chrétienne. Mais sur le plan strictement philosophique Kant fait remarquer dans la Critique de la raison pure, qu’il semblerait que nous touchions quelque chose qui renverrait à ce que l’on pourrait appeler l’essence même de la raison humaine. Kant essaye d’utiliser sa raison pour critiquer la raison humaine. La raison est cet outil très étrange qui permet d’analyser ses propres procédures et qui de ce point de vue-là doit être capable de s’assigner des limites, c’est-à-dire de dire très clairement au-delà de quelles limites elle ne peut plus connaître quoi que ce soit. Les limites c’est l’expérience. Dès que nous dépassons l’expérience sensible nous ne pouvons plus rien prouver, donc nous ne pouvons plus connaître. Nous pouvons penser une chose mais non pas connaître cette chose. Différence entre penser et connaître. L’idée même de connaissance implique l’idée d’une vérification possible, d’une vérificabilité, c’est-à-dire, nous sommes capables de vérifier et de prouver les propos que nous posons, et cela nous ne pouvons le faire que dans l’expérience, même si nous repoussons les confins de l’expérience. Quand nous sortons du domaine purement matériel, que nous ne pouvons plus expérimenter, nous sommes au-delà de l’expérience, nous sortons du domaine de la connaissance. Nous entrons dans la pensabilité : telle chose je peux la penser. Par exemple je peux penser Dieu, mais je ne peux pas le connaître, puisque par définition Dieu est un objet qui excède toute expérience possible. Il y a une pensabilité de Dieu possible qui ne constitue pas nécessairement une connaissance. Mais fait remarquer Kant, la raison est ainsi faite chez l’homme qu’elle ne peut pas renoncer à investiguer au-delà de l’expérience. Il semblerait que cela soit une sorte de conformation de notre esprit. La raison va savoir ce qu’est une science et ce qui ne l’est pas. Par exemple la métaphysique qui, depuis Aristote, s’est toujours prévalue d’être « la science première », n’est pas une science. -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Tu sais que tes réflexions sont toujours les bienvenues, elles apportent un éclairage nouveau sur ce que j’écris, et m’aident a parfaire ma pensée. -
Concept et idée sont deux choses absolument nécessaires. On peut les hiérarchiser pour bien les positionner au sens ou dans l’ordre du plus bas vers le plus haut il y a : intuition–concept-idée. L’intuition synthétise l’univers du sensible ; à un niveau supérieur une autre synthèse s’établit qui est la synthèse conceptuelle et enfin si on ouvre définitivement tout est possible (voir Kant les antinomies de la raison pure). Je peux aussi bien démontrer que Dieu existe ou qu’il n’existe pas, démontrer que l’homme est libre ou qu’il ne l’est pas, démontrer que l’âme est immortelle ou qu’elle ne l’est pas… Aucune expérience jamais ne vient me renseigner sur la justesse du concept. Autrement dit je n’ai plus affaire à un concept, j’ai affaire à une idée. Kant nous dit d’une façon remarquable qu’il faut se méfier de cette hiérarchie, dans le sens qu’il n’y a pas une chose bonne et une chose mauvaise. Tout cela est nécessaire. Il y a une très grande nécessité de l’idée. L’idée par définition n’est pas démontable, elle est néanmoins nécessaire. Elle n’est pas suffisante mais elle est nécessaire. Pourquoi est-elle nécessaire ? Parce que, justement au plan de la morale aucune morale ne serait constructible si nous ne disposions pas de cet au-delà du concept qu’est l’idée. Parce que, pour construire une morale j’ai besoin de poser le bien, mais le bien n’est jamais qu’une valeur que je construis ou un principe que ma raison pose. Je ne peux pas démontrer le bien, je peux le définir, je peux essayer de le mettre en pratique, ce qui est souhaitable, mais néanmoins cela ne saurait tenir lieu de véritable vérification au sein strict du terme tel qu’on peut en obtenir pour le concept. Kant dit bien à la fin de la critique de la raison pratique : ces idées en tant qu’idées sont nécessaires mais n’ont pas toutes la même fonction.
-

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
L’existence est-elle démontrable ? Pour justement nous ramener à notre propre existence, en faire désormais un objet premier de méditation et non une chose secondaire, méprisée, en faire comme Thomas le disait l’actualisation permanente de notre essence, encore faut-il, puisque notre existence nous la tenons de Dieu, puisque ce mystère de l’existence n’est que le pâle reflet du mystère de l’existence divine elle-même, nous assurer que Dieu existe. C’est le dernier pan de l’édifice. Théologie et philosophie vont dépenser des trésors d’argumentation pour attester que l’existence est démontrable. Et si elle est démontrable, elle est aussi peut-être nécessaire. On ne peut plus appréhender son existence de la même façon selon que l’on a conscience qu’elle est nécessaire ou au contraire que l’on connaît sa contingence. Au travers de la question "Dieu se peut-il démontrer ?" l’idée naïve est que l’on ne peut plus refuser de croire en lui, qu'il y a un autre enjeu qui est notre rapport à notre propre existence. Si nous nous contentons de recevoir notre vie et de la dérouler comme un pur processus physico-chimique, à peine plus que cela puisque nous sommes des êtres conscients, peut-être que cette existence nous nous en sentirons non responsables, nous ne saurons pas que nous pouvons l’orienter et nous la trainerons, à la limite, comme un fardeau. A partir du moment où nous la recevons comme quelque chose qui est précisément à actualiser comme une essence et qui est le seul moyen pour nous de créer notre être, et de montrer quel être nous sommes, nous allons avoir des positionnements existentiels et éthiques radicalement différents. Cette question du caractère démontrable de Dieu passionne la philosophie, la théologie, particulièrement cette partie de la théologie appelée théologie rationnelle. Elle a charge d’utiliser la raison pour soutenir par son éclat propre la lumière de la foi, étant donné la différence radicale entre vérité et raison, vérité révélée et vérité découverte par la raison, reconstruite par la raison, celle qui intéresse les sciences et la philosophie. -
En effet cela m’interessera, le sens des mots et du langage. Surtout qu’en ce moment je vais devoir tout reprendre des outils grammaticaux et les expliquer à certains, dans un autre domaine, afin qu’ils acquièrent le plus possible de la richesse de notre langue.
-
Très intéressant ce que tu publies sur le concept. À la lecture de la CRP, souvent absconse, le concept défini chez Kant nous donne une approche quasi scientifique. C’est ce que tu expliques, et je comprends parfaitement la cloison qu’il peut y avoir parfois avec la philosophie .
-

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Tu as raison. Tu dois continuer et faire du fi de toutes ces perturbations. -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
Tu oublies de mentionner une chose : tous reçus et avec mention ! -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
La vérité est le processus qui consiste à peu à peu retirer les voiles successifs de quelque chose qui ne peut nous apparaître que voilé et que l’on n’arrivera jamais aux réponses ultimes. Dans ce que nous appelons vérité il y a toujours quelque chose qui nous échappe et qui reste caché, hors de notre portée. C’est ce que veut dire très exactement le mot en grec. Nous comprenons que, de ce mot chargé de positivisme, étrillé par le rationalisme français de Descartes à Auguste Comte, il ne reste rien. Pour retrouver toute la richesse de ce terme on est obligé de faire le détour par les sphères théologiques et métaphysiques. Thomas nous laisse cette idée que, dans notre existence, et par notre existence, tremble en nous une sorte de mystère ineffable qu’on ne peut espérer percer car ce mystère que porte en lui chaque existant n’est que le reflet de l’image de Dieu. Nous aurons donc beaucoup de difficultés à nous débarrasser de la métaphysique au prétexte que nous rentrons dans des considérations existentialistes. -

Naissance du concept d’existence
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Philosophie
St Thomas en tire l’idée importante, à savoir que ce mystère de l’essence divine rejaillit nécessairement sur l’existence, puisque toute existence procède de Dieu. Il ne peut donc y avoir à ses yeux qu’une approche religieuse, métaphysique de l’existence. Tout existant, toute chose existante, tout individu humain existant réellement, renferme justement de par son existence un mystère que rien ne peut dévoiler, ou que tout discours théologique, métaphysique, mais aussi par la suite philosophique va tenter de dévoiler, étant entendu que le dévoilement final n’existe pas. Seule la mort apparaît comme le dévoilement ultime. A ce moment là on retrouve, au sein de cette approche tout à fait chrétienne qui postule le même mystère de l’existence en Dieu et en ses créatures, le sens profond, presque sacré de « alètheia » grec qui veut dire la vérité. Ce mot que l’on traduit simplement par vérité est un mot chargé et riche de sens, puisque l’idée pour un grec est que cette vérité est de l’ordre d’une entité qui est voilée. -
Dans « Not I » il y a cette bouche qui parle et cette figure non identifiable sur le devant de la scène qui joue le rôle de l’auditeur. Pour le théâtre, parler ne suffit pas il faut que quelqu’un nous entendre. La bouche parle des autres abandonnés. L’état de l’abandon est notre destin collectif. Cette sténographie Beckett la récupère dans Compagnie, mais sans la scène de théâtre. Il garde l’idée qu’une voix parle, qu’il y a un entendeur qui écoute cette voix. La voix de l’entendeur sont les inventeurs d’un X, incapable de dire « je », couché sur le dos, dans le noir. La problématique de la voix chez Beckett, une fois que l’on sait que les questions ne seront jamais satisfaites par une réponse, et que l’on ne peut pas se taire, est assimilable à la fin à un chuchotement, un souffle pur. Le texte présente bien cette stratégie de la voix. Il commence par ce qui pourrait être une consigne d’écriture donnée à des enfants. « Une voix parvient à quelqu’un dans le noir : imaginez ». Et la fable se déroule à partir de cette consigne, un personnage couché sur le dos dans un état d’impotence et d’impuissance, dans le noir. Aucune image visuelle perceptible ne peut lui parvenir. Les images suscitées par le texte sont des images mentales à l’intérieur de la boîte crânienne du personnage. Beckett invente une sténographie ou une voix s’adresse à un « gisant » pour susciter un « je » en lui disant « tu ». Et le gisant a, pour sortir de sa solitude, inventé ce dédoublement de la voix et de l’entendeur. À quelqu’un sur le dos, dans le noir, une voix égrène le passé. Il y a un récit d’une diction qui tente une résurrection en égrenant un passé. « Tu es sur le dos dans le noir… ». Le « tu » tente de susciter le « je » mais il ne le peut pas, il ne le fera pas. Le « je » chez Beckett est aux antipodes du « je » gidien ou même du « je » du monologue intérieur. Et le drame consiste à ne pas pouvoir se passer de compagnie. Puisqu’il nous faut une compagnie on invente une voix et un entendeur à l’intérieur de son crâne, tout en sachant que cette voix a pour vocation de susciter l’identité, mais échouera. Et la compagnie devient insupportable à certains moments du texte. On frôle une mise en scène de la folie. Compagnie récapitule à la fin de l’œuvre de Beckett l’ensemble des problématiques : impossibilité de dire je, impossibilité de se taire, combler le noir, combler le silence. Cette façon de ne pas pouvoir se taire correspond à une espèce de vertige de la mort associé au silence. On rit davantage au théâtre. Entre les années 50 et les pièces les plus connues de Beckett, et les années 70/80, l’essoufflement, et en même temps la nécessité de continuer à tenir ce souffle jusqu’au bout pour ne pas mourir, devient de plus en plus angoissé.
-
Donc l’idée est forcément ouverture, et c’est elle qui me conduit vers la position, le postulat de l’existence de Dieu, vers le postulat de l’immortalité de l’âme, le postulat de la liberté. Autant de choses que l’on peut à la fois défendre, soutenir et en même temps réfuter (Kant et les antinomies de la raison pure). Lorsque l’on en revient à l’idéalité telle que Hegel peut utiliser ce terme ou tel que Kierkegaard l’emploiera également il faut plutôt voir l’idée que le concept c’est-à-dire ces représentations mentales que les hommes fabriquent. Dans le concept je ne peux plus faire état de ma particularité et de mon individualité. Le concept recherche au contraire la généralité, l’universalité, d’où le terme de générique. Dans l’idée on retrouve cette part de désir, cette part d’émotion qui nous constitue, mais ce que l’on retrouve à l’arrivée n’est pas ce que l’on avait au départ. Ce que l’on avait au départ c’est de l’émotion brute, de la sensation brute. À l’arrivée au niveau de l’idée ce que l’on retrouve c’est la sensation, c’est l’émotion, l’affect pour employer un terme plus contemporain, spiritualisé, travaillé par le concept. Dans l’idée il y a le sentiment, émotion mais spiritualisé.
-

« Boire un grand bol de sommeil noir... »
satinvelours a répondu à un(e) sujet de satinvelours dans Littérature
Elle se refuse toujours à comprendre, à entendre, Elle rit pour cacher sa terreur d’elle-même. Elle a toujours marché sous les arches des nuits Et partout où elle a passé Elle a laissé L’empreinte des choses brisées.