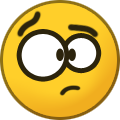-
Compteur de contenus
1 978 -
Inscription
-
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Blogs
Calendrier
Vidéos
Quiz
Movies
Tout ce qui a été posté par aliochaverkiev
-
Je ne crois pas que vous puissiez me comprendre. Car vous n'êtes que dans la réflexion là où je suis toujours dans l'action. Qu'est-ce qui fait que dans des situations dramatiques je me révèle actif, combatif, là où les autres cèdent ou fuient ? C'est pour avoir vécu des situations violentes, dramatiques aussi que je me suis rendu compte que là où les autres s’éteignaient, moi je me levais et me battais. Affronté à des situations de violence j'ai pu constater que la majorité des gens, ne luttaient pas. Moi si. Cela m'a surpris, je ne pensais que j'étais capable de courage là où tant de femmes et d'hommes bien, des sachants, de beaux penseurs parfois, comme vous, surtout comme vous d'ailleurs, se révélaient être de fieffés lâches. D'où je tirais ma force ? Je me suis rendu compte que ma force surgissait de l’intérieur de moi, que quelque chose me portait dans le danger surtout lorsqu'un autre que moi était en perdition. Ce qui m'a toujours étonné c'est que mon courage n'était pas l'effet d'une décision, mon courage me venait des entrailles. Si bien que je ne pouvais pas vraiment me glorifier, car je savais que mon courage était l'effet d'une volonté, d'une puissance ou d'une présence, que sais-je, qui se réveillait alors en moi. Ma réflexion est toujours portée par cette intention : comment puis-je agir sur le monde ? Que puis-je apporter au monde ? Que puis-je donner ? Je n’acquiers des savoirs que dans cette intention-là. Je n’acquiers jamais des savoirs pour moi, pour mon profit.
-
Le doute de Descartes ne m'intéresse pas, ce qui m’intéresse c'est : qu'est-ce que je peux apporter aux autres, que puis-je donner aux autres? Se cultiver ne m’intéresse que dans le cadre de l'action. Je ne me juge que sur mes actes et sur mon œuvre pas sur mon savoir.
-

La marque de la bête: 666
aliochaverkiev a répondu à un(e) sujet de Pain de vie dans Religion et Culte
Enfin dernier point les Romains Titus et Hadrien n’ont pas briser les juifs en raison de leur religion ( les romains ont au contraire admirer le judaïsme et beaucoup se sont convertis car à cette époque les pharisiens faisaient du prosélytisme) ils ont brisé les juifs car ceux ci voulaient recouvrer leur indépendance. Après tout ils étaient chez eux les juifs ! Ils ne supportaient plus de voir leur terre occupée. -

La marque de la bête: 666
aliochaverkiev a répondu à un(e) sujet de Pain de vie dans Religion et Culte
Attention au moment des ´prouesses’ de Jésus il n’y avait pas encore de chretiens, il y avait les nazaréens, lesquels étaient restés juifs. C’est Paul qui lance le christianisme, parfois même contre les premiers apôtres qui voulaient rester juifs. C’est Paul qui institue la réalité ( et non le symbole) de la résurrection, c’est lui qui supprime l’obligation de la circoncision et le respect de la Loi. Il vise à convertir les Gentils les seuls qui peuvent croire dans le prodige d’un homme fait Dieu. En Judee même il rencontre de fortes résistances chez les premiers disciples de Jésus, lesquels veulent rester juifs. C’est hors de Judee que Paul triomphera. -

La marque de la bête: 666
aliochaverkiev a répondu à un(e) sujet de Pain de vie dans Religion et Culte
Cette déclaration de Paul concernant les vrais juifs est une déclaration de guerre contre les juifs. En déclarant que les vrais juifs sont ceux qui pratiquent la circoncision du cœur et non la circoncision de la chair il vise à détruire l’identité des Judéens pour lesquels la circoncision de la chair est un commandement mosaïque et le signe de l’apparence au peuple juif. C’est d’ailleurs normal qu’il fasse la guerre, il sait que les juifs ne reconnaîtront jamais qu’un homme puisse être Dieu ou le fils de Dieu. Les juifs ont 2000 ans de pratique religieuse derrière eux, ils ne tomberont jamais dans une telle idolatrie, pas plus que les musulmans d’ailleurs ne tomberont dans ce type d’idolâtrie. Du coup il tente de détruire l’identité juive pour la transmettre aux incirconcis chrétiens puisque jésus est juif et qu’il faut que cette judéité ne s’oppose pas aux chretiens incirconcis. Paul lance le coup d’envoi de l’antijudaisme qui allait conduire à la future persécution des juifs. Paul déclare la guerre à son peuple d’origine par dépit de ne pas être reconnu par les Pharisiens. Il fait penser à Flavius Josèphe qui devait contempler plus tard le massacre de son peuple par Titus. -
La formation des valeurs sociales s’enracine bien sûr dans le rapport social. Les valeurs sociales existantes, avant transmission à l’enfant, ont deux sources : l’environnement social de l’époque et la famille, notamment les parents. L’enfant qui reçoit (ou qui imite), dans la transmission, ces valeurs, en est-il conscient ? Non. Les valeurs de l’enfant sont donc inconscientes. La plupart des personnes, peut-être la majorité, restent jusqu’à leur mort inconscientes quant aux valeurs qui dirigent leurs actions. Elles les affirment néanmoins, avec vigueur parfois, sans jamais prendre conscience que leurs déterminations sont inconscientes. Mais elles peuvent aussi prendre conscience de leurs valeurs et néanmoins choisir de les affirmer par solidarité avec les puissances inconscientes qui les habitent. C’est souvent le cas. C’est dire combien les puissances inconscientes dirigent le monde. Mais l’enfant, puis l’ado, puis l’adulte peuvent aussi prendre conscience des valeurs qui les déterminent à la suite des contradictions propres à tout système de valeurs, contradictions soit internes soit externes par opposition avec la réalité vécue qui peut obliger à poser des actes en contradiction avec le dit système. Est-ce que l’adaptation ou la création conscientes des valeurs sociales recourent aussi à des processus inconscients ? C’est bien possible, ce qui pourrait bien signifier encore une fois que ce sont bien les puissances inconscientes qui nous gouvernent. Il est même probable que c’est la contradiction, au sein de la société des hommes, entre ces systèmes de valeurs individuelles ou communautaires, que c’est leur guerre qui est le moteur de l’évolution. La guerre pilote l’univers, Héraclite d’Éphèse, ou plus exactement : la foudre pilote l’univers. Il me faut revenir sur les deux sources des valeurs sociales : environnement social global et l’environnement familial.
-
Le terme "matériaux" désigne des éléments de pensée. Je construis ici des éléments de pensée, des "briques" dont je me servirai ultérieurement quand j'aurai décidé de lancer mon œuvre finale, une sorte de testament, somme d'événements vécus, de pensées, d'imaginaires, legs offert à ma descendance et à tous ceux qui me connaissent. Le premier matériau dont j'ai traité est la "science" (science physique en fait) dont je me suis rendu compte qu'il n' y avait rien à en attendre sinon que des applications techniques. Il s'agissait de m'extraire de la fascination exercée sur les simples d'esprit (qui peuplent le rayon philosophie) par cette science. Maintenant à propos de Dieu et de la foi je pense que vous ne m'avez pas compris. Dieu ne m’intéresse pas. Je laisse ce concept aux croyants et aux athées. Ce qui m’intéresse c'est la foi. J'ai fait une erreur en affirmant que la foi surgissait de l’intérieur. Affirmer cela est absurde. Ce qui surgi de l’intérieur de soi ce n'est pas la foi. La foi est un état d'âme lui-même engendré par autre "chose". Cet "autre chose" est perceptible, ce n'est donc pas une construction intellectuelle. Pour l'instant, faute de mieux j'ai appelé cette chose : Volonté, en donnant à ce mot le sens que lui donne Schopenhauer. Je n'ai pas mieux à offrir pour le moment. Cette "chose" qui est perceptible de l’intérieur, par le sentiment, ne se révèle que dans le combat, que dans l'action, que dans la "guerre". Les passifs, les spectateurs, les lâches, les pleurnichards, les narcisses, les séniles n'ont pas accès à cette perception. Ceux là ont choisi de ne jamais être dans l'action (à perspective sociale) ou de s'en retirer. Se retirer de l'action (action déployée dans le champ social, dans la communauté des hommes et des femmes) c'est se priver d'un univers de perceptions. Je reviens sur le sujet de la foi dans un message à venir.
-
Comment l’attention décide-t-elle de la pertinence d’un stimulus ? Dehaene répond : la sélection s’appuie sur un mécanisme clé : l’attribution, par le cerveau, d’une valeur à chacune de nos pensées potentielles ». Pour lui l’estimation de la valeur des situations que nous rencontrons repose sur des circuits cérébraux qui échappent aussi à notre introspection. Bref cette attribution est le fait de processus inconscients. Pour prouver ses dires Dehaene s’appuie sur l’expérience suivante : il annonce à des participants que, s’ils serrent une manette le plus fort possible, ils gagneront de l’argent. Au début de chaque essai l’image d’une pièce de monnaie indique la somme en jeu mais l’image, grâce à des techniques sophistiquées, est inaccessible à la conscience. Pourtant plus la mise est élevée plus les participants serrent fort la manette. Le passage par la conscience est donc inutile pour décider de tenter de gagner le plus d’argent possible. Cette expérience ne me convainc pas. Certes les processus sont inconscients mais il a fallu, au préalable, indiquer que des sommes d’argent étaient en jeu. Cette expérience démontre que, une fois que l’argent est devenu consciemment une valeur en soi, l’individu n’a plus à en avoir conscience pour que cette valeur devienne agissante. Des processus inconscients se sont désormais emparés de la valeur argent. Mais il a fallu tout de même un signal conscient préalable pour exprimer ce fait que l’argent est une valeur. Certes dans certains cas, situation de survie, situation de sollicitation sexuelle, situation de besoins primaires à satisfaire il est bien possible qu’aucun amorçage conscient soit nécessaire. Mais dans le cas de l’argent ? Dans le cas de valeurs manifestement issues d’un contexte social ? Les valeurs se forment comment avant d’être intégrées dans des circuits inconscients ? Cette question, la formation des valeurs sociales, en soi, est laissée de côté par Dehaene, pourtant cette question est cruciale.
-
Le fondamentaliste de l’Église freudienne y va comme d'habitude de son explication sexuelle. Dès qu'il le peut il expose sa parole prosélyte : "Ô écoutez la parole du Prophète, Freud, et de son émule Lacan, ô païens écoutez la Parole révélée : Le sexe est le Dieu et Freud est son prophète". Comme il vit reclus dans sa grotte provinciale il ne sait pas que ce catéchisme n'a plus cours que dans ces provinces reculées de France, pays où domine encore la grande prêtresse, Roudinesco, gardienne de l'orthodoxie freudienne. Ce qui est étonnant c'est qu'il dénonce sans cesse les croyances des autres sans même s'apercevoir qu'il est lui même confit dans une croyance primaire dont le symbole exaltant, pour lui, n'est pas la croix mais le phallus. C'est un vieillard sympathique qui ne sait que répéter des savoirs depuis longtemps obsolètes. Son compère, @deja-utilise tombe, lui, amoureux de lui-même. Tout cela est étonnant et engendre cet arrière-pensée amère : la vieillesse serait-t-elle vraiment un naufrage ?
-
Il est nécessaire de revenir sur les découvertes récentes des neuroscientifiques (Chris Frith, Stanislas Dehaene, Pierre-Mais Lledo, etc). Ils nous révèlent que l’inconscient a un pouvoir bien plus large que nous ne le pensions. Dans ces conditions comment continuer d’élaborer des pensées et de les construire ensemble sans prendre, ou tenter au moins de prendre conscience de l’importance des processus inconscients dans une telle élaboration ? « Des opérations complexes qui relient la perception à l’action se déroulent sans conscience (pilotage automatique). « Dans l’ignorance de ce bouillonnement de processus inconscients, nous ne cessons de surestimer notre pouvoir de décision consciente. Notre degré de contrôle est en fait sévèrement limité ». Dans le même mouvement nous sous-estimons le pouvoir de l’inconscient. «Toutes les fois qu’un objet prend possession de notre esprit, si bien que nous pouvons le décrire à d’autres, nous en sommes conscients » A défaut de pouvoir définir la conscience [« Rien de valable n’a jamais été écrit à ce sujet » Stuart Sutherland, Dictionnaire international de psychologie, 1996] il est possible d’en détecter l’action par l’un de ses effets : la capacité du sujet à communiquer à l’autre le détail de ses pensées, sentiments, émotions, visions, etc. Quelques certitudes explosent. Nous pensions que le cortex était le siège de la conscience, tandis que tous les autres circuits étaient le siège de l’inconscient. « Nous savons aujourd’hui que pratiquement toutes les régions du cerveau peuvent participer tantôt à la pensée consciente, tantôt aux opérations inconscientes». Le cortex peut être le siège d’activités qui restent inconscientes, tandis que les zones cérébrales réputées contenir exclusivement les activités inconscientes peuvent participer à la pensée consciente; il n’ y a plus de localisation cérébrale exclusive du conscient et de l’inconscient. Confirmation de ce que j’écrivais plus haut dans cette étude : « Nous n’avons pas conscience des ondes sonores qui font vibrer nos tympans, pas plus que des photons qui entrent dans nos yeux » « Notre conscience ne nous donne donc jamais accès à une sensation brute, mais seulement à une reconstruction experte du monde extérieur » (réalisée par l’inconscient). « Une énorme quantité de calculs s’effectue à notre insu afin d’assembler la scène qui se joue devant nos yeux et nos oreilles et que nous prenons, à tort, pour la simple donnée de nos organes des sens » Il est même possible d’aller encore plus loin que Dehaene en lui faisant remarquer que les dites ondes sonores et les dits photons sont encore des représentations et non des réalités brutes. Cela dit le Commun croit toujours que la conscience fonctionne comme un appareil photographique. L’arbre qui est devant moi existe bien tel qu’il m’apparaît, la conscience fait « clic » et hop l’image de l’arbre est enregistrée. Casser cette croyance est très malaisée tant l’inconscient agit avec une autorité telle sur nous que nous prenons ses conclusions pour la brute réalité. L’attention contrôle la voie d’accès à la conscience. Il s’agit d’une attention sélective. Mais les opérations de sélection intentionnelle se déroulent en dehors de notre conscience. Le filtre de l’attention agit de façon inconsciente. Découvertes récentes : la conscience requiert l’attention, mais l’attention à un stimulus n’implique pas forcément la conscience. « Toute une armée d’opérateurs inconscients s’occupe d’orienter le faisceau de l’attention et de trier les monceaux de données qui parviennent à nos sens jusqu’à ce que l’un d’entre eux alerte la conscience». Comment l’attention décide-t-elle de la pertinence d’un stimulus ?
-
5 novembre 2018 Écrire ici est un acte dont la signification évolue avec le temps. Cet acte, il y a peu, me mettait encore en rapport avec des personnages issus de ma propre histoire : transfert. Lentement ces personnages disparaissent. En mourant ils me libèrent de leurs chaines avec lesquelles ils entravèrent jadis mes chevilles. Les rochers lourds de leurs maux, nés de leur histoire tragique, je les vois désormais dériver dans un espace, au loin, insondable assez pour qu'ils puissent à jamais s'y abimer. Je reste un temps désemparé, privé de mes habitudes. Le désir d'écrire reste inaltérable. Le bris des chaines augmente la capacité de travail. Écrire ici semble n'avoir plus d'autre sens que celui de renoncer, dans le désir d'écrire, au désir conjoint d'être compris. Vouloir être compris gauchit l'inspiration en la soumettant au jugement de tiers qui, ainsi, dévient la trajectoire initiale de l’intention. L'acte ultime d'écrire ne doit plus rien céder qu'à la Volonté issue des entrailles. La source qui jaillit des flancs du mont tire son énergie d'une seule pression intérieure. L'acte ultime d'écrire, épuré de tout désir collatéral, emporte avec lui la parole issue des Origines. Le voyageur venu du désert, tel que je le vois, parle une parole dont je perçois le murmure. En se rapprochant son discours devient compréhensible. Plus il se rapproche plus sa proximité annonce que le moment pour moi est venu de mourir.
-
Lettre 42 4 novembre 2018 Samuel, La destruction du Temple, l’extermination par les Romains d’un quart de la population juive de Palestine, l’anéantissement des classes dirigeantes plongent le pays dans le chaos. De vastes zones agricoles sont abandonnées, des villes entières sont rasées, des nomades rentrent dans le pays et l’occupent durablement. Le désespoir s’empare des survivants. Nul ne sait plus comment assurer la permanence de l’ancienne vie culturelle et religieuse. Tous se mortifient voyant dans cette catastrophe l’œuvre de Dieu, rendu furieux en raison de leurs péchés. Car pour les Hébreux nul doute que cette catastrophe procède de la volonté de Dieu dont ils n’ont pas su respecter la Volonté. Les Romains n’ont jamais été que les instruments de la colère de l’Éternel. C’est la troisième fois que la mémoire juive risque de disparaître. La première fois ce fut à l’issue de la chute du royaume de Juda quand les lettrés Judéens furent déportés à Babylone. Un homme parut, Esdras, qui sut rétablir la mémoire et la religion juives. La deuxième fois ce fut lorsque Antiochus IV tenta de détruire le judaïsme. Une famille parut, les Maccabées, qui reprit le Temple aux Grecs pour y restaurer le culte de Yahvé. Cet évènement est désormais fêtée chaque année lors de la fête de Hanoukka. Cette année Hanoukka est fêtée de la soirée du dimanche 2 décembre 2018 à la soirée du lundi 10 décembre 2018. Je te rappelle qu’après leur victoire, les Maccabées se rendirent dans le Temple de Jérusalem pour le purifier et allumèrent la ménorah (le chandelier à sept branches) avec la seule fiole d’huile consacrée qui restait. Elle n’aurait dû durer qu’un seul jour, mais elle maintint le chandelier allumé pendant huit jours, le temps de fabriquer une nouvelle huile sacrée. C’est ce miracle qui place cette fête sous le signe de la lumière. Cette fois-ci encore un homme va paraître et rendre aux Juifs leur mémoire, leur histoire et leur religion : Yohanan Ben Zakkaï, le pharisien qui s’était replié à Yavné pour y fonder son académie talmudique. Épargné par les Romains il va jeter les fondements d’un judaïsme renouvelé : le judaïsme synagogal en remplacement du judaïsme sacerdotal. Le judaïsme synagogal apparut en fait dès le deuxième siècle avant l’E.C. avec l’édification des premières synagogues dans la diaspora juive et en Judée. Le Temple était certes le lieu central de la pratique du judaïsme mais comme les Juifs étaient désormais pour certains dispersés ou ne pouvaient pas toujours se rendre au Temple la synagogue devint un lieu de rassemblement où se réunir et prier ensemble. Le judaïsme sacerdotal était centré sur le sacerdoce des prêtres (sacerdoce : fonction du prêtre en tant que ministre de Dieu, c’est-à-dire exécutant de la volonté de Dieu). Ces prêtres avaient fini par transmettre leur fonction par hérédité contribuant à créer une aristocratie, les Sadducéens, qui se singularisèrent par leur indifférence au peuple. Ces prêtres fixaient le calendrier des fêtes juives, ils fixaient aussi la liturgie c’est-à-dire la manière de conduire les cérémonies religieuses dans le Temple. Enfin ils étaient les seuls à avoir le droit de pratiquer, toujours dans le Temple, les sacrifices propitiatoires d’animaux. Sacrifice propitiatoire : qui a pour but de rendre la divinité (l’Éternel) propice, propice c’est-à dire bien disposée, favorable. En revanche concernant la vie religieuse même du judaïsme, notamment la fixation de la Halakha ils étaient supplantés par les Pharisiens et les scribes qui contrôlaient la loi écrite et renouvelaient sans cesse la loi orale. Les Sadducéens se contentaient eux de la loi écrite dans la Torah, ils se s’embarrassaient pas trop avec les contraintes de la vie religieuse quotidienne. Ils payèrent leur indifférence au peuple et leur sympathie pour l’occupant romain chèrement : ils furent exterminés par les Zélotes avant que ceux-ci à leur tour tombent sous les coups de la barbarie romaine. Yohanan Ben Zakkaï recentra le judaïsme sur la synagogue. Il épura le judaïsme de sa dimension politique (renoncement à l’indépendance de la Judée), renonça à l’idée de la reconstruction d’un Temple et instaura l’étude de la Torah et de la Halakha à l’intérieur même des synagogues. Il nomma un nouveau Sanhédrin qui devint le seul habilité à fixer un nouveau calendrier des fêtes religieuses. Il introduisit la commémoration chaque 9 Ab de la destruction du Temple. Il inséra le verset «Si je t’oublie ô Jérusalem » dans les bénédictions du mariage ainsi que le vœu « L’an prochain à Jérusalem » à la fin du dîner pascal. Les actions et les fêtes religieuses sont célébrées désormais dans les synagogues qui reprennent la liturgie jadis assurée par les prêtres. Seuls les sacrifices ne sont plus assurés puisque cette fonction ne pouvait être pratiquée que par les prêtres au sein même du Temple. La fonction centrale des synagogues va permettre l’émergence de nouveaux religieux : les rabbins qui désormais vont diriger le culte juif. Une nouvelle élite, plus ouverte et plus démocratique que l’élite des cohanim et des lévites (les Sadducéens) prend ainsi la direction des affaires religieuses. Elle se recrute dans toute les classes de la société. Son statut ne repose plus sur le principe héréditaire mais sur l’érudition. La société juive ainsi se démocratise. Dans ce nouveau judaïsme il n’ y a plus de place pour les mouvements d’hier, plus de place pour les Zélotes, les Esséniens, les Sadducéens, les Nazaréens (les premiers chrétiens) ni même pour les chrétiens considérés désormais comme des hérétiques. Cet effort de reconstruction est couronné de succès. Les Juifs qui continuent de former la majorité de la population palestinienne parviennent à améliorer leur relation avec Rome. Mais une nouvelle guerre allait surgir entre les Juifs et Rome, et cette ultime guerre signa définitivement la fin de toute présence juive dans le petit royaume de Juda (la Judée). Des lors c’est hors de Palestine, dans la diaspora, que va battre le cœur du monde juif (mais il resta une présence juive significative en Galilée). P.S. La ménorah est le chandelier (ou candélabre) à sept branches des Hébreux. Depuis 1949 la ménorah forme les armoiries de l’État d’Israël et apparaît sur tous ses documents officiels. Au chapitre 25 de l’Exode Dieu demande à Moïse de réaliser un chandelier d’or pur devant être placé dans la Tente du Rendez-vous, aussi appelée Tente de Rencontre ou encore Tabernacle. Ce chandelier doit témoigner de la relation permanente et réciproque entre Dieu et son peuple. Le Tabernacle abritait aussi les tables de la Loi logées dans l’Arche d’Alliance. Il ne se passe pas de jour sans que je ne pense à toi, Je t’aime,
-
La fascination du profane devant les sciences exactes, surtout les sciences physiques, est étonnante. C'est la fascination de l'enfant quand un parent lui narre un conte de fée. La science physique n' a pourtant jamais pour objectif que de parvenir à réaliser un descriptif le plus fin possible des phénomènes, condition de notre vie physique. Ce descriptif dans lequel des éléments sont liés les uns aux autres par des relations obligées a pour but de permettre l'intervention de l'homme dans ces structures révélées par les chercheurs afin de les modifier à son profit. Autant dire que la science physique n' a pour utilité que les applications techniques. Tout le reste est bavardage. L’illusion qui tient en haleine le Commun est que la découverte d'une cause première engendrerait alors un sentiment d’émerveillement absolu et une éternelle contemplation de l'Origine. Étrange enfantillage. Cette illusion s'enracine dans cette croyance : il y a eu, à un moment, dans l’histoire de l'univers, un acte unique et fondateur dont tout le reste procède. C'est le principe du déterminisme : il suffit d'un seul acte primordial pour que toutes choses en dérive. La création, pour les déterministes, se réduit à un seul acte : la pose de la cause première. Cette pensée s’impose au Commun parce qu'elle est éminemment simpliste. Elle flatte son goût immodéré pour la paresse. En vérité la création est continue. Cette idée d'une création continue semble inaccessible au Commun. Il lui faut une création réduite à un seul moment de l'histoire. Quand la création en vérité ne cesse d’être en action. Mais elle ne se déploie plus dans le seul champ des mécaniques physiques, la création se révèle dans l’émergence d'une complexité que d'aucuns nomment la Vie. En ce qui concerne l'homme la création continue son œuvre dans la socialisation. La chute et la régression de la pensée européenne dans une vision du monde centrée exclusivement sur l'individu annonce la chute d'une civilisation qui a perdu ce savoir antique : l'homme n'existe que dans le rapport à l'autre.
-
la fascination du profane devant les scincnes exactes, surtout les scince pyquaue, est étonnante. C'est l
-
En définitive si l'esprit peut se déployer dans toute sa puissance ce n'est pas dans le champ de la physique (ni même des mathématiques). Croire que l'on puisse trouver dans l'élucidation du fonctionnement et de l"origine de l'univers quoi que ce soit qui soit à la hauteur de la puissance créatrice de l'esprit est une illusion, un aveuglement engendré par un désir de merveilleux infantile ou sénile. Quand bien même la science physique serait enfin achevée, quand bien même nous disposerions d'un modèle parfait qui rendrait compte de tous les événements physiques (matériels) observables cela ne nous apporterait rien. Nous serions éblouis quelques heures avant de nous rendre compte que ce modèle explicatif de l'univers serait totalement indifférent quant à la conduite quotidienne de notre vie. Un modèle parfait auquel le plus grand nombre identifierait l'être même de l'univers tomberait dans nos esprits sans plus d'effet qu'un gain de sable errant sous l'impulsion du vent dans l'immensité d'un désert.
-
Lettre 41 2 novembre 2018 Samuel, Jérusalem était ceinte de trois murailles là où elle n’était pas protégée par des ravins infranchissables. La plus ancienne, construite et fortifiée par David et Salomon, était difficile à prendre. La seconde muraille ne défendait que le quartier nord de la ville. La troisième muraille protégeait une partie de la ville construite récemment. Elle n’était pas encore achevée lors de l’attaque. Au milieu de la ville était érigé le Temple. Voici comment Flavius Josèphe le décrit dans le livre V de la guerre des Juifs: « Recouvert de tous côtés d’épaisses plaques d’or, aux premiers rayons de soleil il reflétait un éclat tout plein de feu. Il apparaissait semblable à une montagne couverte de neige car sur les parties où il n’était pas couvert d’or il était parfaitement blanc ». Titus lance l’attaque en avril 70. Le 25 il s’empare du troisième rempart. Fin mai il s’empare de la deuxième muraille. Il offre la vie sauve aux défenseurs de la ville s’ils acceptent de se rendre. Ils refusent. Encerclés les Juifs ne disposent d’aucune voie de ravitaillement. Ils commencent à mourir de faim et de maladies. Ceux qui tentent de s’enfuir sont capturés par les Romains qui les crucifient ou par les Nabatéens qui les éventrent pour chercher dans leurs entrailles l’or qu’ils auraient pu avaler. A la fin du mois de juillet lors d’une ultime attaque Titus enfonce les dernières positions tenues par les assiégés. Le 30 août 70, soit le neuvième jour du mois d’Ab du calendrier hébraïque, le Temple est incendié. Les Zélotes continuent de se battre et meurent jusqu’au dernier. Voici le récit de Flavius Josèphe : « Pendant que le temple brûlait, les Romains pillaient tout ce qui tombait entre leurs mains et massacraient enfants, vieillards, laïcs, prêtres. Le ronflement des flammes se mêlait aux gémissements de ceux qui tombaient. Toute la ville était en feu. Rien de plus fort et de plus terrifiant ne pourrait être imaginé que la clameur qui s’élevait : il y avait le cri de guerre des légions romaines réunies, les hurlements des rebelles encerclés par le feu et par le fer, la ruée du peuple qui, dans son épouvante, allait se jeter sur les ennemis en poussant des gémissements quand arrivait l’issue fatale. Les souffrances étaient plus terribles encore que le bruit. Le sang était encore plus abondant que les flammes et les tués plus nombreux que ceux qui tuaient. A aucun endroit la terre n’apparaissait entre les cadavres et les soldats devaient escalader des monceaux de corps pour poursuivre les fuyards». Titus pilla le Temple et en rapporta les trésors à Rome. Le 28 septembre 70 les Romains rasent Jérusalem. Ne restent debouts qu’une tour et un pan du mur occidental entourant le Temple. C’est lui que nous appelons aujourd’hui le mur des Lamentations. Johanan de Giscala est torturé puis condamné aux travaux forcés. Simon Bar Giora est exhibé en 71 à Rome puis exécuté. En Judée même quelques mois après la destruction de Jérusalem les forteresses de l’Hérodion et de Machéronte se rendent au nouveau gouverneur de la Palestine : Lucilius Bassus. La forteresse de Massada où se sont réfugiés un millier de Zélotes dirigés par Eléazar Ben Jaïr résistera pendant trois ans. Quinze mille Romains vont en faire le siège sous la conduite de Lucius Flavius Silva. Quand les Romains pénètrent enfin dans la forteresse en avril 74 ils découvrent que tous les Zélotes ont choisi de se suicider plutôt que de se rendre. Seuls survivants : deux femmes et cinq enfants. Dans la diaspora, révoltés par la destruction du Temple, les Juifs se soulèvent. La répression est implacable. Des milliers de Juifs sont massacrés. La grande communauté juive d’Alexandrie est anéantie signifiant la rupture définitive du lien jadis tissé entre judaïsme et hellénisme. Ta présentation de l’histoire des Juifs dans l’atelier de ton lycée est un succès. Bravo pour ta maestria dans la défense de tes positions, bravo pour ton éloquence déployée désormais face à un public devenu nombreux. Je t’aime, Je pense à toi Toujours.
-
-
Il faut que j'en termine avec cette histoire de chose en soi. Dans le rapport que nous avons avec ce que nous appelons l'univers, ce qui nous intéresse ce sont les interactions entre nous et cet univers, pas l'univers lui-même, en tant qu'être en soi. Les représentations que nous avons de l'univers, de la nature, nous sont essentiellement imposées par notre activité inconsciente. Quand je vois un arbre, je pense que cette perception est le produit de mon activité consciente. Absolument pas. Une activité inconsciente d'une complexité rare conduit à la construction d'une image. Cette image s'impose. Il nous est imposé de croire que l'arbre que je vois est bien un objet extérieur à moi, donné immédiatement comme tel. L'arbre est pourtant bien une image mentale et non la donnée directe d'un objet extérieur appelé arbre. Cette image a le caractère d'un modèle porteur de quantité d'informations sur l'objet en soi : distance par rapport à moi, orientation, forme, etc. Ce modèle je crois qu'il est l'arbre en soi; je ne perçois pas qu'il s'agit d"une image mentale, il m'est impossible de ressentir les efforts provoqués par le travail préparatoire éminemment complexe réalisé par le monde inconscient. Je n'ai pourtant pas de raison de me plaindre de la tyrannie du monde inconscient qui m'impose cette image puisque cette image, résultat de mises au point incessantes effectuées depuis des millénaires entre les "choses" et "le vivant" permet une action efficace, une relation avec les choses en soi positive et réussie. Je peux en toute confiance travailler sur les phénomènes, matériaux donnés par l’activité inconsciente, bâtir des mondes, des univers, à partir du phénomène, en toute confiance : le monde inconscient ouvrage les phénomènes avec une maestria éprouvée depuis des millénaires. Nous croyons tous que le phénomène, c'est-à-dire ce qui nous est donné à percevoir par le monde inconscient est une base béton, suffisamment solide en tout cas pour construire notre science et toutes nos théories sur l'univers. D'ailleurs nous avons raison d'avoir foi en cet inconscient puisque la science que nous développons à partir des données fournies par cet inconscient nous permet en effet d'agir en retour sur les phénomènes, lesquels sont dans un rapport si étroit avec le monde en soi, que l'action sur le phénomène nous donne les résultats escomptés. Il faudrait qu'arrive une rupture soudaine à l’intérieur même du monde en soi (rupture qui se traduirait par exemple par la disparition soudaine de la pesanteur) pour que toute notre science s'écroule. Mais chaque matin le phénomène reste égal à lui même, ce qui signifie que le monde en soi reste égal à lui même. Comme dirait Hume nous avons pris tellement l’habitude de constater que le tas de terre de la veille est toujours le même tas de terre le lendemain que nous avons bâti une foi irréfragable dans la permanence des choses, donc des choses en soi. Nous avons la foi. Même l'athée le plus endurci part du principe que le sol sur lequel il marche aujourd'hui sera toujours le même sol demain. Hume a raison: nous vivons tous dans la croyance.
-
Il est nécessaire d'approfondir cette question : chose en soi/phénomène. Reprenons cet imaginaire : posons l'existence d'êtres "oyant" vivant dans un monde baigné dans un fluide transportant les ondes sonores. Ces êtres, imaginons qu'ils aient réussi à créer une science par émission et réception d'ondes sonores, par création d'instruments de mesure de durée (sons répétitifs et de période égale émis par un instrument dédié à cette fonction), etc. Prenons le cas d'un arbre. De cet arbre ces "oyant" pourraient répertorier un ensemble d'informations qui constituerait une banque spécifique de sons, banque qu'ils appelleraient : arbre. Cette banque de sons serait un ensemble d'informations exploitables par ces "oyant" dans le cadre d'une relation possible arbre-oyant. Sans doute finiraient-ils par identifier l'arbre et cette banque d’informations. Ils affirmeraient que l'arbre est cet ensemble de sons. Nous protesterions en disant : non, l'arbre est cette image, cette banque d'images spécifiques. Si nous partons du principe que la banque de sons ou que la banque d'images est le phénomène, l'être même qu'est l'arbre reste hors de la perception, hors de la connaissance. Est-ce important ? Non, car les choses ne nous intéressent que sous le rapport de l'action, de la relation possible entre elles et nous. L’être en soi ne nous intéresse pas, il n’intéresse pas les scientifiques. Seuls les philosophes idéalistes s’intéressent à l'être en soi. Mais ils ne pourront jamais rien en dire car la décision de séparer l'être en soi de ses effets et de ses qualités, de le séparer de ses attributs donc, de ses prédicats, conduit à penser un être en soi, un noumène dirait Kant, à propos duquel il n'est pas possible d'affirmer quoi que ce soit puisque cette réalité, cet être en soi, n'entre pas en relation avec nous. Il ne peut rentrer en relation avec nous que par ses effets et qualités et nos sens ne peuvent capter que ces effets et ces qualités, jamais l'être en soi.
-
Le mot : Volonté désigne ce que le champ conscient reçoit en lui. Est-le mot qui convient ? Il est choisi ce mot par analogie avec ce que le champ conscient reçoit lorsqu'il y a confrontation au vouloir d'un tiers. C'est toujours la difficulté : pour désigner un sentiment, le rendre intelligible à soi et aux autres il faut passer par un détour objectif ou approchant une objectivité. Volonté : cela désigne une action puissante exercée sur soi, une action intentionnelle. Dès perception de cette action impérative sur soi il y a ce réflexe : nommer l'être de cette action. S'il y a action il y a quelqu’un ou quelque chose qui produit cette action. Nous humanisons aussitôt les actions perçues. C'est un impératif logique : nous cédons aux règles de la logique, nous cédons au principe de causalité, tout a une cause, tout a une origine. Faut il y céder ? Y céder peut provoquer des errements. Si, percevant une volonté qui s'exerce sur moi, de l'intérieur, je dis : volonté de Dieu, sacrifiant ainsi à la tyrannie de la logique, je commence une errance, car j’introduis ce mot : Dieu, lequel est déterminé par un champ culturel donné. J'introduis une culture propre à une civilisation déterminée. Alors que le processus ressenti, le surgissement d'une réalité perçue appelée Volonté réfère à un espace et à un temps infiniment plus vaste que l'espace et le temps d'une civilisation humaine quelconque. Car il est probable que cette irruption en soi, de ce que j'appelle Volonté, dépasse très largement comme champ expérience, le seul champ d’expérience de l’humanité. Je peux bien sûr introduire tout autre mot que Dieu, mais je risque toujours en choisissant un autre mot de m'égarer encore dans les méandres d’interprétations propres à une civilisation donnée. Il vaut mieux s'en tenir au mot Volonté, lui-même imparfait d'ailleurs, sans céder à la tyrannie de la logique qui ne peut qu'aggraver l'imperfection de la représentation. Schopenhauer se sépare de Kant sur ce point : la chose en soi. Mais il réintroduit ce concept en laissant entendre que la Volonté est elle-même l'effet, en soi, d'une réalité inaccessible.L'un travaille dans le champ de la raison et introduit l'idée de la chose en soi. L'autre travaille dans le champ du sentiment et introduit l'idée d'un inaccessible dont procèderai la Volonté. Si la raison et le sentiment sont nos deux instruments d’exploration de notre univers sous ses deux faces matérielles et spirituelles alors ces deux champs sont chacun bordé par une réalité inaccessible à l'entendement humain. L'univers humain évolue entre deux mondes inaccessibles.